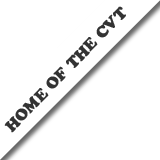[01T] Politix, fonctionnaire et Cie
Très long mais intéressant à lire, instructif sur le fonctionnement des institutions européennes.
Un insider raconte: comment l'Europe a étranglé la Grèce
07 juillet 2015 | Par christian salmon
Quelques jours avant le référendum, un conseiller important du gouvernement grec, au cœur des négociations avec Bruxelles, a reçu Mediapart. Il raconte les cinq mois du gouvernement de Syriza, les discussions avec les Européens, la situation catastrophique de la Grèce. Il détaille surtout la stratégie d'étouffement mise en place méthodiquement par l'Eurogroupe et l'asphyxie financière qui a détruit l'économie grecque. Voici le texte de cet entretien au long cours.
Athènes, de notre envoyé spécial.- Quelques jours avant le référendum, un conseiller du gouvernement a reçu plusieurs journalistes français, dont Christian Salmon pour Mediapart (lire notre boîte noire). Il leur a raconté les cinq mois du gouvernement de Syriza, les discussions avec les Européens, la situation catastrophique de la Grèce. Notre interlocuteur était durant tout ce temps au cœur de la machine ministérielle en charge des négociations avec l'Union européenne. Il n'est pas tendre avec les institutions, décrit une stratégie délibérée d'étouffement menée par les institutions européennes, mais juge aussi sévèrement certaines décisions du gouvernement grec. Voici son récit au long cours. (traduction Martine Orange)
----------------------
Depuis le début, je n’étais pas d’accord sur la façon dont nous avons négocié avec les Européens. Le gouvernement grec a eu des discussions, des arrangements sur la politique budgétaire, sur les conditionnalités, etc. Mais dans ces discussions, c’était toujours le gouvernement qui faisait les concessions, qui se rapprochait de la Troïka, sans qu’eux [les Européens] ne fassent le moindre mouvement vers nous. Ils n’ont jamais discuté de la dette : la restructuration de la dette, sa soutenabilité. Ils n’ont jamais discuté des financements : est-ce que la BCE allait lever toutes ses restrictions ? Dans quelles limites les banques allaient-elles pouvoir emprunter, et l’État emprunter aux banques ?
Parce que nous ne pouvons rien emprunter. Nous pouvions le faire jusqu’en février. Nous pouvions encore émettre des billets de trésorerie. Des titres à court terme, des obligations à taux fixe à trois mois, la plupart à un an. Mais ce gouvernement n’a jamais été autorisé à utiliser de tels instruments. À son arrivée, c’était fini. La BCE a dit « plus de billets de trésorerie » (voir La BCE lance un coup d’État financier).
Alors, l’État ne pouvait plus emprunter auprès des banques. Aussi, à partir de mars, nous avons commencé à économiser tout ce que nous avons pu dans les dépenses de l’État. Nous avons regroupé toutes les réserves d’argent des différentes branches, des agences, des autorités locales pour payer le FMI. Nous avions un problème avec les finances publiques, avec l’excédent primaire, nous ne pouvions pas payer le FMI, alors nous avons dû gratter partout. Cela a conduit à une réduction interne de la liquidité en cash. Les banques, les entreprises exportatrices, les entreprises manufacturières ne pouvaient plus emprunter. Les gens ne pouvaient plus payer leurs dettes. Ils ne pouvaient plus obtenir la moindre extension de crédits. Le système de crédit a commencé à ne plus fonctionner, à se désintégrer.
Bien sûr, les banques avaient des réserves de sécurité. Mais quand ils sont arrivés au point de décider que les banques ne pouvaient même pas accéder aux fonds d’urgence de liquidité [emergency liquidity assistance, ELA], les banques ont dû fermer, parce qu’elles ne pouvaient pas épuiser leurs réserves.
Les entreprises qui ne versent pas les salaires sur des comptes bancaires ne peuvent pas payer leurs salariés en cash. Et il y en a beaucoup. Elles disent : « Nous n’avons aucun chiffre d’affaires, alors je vous verse 500 euros au lieu de 800. Nous verrons ce qui arrive après la réouverture des banques. » Nous sommes dans une situation qui, d’escalade en escalade, se transforme en réaction en chaîne, une sorte de lente panique bancaire et d’effondrement. C’est une sorte d’infarctus, si vous voyez la liquidité comme le sang de l’économie. Le week-end dernier, quand la BCE a tout arrêté, nous avons eu une crise cardiaque. Maintenant nous en avons les contrecoups. Différents organes sont paralysés. Certains ont arrêté de fonctionner, d’autres essaient mais n’ont pas assez de sang.
Varoufakis n’est pas dans la norme
Les gens se demandent pourquoi Yanis Varoufakis est si impopulaire au sein de l’Eurogroupe, pourquoi ils ne l’aiment pas… Beaucoup de gens disent qu’il semble toujours leur faire la leçon, qu’il paraît arrogant. Mais je pense que ces personnes, spécialement les politiques dans l’Eurogroupe, les autres ministres, ont vu un personnage très différent de tous ceux qu’ils ont pu rencontrer dans leur cercle, différent des autres élus dans le cadre d’un processus politique normal. Et c’est vrai, non ?
Vous avez un homme qui a sa propre manière de s’habiller [référence à ses blousons en cuir et à son absence de cravate – ndlr]. Il est très sûr de lui et en même temps il est très amical, très ouvert, très honnête. Quand vous lui posez une question, il ne tourne pas autour du pot, il ne change pas de sujet. Et cela crée une difficulté, à la fois pour les politiques, les journalistes et les médias. Rien que ces deux faits montrent que Varoufakis n’est pas dans la norme : il n’est pas convenable, aux yeux des autres. En même temps, c’est une célébrité et il suscite des avis très tranchés : soit vous l’aimez, soit vous le détestez.
Il y a une panique face à l'idée que même si les banques rouvrent, elles devront être recapitalisées
Normalement, la liquidité sur le marché, l’argent [en numéraire – ndlr] qui circule, se situe autour de 10 milliards d’euros. Maintenant, avec ce qui est arrivé, les gens gardent leur argent sous leur matelas, et la liquidité est autour de 50 milliards d’euros. 50 milliards d’euros en numéraire sont en circulation et la BCE a tout arrêté.
Les gens qui ont sur leur compte 20 000, 30 000, 40 000 euros, peuvent seulement tirer 60 euros par jour. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez tirer plus. Mais que se passe-t-il pour les gens qui n’ont pas d’épargne, qui vivent de leur seul salaire ? À la fin de chaque mois, ils sont fauchés jusqu’à ce que le chèque arrive. Et soudain, ils ne peuvent obtenir que 60 euros.
C’est la fin du mois. C’est le moment où les gens sont payés. Ils font la queue devant les distributeurs et ils ont peur. Parce que les 60 euros sont devenus 50. Car les banques sont à court de billets de 20 euros. Alors depuis hier [2 juillet – ndlr], elles donnent seulement 50 euros. Seules les petites banques comme les banques postales, parce qu’elles ont moins de clients, peuvent encore accorder 60 euros par retrait. Mais les quatre grandes banques (National, Pireaus, Alpha et Eurobank) sont à court de billets de 20 euros. Alors, elles donnent des billets de 50 euros. De 60 euros, c’est tombé à 50.
Les réserves qu’elles avaient sont en train de s’épuiser. Si tout le monde retire 60 euros, va arriver le moment où les banques n’auront plus du tout de monnaie. Et c’est là que le problème commence. Dans ce cas, si nous n’avons pas accès aux fonds d’urgence de la BCE, nous n’aurons pas d’autre option que d’émettre une sorte de monnaie parallèle.
Ce serait la fin de l’économie. Il y a déjà la peur. Il y a une panique face à l'idée que même si les banques rouvrent, elles auront besoin d’être recapitalisées. Jusqu’à maintenant, elles étaient solvables. Mais si elles pouvaient avoir recours aux fonds d’urgence, elles auraient dû aussi être autorisées à emprunter directement auprès de la BCE. Mais la BCE a dit « non, à partir de maintenant, nous n’acceptons plus votre collatéral [titres mis en dépôt de garantie quand les banques se refinancent directement auprès de la Banque centrale – ndlr]. Vous devez emprunter plus cher auprès des fonds ELA ». C’est une de ces limitations qui frappent les banques. Mais si elles n’ont plus de réserves, l’État devra payer 40 milliards pour reconstituer le capital que les banques ont perdu après la restructuration [intervenue en 2012 – ndlr] sur les vieilles obligations grecques.
Ces 40 milliards, c'est une partie du second programme de sauvetage de 2012 – signé après la restructuration de la dette privée (voir Grèce : les banques se sauvent, le désastre est toujours là) –, qui était d’environ 170 milliards, dont 50 milliards pour la recapitalisation des banques.
Mais il y a un autre problème. Dans le cadre de ce plan, les fonds publics (caisses de retraite, fonds de sécurité sociale, etc.) ont subi des pertes presque aussi importantes que les banques, si ce n’est plus, qui ont touché leurs réserves. Parce qu’ils ont été forcés, selon la loi, d’apporter leurs réserves à la banque centrale de Grèce et que la Banque centrale avait le droit d’utiliser ces fonds pour acheter des obligations en leur nom.
Pour moi, cela a été un énorme scandale. Il semble que beaucoup d’hommes politiques, des banquiers, de nombreuses personnes averties, qui détenaient des obligations qu’ils avaient achetées à 20 % de leur valeur nominale, sont allés les apporter à la banque de Grèce. Et celle-ci les a remboursés sur la base de 100 % de la valeur. Ils ont eu leur argent et tout le fardeau de la décote a été transféré au public.
Ces fonds ont été forcés d’utiliser leurs réserves pour acheter les obligations d’État qui avaient perdu 70 % de leur valeur. Ces fonds, les fonds de retraite, sont confrontés aujourd’hui à un problème plus grave que les banques. Les fonds de retraite doivent planifier sur 15 à 20 ans pour être capables de payer les retraites, alors que la population âgée augmente et que la population active diminue. Ils doivent aussi verser les allocations chômage, etc. Aussi, tous ces verrous de dette reviennent à la surface en même temps.
Dès la fin février, en tout cas au milieu du mois de mars, il était évident que les créanciers n’allaient pas respecter l’accord du 20 février, qui prévoyait que la Grèce propose ses réformes et que la Troïka – les Institutions comme on les appelle maintenant – les évalue et donne son accord. Rien ne s’est passé comme cela.
Les Institutions ont constamment rejeté toutes les propositions de réforme sans les regarder. Varoufakis leur disait : « Laissez-nous compléter quatre ou cinq réformes sur lesquelles nous sommes tous d’accord et que nous considérons comme nécessaires, laissez-nous les mettre en œuvre et vous pourrez les évaluer et donner une appréciation. » Ils ont tout refusé en disant : « Non, non, nous avons besoin d’un accord-cadre global avant que vous lanciez ces réformes. Si vous mettez en œuvre ces réformes, ce sera une action unilatérale. Nous ne les avons pas encore approuvées – OK, nous sommes d’accord – mais nous n’avons pas encore arrêté l’excédent primaire budgétaire. »
Nous étions dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. Dans le même temps, ils voulaient voir nos livres, les comptes des finances publiques au ministère des finances, ceux de la banque centrale, parce qu’ils n’avaient pas confiance dans nos chiffres. Varoufakis leur disait : « Revenons à l’accord du 20 février. Vous vous êtes engagés à ne plus superviser l’économie grecque. Et vous ne nous aidez pas à assurer la viabilité de l’économie afin de retrouver progressivement la croissance. C’était l’objectif de l’accord du 20 février, une extension du programme [d’aide] existant. Nous amendons, évaluons, complétons le programme au cours de ces quatre mois. Le 30 juin, le programme est fini. » Mais ils ont débranché les banques. Le 30 juin, le programme s’est arrêté. Et nous ne sommes plus dans aucun programme.
Et tout cet argent qu’ils nous doivent ! Environ 17 milliards d’euros, dont 10 milliards dans le cadre du fonds de stabilité financière qui, selon l’accord du 20 février, devaient nous être reversés. Nous n’avons pas reçu un centime depuis juin de l’an dernier. Depuis douze mois nous avons payé environ 10 milliards à nos créanciers, en tirant sur nos seules ressources, sans recevoir un seul euro de leur part, alors qu’ils avaient accepté de les donner, sous conditions bien sûr.
Une torture financière et budgétaire
Tous les prêts que nous avons reçus – 240-250 milliards – sont allés au service de la dette, et sont donc revenus aux créanciers. Le premier plan de sauvetage a été un sauvetage des banques et un transfert vers l’État. Nous n’avons reçu aucune aide financière pour les payer. Nous ne pouvions pas emprunter à court terme. Nous ne pouvions prendre aucune mesure pour améliorer la liquidité de l’économie : la BCE a imposé des restrictions, les unes après les autres. C’est ce que j’appelle depuis le début l’étranglement par le crédit.
À la mi-mars, certaines sources bruxelloises ont dit : « Oui, les Institutions (BCE, FMI, Commission) utilisent le crédit pour vous asphyxier, afin de forcer le gouvernement à se soumettre et à accepter les réformes. Faites-le vite. » Pour moi, c’était admettre qu’ils utilisaient le pire des moyens de chantage économique contre le pays. La pire des sanctions économiques. Voyez comment ça s’est passé en Irak ; au lieu d’imposer un embargo commercial, les Américains auraient pu dire : « Nous coupons tous vos actifs, vos banques n’ont plus d’argent, plus de dollars, plus rien, vous ne devez compter que sur les seuls billets de banque, vous allez avoir des restrictions. » Mais ils n’ont pas fait cela en Irak. Il y a eu un embargo commercial, pas une asphyxie organisée financière ou du crédit. Parce qu’à un moment, graduellement, c’est la mort. On ne peut survivre à un tel traitement très longtemps. Varoufakis a appelé cela le supplice de la baignoire (waterboard). Une torture financière et budgétaire.
J’ai dit à Varoufakis : « Nous devons faire savoir qu’ils sont en train de commettre un crime équivalent à un crime contre l’humanité. Toute l’économie du pays est détruite. Les gens sont pauvres et sans logis, y compris les enfants. C’est cela la situation. Ces faits ont été conduits de façon intensive pour conduire à une forme de chantage qui est un crime par rapport aux lois internationales, aux traités européens. Nous ne pouvons continuer comme cela car cela reviendrait à ce que nous légitimions ce crime. » Pour moi, c’est abominable. Ce n’est pas une négociation, c’est un acte de torture, comme s’ils nous demandaient de donner les noms des partisans.
Malheureusement, Varoufakis croit encore, croit toujours qu’il peut les raisonner, les amener à négocier. La seule solution qu’il reste aux Institutions est de pousser la crise à son paroxysme, et après de décider. Décideront-ils ou non de mener l’économie grecque à l’effondrement ?
Le gouvernement pensait qu'aller jusqu’à l’effondrement de l’économie grecque provoquerait l’effondrement de l’économie mondiale. Cela ne s’est pas produit et j’en suis navré. J’ai suivi l’évolution de l’euro, comment il a réagi face à leurs expérimentations. Schäuble [ministre allemand des finances – ndlr] et Berlin sont intelligents. Ils ont alimenté artificiellement la crise : « Les Grecs ne sont pas coopératifs. Ils n’ont pas compris ce qu’il faut faire. Ils ne donnent aucun chiffre. » Or, au lieu de chuter, l’euro a monté. Cela a été pareil sur les marchés boursiers.
Ce n’est qu’au cours de la dernière semaine [avant le référendum – ndlr] que les responsables grecs ont pris la mesure de ce qui se passait. Varoufakis a fait plusieurs déclarations à ce sujet, disant que nous devions nous adresser à la Cour européenne de justice. Mais une fois que la crise a explosé, les arguments légaux ne sont plus d’aucun secours.
J’avais dit que Tsipras devait aller au parlement européen et révéler publiquement la façon dont ils étaient traités ces derniers mois, et pourquoi il refusait de mettre en œuvre ces mesures d’austérité, pourquoi il préférait perdre les élections que d’instaurer ces mesures. Chaque fois qu’ils ont essayé de mener des négociations politiques, ils se sont fait balader. Vingt fois avec Merkel, cinq fois avec Schäuble. Combien de réunions de l’Eurogroupe se sont terminées par « retournez vers les équipes techniques, retournez vers la Troïka » ? Les Grecs ont demandé une décision politique. Il leur a été répondu : « Notre décision politique est d’en référer aux équipes techniques. Vous ne pouvez avoir de décision politique sans une décision technique. »
À chaque étape, ils ont essayé de détruire le prestige qu’avait gagné le gouvernement grec au cours du premier mois de la négociation. À cette période, les Européens disaient : « C’est un nouvel espoir pour l’Europe, pour l’Allemagne, l’Espagne. Les Grecs nous montrent le chemin. » S’ils avaient dit d’emblée : « C’est fini. Nous n’acceptons plus de négocier », ce qu’ils ont dit indirectement à Dijsselbloem [ministre des finances des Pays-Bas, patron de l’Eurogroupe – ndlr] par exemple, cela aurait été clair. Nous serions allés au clash. Mais ils n’ont pas fait cela. Il y a eu un Eurogroupe, un autre Eurogroupe, des réunions de travail et encore et toujours des Eurogroupe… les Européens ont créé une foule de pseudo-négociations. Du temps perdu qui a été gagné de leur côté. Pendant tout ce temps, ils ont mené campagne contre Varoufakis, l’ont assassiné médiatiquement. Et lui continuait à négocier. Qu’espérait-il ?
Nous en sommes là. Nous avons perdu tout appui économique pour trouver les termes d’un nouvel accord et perdu toute crédibilité pour les forcer à négocier avec nous. Le gouvernement Tsipras dit que quand ils nous ont présenté l’ultimatum, l’accord à prendre ou à laisser, celui-ci comportait des mesures pires que celles qu’ils avaient exigées du précédent gouvernement. L’aile droite du gouvernement, Tsipras et Varoufakis, se sont dit « soit nous allons au parlement avec la répétition du scénario chypriote : avec dans le week-end la BCE qui dit au parlement : "vous prenez des mesures ou lundi il n’y a plus de banque" ». Soit ils faisaient ce qu’ils ont fait, ce qui était le bon mouvement : ils allaient au référendum, ce qui impliquait qu’ils auraient à endurer ce qui s’est passé à Chypre pour une semaine.
Ils pensent que la situation rapprochera du terme d’un accord. Mais les Européens n’en ont rien à faire d’une crise mondiale ou européenne, ou même d’un effondrement. Oui, les bourses ont chuté, oui, il y a eu des fluctuations monétaires, la livre a monté. Mais à la fin, les Européens ne sont pas plus prêts à trouver un accord qu’auparavant.
Varoufakis et Tsipras disaient qu’en cas de victoire du non, leur position serait renforcée pour en finir avec ce type d’accord qui exclut une restructuration de la dette ou l’ajustement budgétaire. Car aujourd’hui les sommes dues par les Européens (17 milliards d’euros), plus 16 (ou 20 milliards) par le FMI sont perdues, le programme est fini. Et un nouvel accord est nécessaire. La première chose à faire est d’aller quémander des fonds d’urgence auprès de la BCE. Mais les Européens disent qu’ils ont besoin de retourner devant leur parlement, etc. Une recapitalisation (des banques) s’impose pourtant pour faire fonctionner à nouveau l’économie. C’est la condition première pour établir un nouveau programme.
Faire savoir au monde entier que l’Eurozone est en train de commettre un crime contre l’humanité
En même temps, même discuter d’un Grexit est problématique – c’est illégal puisqu’il n’existe aucune disposition dans les traités qui l’autorise –, mais les Européens n’ont pas osé utiliser cet argument. Il n’y a aucune garantie que la sortie de l’euro pour la Grèce puisse se faire de manière ordonnée, négociée, pacifique, plutôt que de façon désordonnée avec des gens courant dans les magasins pour faire des provisions. Si un processus de sortie de l’euro n’est pas mis en place, alors la sortie est une arme de destruction massive. Si vous menacez quelqu’un d’une sortie de l’euro, vous poussez aux limites la résistance du système bancaire, alors vous détruisez rapidement le système bancaire et après vous fouillez dans les ruines pour créer une nouvelle monnaie, qui prendra des mois avant d’apparaître.
Ils ont dit que ce serait destructeur et désastreux pour nous, comme cela l’est pour vous. D’abord, je ne suis pas d’accord avec cette position. C’est un chantage. Et cela permet aux autres de nous accuser de chantage. C’est ridicule d’accuser un pays détruit pendant cinq ans de chantage. C’est un mauvais argument. Le bon argument est que la sortie de la Grèce de l’euro, comme toutes les autres mesures que les Grecs ont subies, est illégale au regard de la loi internationale, des lois du travail, des traités européens, de la déclaration européenne des droits de l’homme, de la déclaration européenne du travail. Début 2014, le parlement européen avait commencé à attaquer la Troïka, en lui reprochant son illégalité, d’imposer des mesures qui détruisaient les droits de l’homme, les droits du travail… Mais nous avions un gouvernement qui ne voulait pas entendre parler de cela. Il préférait attaquer l’opposition plutôt que les créanciers. Il n’a pas vu que c’était l’arme la plus puissante que nous avions.
Quand vous êtes du côté des faibles, il n’y a que deux voies : l’une est celle de la loi – en appeler à la légitimité –, l’autre est celle de la vérité – qui est dans le vrai, qui est dans le faux dans ses arguments et au regard des droits de l’homme. Selon la loi, tous les hommes sont égaux. C’est le fondement de la démocratie représentative. Aussi, si vous en appelez à la Cour européenne de justice en disant « je ne suis pas traité équitablement en tant que membre de l’Union européenne, de l’Otan », ils ne peuvent ignorer votre cause.
Mais si vous empruntez la voie légale, cela peut être très long. Alors je ne pense pas à cela. Vous devez atteindre la délégitimation politique : faire savoir au monde entier que l’Eurozone est en train de commettre un crime contre l’humanité. Le prouver dans dix ans, cela m’indiffère. Mais si vous déposez votre dossier devant la Cour et que vous dites : « Jusqu’à ce vous ayez examiné le dossier, ces mesures doivent cesser »…
Aujourd’hui c’est trop tard. C’est une question d’hégémonie politique et idéologique. Au début, Varoufakis seul, avec ses arguments, a entrepris de renverser l’opinion publique en Europe et même en Allemagne. Les responsables de l’Eurogroupe ont riposté. Au début de février, Dijsselbloem a dit à Varoufakis : « Soit vous signez le mémorandum, soit votre économie va s’effondrer. Comment ? Nous allons faire tomber vos banques. » Le président de l’Eurogroupe a dit cela. Dans son dernier entretien à la télévision publique grecque, il y a deux jours, Yanis Varoufakis a expliqué : « Je n’ai pas dénoncé ces propos à l’époque parce que j’espérais que la raison prévaudrait dans les négociations. »
Alors pourquoi n'avons-nous pas été soutenus ? Tout simplement parce que l'Eurogroupe n’est pas un organe qui fonctionne de façon démocratique. Ils [le gouvernement grec] l’ont découvert à nouveau trop tard quand les Européens ont voulu exclure Varoufakis après l’annonce du référendum. Il y avait une volonté d’humiliation. Varoufakis a demandé : « Qui a décidé cela ? » Dijsselbloem lui a répondu : « J’ai décidé. » N’y aurait-il pas dû y avoir un vote ? Cette décision n’aurait-elle pas dû être prise à l’unanimité ? Dans un fonctionnement normal, bien sûr. Mais à l’Eurogroupe, ce n’est pas nécessaire, parce qu’il n’y a aucun compte-rendu écrit. Aussi, il n’y a rien de formel. Quand un responsable sort de l’Eurogroupe, il peut raconter ce qu’il veut. Personne ne peut dire : « Avez-vous vraiment dit cela ? Regardons le compte-rendu. » Il n’y a pas de minutes des débats.
Varoufakis a dit qu’il avait enregistré les réunions, parce qu’il devait rapporter au premier ministre et aux autres membres du gouvernement ce qu’il s’y disait. Les autres ont crié. Il a décrit des incidents qui prouvent que l’Eurozone est totalement non démocratique, presque néofasciste. Trop discuter avec Schäuble peut être dangereux, parce que vous risquez de ne pas obtenir les financements. Les banques allemandes veulent leur argent. C’est une organisation où vous ne pouvez pas faire entendre votre voix. Personne d’autre que Varoufakis n'a parlé ouvertement. Schäuble a dit : « Combien voulez-vous pour quitter l’euro ? » Il ne veut pas de la Grèce dans l’euro. Il a été le premier à parler de la sortie de la Grèce en 2011.
Nous sommes partis à la bataille en pensant que nous avions les mêmes armes qu’eux. Nous avons sous-estimé leur pouvoir. C’est un pouvoir qui s’inscrit dans une vraie fabrique de société, dans la façon de penser des gens. Il se fonde sur le contrôle et le chantage. Nous avons très peu de leviers face à lui. L’édifice européen est kafkaïen.
Un insider raconte: comment l'Europe a étranglé la Grèce
07 juillet 2015 | Par christian salmon
Quelques jours avant le référendum, un conseiller important du gouvernement grec, au cœur des négociations avec Bruxelles, a reçu Mediapart. Il raconte les cinq mois du gouvernement de Syriza, les discussions avec les Européens, la situation catastrophique de la Grèce. Il détaille surtout la stratégie d'étouffement mise en place méthodiquement par l'Eurogroupe et l'asphyxie financière qui a détruit l'économie grecque. Voici le texte de cet entretien au long cours.
Athènes, de notre envoyé spécial.- Quelques jours avant le référendum, un conseiller du gouvernement a reçu plusieurs journalistes français, dont Christian Salmon pour Mediapart (lire notre boîte noire). Il leur a raconté les cinq mois du gouvernement de Syriza, les discussions avec les Européens, la situation catastrophique de la Grèce. Notre interlocuteur était durant tout ce temps au cœur de la machine ministérielle en charge des négociations avec l'Union européenne. Il n'est pas tendre avec les institutions, décrit une stratégie délibérée d'étouffement menée par les institutions européennes, mais juge aussi sévèrement certaines décisions du gouvernement grec. Voici son récit au long cours. (traduction Martine Orange)
----------------------
Depuis le début, je n’étais pas d’accord sur la façon dont nous avons négocié avec les Européens. Le gouvernement grec a eu des discussions, des arrangements sur la politique budgétaire, sur les conditionnalités, etc. Mais dans ces discussions, c’était toujours le gouvernement qui faisait les concessions, qui se rapprochait de la Troïka, sans qu’eux [les Européens] ne fassent le moindre mouvement vers nous. Ils n’ont jamais discuté de la dette : la restructuration de la dette, sa soutenabilité. Ils n’ont jamais discuté des financements : est-ce que la BCE allait lever toutes ses restrictions ? Dans quelles limites les banques allaient-elles pouvoir emprunter, et l’État emprunter aux banques ?
Parce que nous ne pouvons rien emprunter. Nous pouvions le faire jusqu’en février. Nous pouvions encore émettre des billets de trésorerie. Des titres à court terme, des obligations à taux fixe à trois mois, la plupart à un an. Mais ce gouvernement n’a jamais été autorisé à utiliser de tels instruments. À son arrivée, c’était fini. La BCE a dit « plus de billets de trésorerie » (voir La BCE lance un coup d’État financier).
Alors, l’État ne pouvait plus emprunter auprès des banques. Aussi, à partir de mars, nous avons commencé à économiser tout ce que nous avons pu dans les dépenses de l’État. Nous avons regroupé toutes les réserves d’argent des différentes branches, des agences, des autorités locales pour payer le FMI. Nous avions un problème avec les finances publiques, avec l’excédent primaire, nous ne pouvions pas payer le FMI, alors nous avons dû gratter partout. Cela a conduit à une réduction interne de la liquidité en cash. Les banques, les entreprises exportatrices, les entreprises manufacturières ne pouvaient plus emprunter. Les gens ne pouvaient plus payer leurs dettes. Ils ne pouvaient plus obtenir la moindre extension de crédits. Le système de crédit a commencé à ne plus fonctionner, à se désintégrer.
Bien sûr, les banques avaient des réserves de sécurité. Mais quand ils sont arrivés au point de décider que les banques ne pouvaient même pas accéder aux fonds d’urgence de liquidité [emergency liquidity assistance, ELA], les banques ont dû fermer, parce qu’elles ne pouvaient pas épuiser leurs réserves.
Les entreprises qui ne versent pas les salaires sur des comptes bancaires ne peuvent pas payer leurs salariés en cash. Et il y en a beaucoup. Elles disent : « Nous n’avons aucun chiffre d’affaires, alors je vous verse 500 euros au lieu de 800. Nous verrons ce qui arrive après la réouverture des banques. » Nous sommes dans une situation qui, d’escalade en escalade, se transforme en réaction en chaîne, une sorte de lente panique bancaire et d’effondrement. C’est une sorte d’infarctus, si vous voyez la liquidité comme le sang de l’économie. Le week-end dernier, quand la BCE a tout arrêté, nous avons eu une crise cardiaque. Maintenant nous en avons les contrecoups. Différents organes sont paralysés. Certains ont arrêté de fonctionner, d’autres essaient mais n’ont pas assez de sang.
Varoufakis n’est pas dans la norme
Les gens se demandent pourquoi Yanis Varoufakis est si impopulaire au sein de l’Eurogroupe, pourquoi ils ne l’aiment pas… Beaucoup de gens disent qu’il semble toujours leur faire la leçon, qu’il paraît arrogant. Mais je pense que ces personnes, spécialement les politiques dans l’Eurogroupe, les autres ministres, ont vu un personnage très différent de tous ceux qu’ils ont pu rencontrer dans leur cercle, différent des autres élus dans le cadre d’un processus politique normal. Et c’est vrai, non ?
Vous avez un homme qui a sa propre manière de s’habiller [référence à ses blousons en cuir et à son absence de cravate – ndlr]. Il est très sûr de lui et en même temps il est très amical, très ouvert, très honnête. Quand vous lui posez une question, il ne tourne pas autour du pot, il ne change pas de sujet. Et cela crée une difficulté, à la fois pour les politiques, les journalistes et les médias. Rien que ces deux faits montrent que Varoufakis n’est pas dans la norme : il n’est pas convenable, aux yeux des autres. En même temps, c’est une célébrité et il suscite des avis très tranchés : soit vous l’aimez, soit vous le détestez.
Il y a une panique face à l'idée que même si les banques rouvrent, elles devront être recapitalisées
Normalement, la liquidité sur le marché, l’argent [en numéraire – ndlr] qui circule, se situe autour de 10 milliards d’euros. Maintenant, avec ce qui est arrivé, les gens gardent leur argent sous leur matelas, et la liquidité est autour de 50 milliards d’euros. 50 milliards d’euros en numéraire sont en circulation et la BCE a tout arrêté.
Les gens qui ont sur leur compte 20 000, 30 000, 40 000 euros, peuvent seulement tirer 60 euros par jour. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez tirer plus. Mais que se passe-t-il pour les gens qui n’ont pas d’épargne, qui vivent de leur seul salaire ? À la fin de chaque mois, ils sont fauchés jusqu’à ce que le chèque arrive. Et soudain, ils ne peuvent obtenir que 60 euros.
C’est la fin du mois. C’est le moment où les gens sont payés. Ils font la queue devant les distributeurs et ils ont peur. Parce que les 60 euros sont devenus 50. Car les banques sont à court de billets de 20 euros. Alors depuis hier [2 juillet – ndlr], elles donnent seulement 50 euros. Seules les petites banques comme les banques postales, parce qu’elles ont moins de clients, peuvent encore accorder 60 euros par retrait. Mais les quatre grandes banques (National, Pireaus, Alpha et Eurobank) sont à court de billets de 20 euros. Alors, elles donnent des billets de 50 euros. De 60 euros, c’est tombé à 50.
Les réserves qu’elles avaient sont en train de s’épuiser. Si tout le monde retire 60 euros, va arriver le moment où les banques n’auront plus du tout de monnaie. Et c’est là que le problème commence. Dans ce cas, si nous n’avons pas accès aux fonds d’urgence de la BCE, nous n’aurons pas d’autre option que d’émettre une sorte de monnaie parallèle.
Ce serait la fin de l’économie. Il y a déjà la peur. Il y a une panique face à l'idée que même si les banques rouvrent, elles auront besoin d’être recapitalisées. Jusqu’à maintenant, elles étaient solvables. Mais si elles pouvaient avoir recours aux fonds d’urgence, elles auraient dû aussi être autorisées à emprunter directement auprès de la BCE. Mais la BCE a dit « non, à partir de maintenant, nous n’acceptons plus votre collatéral [titres mis en dépôt de garantie quand les banques se refinancent directement auprès de la Banque centrale – ndlr]. Vous devez emprunter plus cher auprès des fonds ELA ». C’est une de ces limitations qui frappent les banques. Mais si elles n’ont plus de réserves, l’État devra payer 40 milliards pour reconstituer le capital que les banques ont perdu après la restructuration [intervenue en 2012 – ndlr] sur les vieilles obligations grecques.
Ces 40 milliards, c'est une partie du second programme de sauvetage de 2012 – signé après la restructuration de la dette privée (voir Grèce : les banques se sauvent, le désastre est toujours là) –, qui était d’environ 170 milliards, dont 50 milliards pour la recapitalisation des banques.
Mais il y a un autre problème. Dans le cadre de ce plan, les fonds publics (caisses de retraite, fonds de sécurité sociale, etc.) ont subi des pertes presque aussi importantes que les banques, si ce n’est plus, qui ont touché leurs réserves. Parce qu’ils ont été forcés, selon la loi, d’apporter leurs réserves à la banque centrale de Grèce et que la Banque centrale avait le droit d’utiliser ces fonds pour acheter des obligations en leur nom.
Pour moi, cela a été un énorme scandale. Il semble que beaucoup d’hommes politiques, des banquiers, de nombreuses personnes averties, qui détenaient des obligations qu’ils avaient achetées à 20 % de leur valeur nominale, sont allés les apporter à la banque de Grèce. Et celle-ci les a remboursés sur la base de 100 % de la valeur. Ils ont eu leur argent et tout le fardeau de la décote a été transféré au public.
Ces fonds ont été forcés d’utiliser leurs réserves pour acheter les obligations d’État qui avaient perdu 70 % de leur valeur. Ces fonds, les fonds de retraite, sont confrontés aujourd’hui à un problème plus grave que les banques. Les fonds de retraite doivent planifier sur 15 à 20 ans pour être capables de payer les retraites, alors que la population âgée augmente et que la population active diminue. Ils doivent aussi verser les allocations chômage, etc. Aussi, tous ces verrous de dette reviennent à la surface en même temps.
Dès la fin février, en tout cas au milieu du mois de mars, il était évident que les créanciers n’allaient pas respecter l’accord du 20 février, qui prévoyait que la Grèce propose ses réformes et que la Troïka – les Institutions comme on les appelle maintenant – les évalue et donne son accord. Rien ne s’est passé comme cela.
Les Institutions ont constamment rejeté toutes les propositions de réforme sans les regarder. Varoufakis leur disait : « Laissez-nous compléter quatre ou cinq réformes sur lesquelles nous sommes tous d’accord et que nous considérons comme nécessaires, laissez-nous les mettre en œuvre et vous pourrez les évaluer et donner une appréciation. » Ils ont tout refusé en disant : « Non, non, nous avons besoin d’un accord-cadre global avant que vous lanciez ces réformes. Si vous mettez en œuvre ces réformes, ce sera une action unilatérale. Nous ne les avons pas encore approuvées – OK, nous sommes d’accord – mais nous n’avons pas encore arrêté l’excédent primaire budgétaire. »
Nous étions dans l’incapacité de faire quoi que ce soit. Dans le même temps, ils voulaient voir nos livres, les comptes des finances publiques au ministère des finances, ceux de la banque centrale, parce qu’ils n’avaient pas confiance dans nos chiffres. Varoufakis leur disait : « Revenons à l’accord du 20 février. Vous vous êtes engagés à ne plus superviser l’économie grecque. Et vous ne nous aidez pas à assurer la viabilité de l’économie afin de retrouver progressivement la croissance. C’était l’objectif de l’accord du 20 février, une extension du programme [d’aide] existant. Nous amendons, évaluons, complétons le programme au cours de ces quatre mois. Le 30 juin, le programme est fini. » Mais ils ont débranché les banques. Le 30 juin, le programme s’est arrêté. Et nous ne sommes plus dans aucun programme.
Et tout cet argent qu’ils nous doivent ! Environ 17 milliards d’euros, dont 10 milliards dans le cadre du fonds de stabilité financière qui, selon l’accord du 20 février, devaient nous être reversés. Nous n’avons pas reçu un centime depuis juin de l’an dernier. Depuis douze mois nous avons payé environ 10 milliards à nos créanciers, en tirant sur nos seules ressources, sans recevoir un seul euro de leur part, alors qu’ils avaient accepté de les donner, sous conditions bien sûr.
Une torture financière et budgétaire
Tous les prêts que nous avons reçus – 240-250 milliards – sont allés au service de la dette, et sont donc revenus aux créanciers. Le premier plan de sauvetage a été un sauvetage des banques et un transfert vers l’État. Nous n’avons reçu aucune aide financière pour les payer. Nous ne pouvions pas emprunter à court terme. Nous ne pouvions prendre aucune mesure pour améliorer la liquidité de l’économie : la BCE a imposé des restrictions, les unes après les autres. C’est ce que j’appelle depuis le début l’étranglement par le crédit.
À la mi-mars, certaines sources bruxelloises ont dit : « Oui, les Institutions (BCE, FMI, Commission) utilisent le crédit pour vous asphyxier, afin de forcer le gouvernement à se soumettre et à accepter les réformes. Faites-le vite. » Pour moi, c’était admettre qu’ils utilisaient le pire des moyens de chantage économique contre le pays. La pire des sanctions économiques. Voyez comment ça s’est passé en Irak ; au lieu d’imposer un embargo commercial, les Américains auraient pu dire : « Nous coupons tous vos actifs, vos banques n’ont plus d’argent, plus de dollars, plus rien, vous ne devez compter que sur les seuls billets de banque, vous allez avoir des restrictions. » Mais ils n’ont pas fait cela en Irak. Il y a eu un embargo commercial, pas une asphyxie organisée financière ou du crédit. Parce qu’à un moment, graduellement, c’est la mort. On ne peut survivre à un tel traitement très longtemps. Varoufakis a appelé cela le supplice de la baignoire (waterboard). Une torture financière et budgétaire.
J’ai dit à Varoufakis : « Nous devons faire savoir qu’ils sont en train de commettre un crime équivalent à un crime contre l’humanité. Toute l’économie du pays est détruite. Les gens sont pauvres et sans logis, y compris les enfants. C’est cela la situation. Ces faits ont été conduits de façon intensive pour conduire à une forme de chantage qui est un crime par rapport aux lois internationales, aux traités européens. Nous ne pouvons continuer comme cela car cela reviendrait à ce que nous légitimions ce crime. » Pour moi, c’est abominable. Ce n’est pas une négociation, c’est un acte de torture, comme s’ils nous demandaient de donner les noms des partisans.
Malheureusement, Varoufakis croit encore, croit toujours qu’il peut les raisonner, les amener à négocier. La seule solution qu’il reste aux Institutions est de pousser la crise à son paroxysme, et après de décider. Décideront-ils ou non de mener l’économie grecque à l’effondrement ?
Le gouvernement pensait qu'aller jusqu’à l’effondrement de l’économie grecque provoquerait l’effondrement de l’économie mondiale. Cela ne s’est pas produit et j’en suis navré. J’ai suivi l’évolution de l’euro, comment il a réagi face à leurs expérimentations. Schäuble [ministre allemand des finances – ndlr] et Berlin sont intelligents. Ils ont alimenté artificiellement la crise : « Les Grecs ne sont pas coopératifs. Ils n’ont pas compris ce qu’il faut faire. Ils ne donnent aucun chiffre. » Or, au lieu de chuter, l’euro a monté. Cela a été pareil sur les marchés boursiers.
Ce n’est qu’au cours de la dernière semaine [avant le référendum – ndlr] que les responsables grecs ont pris la mesure de ce qui se passait. Varoufakis a fait plusieurs déclarations à ce sujet, disant que nous devions nous adresser à la Cour européenne de justice. Mais une fois que la crise a explosé, les arguments légaux ne sont plus d’aucun secours.
J’avais dit que Tsipras devait aller au parlement européen et révéler publiquement la façon dont ils étaient traités ces derniers mois, et pourquoi il refusait de mettre en œuvre ces mesures d’austérité, pourquoi il préférait perdre les élections que d’instaurer ces mesures. Chaque fois qu’ils ont essayé de mener des négociations politiques, ils se sont fait balader. Vingt fois avec Merkel, cinq fois avec Schäuble. Combien de réunions de l’Eurogroupe se sont terminées par « retournez vers les équipes techniques, retournez vers la Troïka » ? Les Grecs ont demandé une décision politique. Il leur a été répondu : « Notre décision politique est d’en référer aux équipes techniques. Vous ne pouvez avoir de décision politique sans une décision technique. »
À chaque étape, ils ont essayé de détruire le prestige qu’avait gagné le gouvernement grec au cours du premier mois de la négociation. À cette période, les Européens disaient : « C’est un nouvel espoir pour l’Europe, pour l’Allemagne, l’Espagne. Les Grecs nous montrent le chemin. » S’ils avaient dit d’emblée : « C’est fini. Nous n’acceptons plus de négocier », ce qu’ils ont dit indirectement à Dijsselbloem [ministre des finances des Pays-Bas, patron de l’Eurogroupe – ndlr] par exemple, cela aurait été clair. Nous serions allés au clash. Mais ils n’ont pas fait cela. Il y a eu un Eurogroupe, un autre Eurogroupe, des réunions de travail et encore et toujours des Eurogroupe… les Européens ont créé une foule de pseudo-négociations. Du temps perdu qui a été gagné de leur côté. Pendant tout ce temps, ils ont mené campagne contre Varoufakis, l’ont assassiné médiatiquement. Et lui continuait à négocier. Qu’espérait-il ?
Nous en sommes là. Nous avons perdu tout appui économique pour trouver les termes d’un nouvel accord et perdu toute crédibilité pour les forcer à négocier avec nous. Le gouvernement Tsipras dit que quand ils nous ont présenté l’ultimatum, l’accord à prendre ou à laisser, celui-ci comportait des mesures pires que celles qu’ils avaient exigées du précédent gouvernement. L’aile droite du gouvernement, Tsipras et Varoufakis, se sont dit « soit nous allons au parlement avec la répétition du scénario chypriote : avec dans le week-end la BCE qui dit au parlement : "vous prenez des mesures ou lundi il n’y a plus de banque" ». Soit ils faisaient ce qu’ils ont fait, ce qui était le bon mouvement : ils allaient au référendum, ce qui impliquait qu’ils auraient à endurer ce qui s’est passé à Chypre pour une semaine.
Ils pensent que la situation rapprochera du terme d’un accord. Mais les Européens n’en ont rien à faire d’une crise mondiale ou européenne, ou même d’un effondrement. Oui, les bourses ont chuté, oui, il y a eu des fluctuations monétaires, la livre a monté. Mais à la fin, les Européens ne sont pas plus prêts à trouver un accord qu’auparavant.
Varoufakis et Tsipras disaient qu’en cas de victoire du non, leur position serait renforcée pour en finir avec ce type d’accord qui exclut une restructuration de la dette ou l’ajustement budgétaire. Car aujourd’hui les sommes dues par les Européens (17 milliards d’euros), plus 16 (ou 20 milliards) par le FMI sont perdues, le programme est fini. Et un nouvel accord est nécessaire. La première chose à faire est d’aller quémander des fonds d’urgence auprès de la BCE. Mais les Européens disent qu’ils ont besoin de retourner devant leur parlement, etc. Une recapitalisation (des banques) s’impose pourtant pour faire fonctionner à nouveau l’économie. C’est la condition première pour établir un nouveau programme.
Faire savoir au monde entier que l’Eurozone est en train de commettre un crime contre l’humanité
En même temps, même discuter d’un Grexit est problématique – c’est illégal puisqu’il n’existe aucune disposition dans les traités qui l’autorise –, mais les Européens n’ont pas osé utiliser cet argument. Il n’y a aucune garantie que la sortie de l’euro pour la Grèce puisse se faire de manière ordonnée, négociée, pacifique, plutôt que de façon désordonnée avec des gens courant dans les magasins pour faire des provisions. Si un processus de sortie de l’euro n’est pas mis en place, alors la sortie est une arme de destruction massive. Si vous menacez quelqu’un d’une sortie de l’euro, vous poussez aux limites la résistance du système bancaire, alors vous détruisez rapidement le système bancaire et après vous fouillez dans les ruines pour créer une nouvelle monnaie, qui prendra des mois avant d’apparaître.
Ils ont dit que ce serait destructeur et désastreux pour nous, comme cela l’est pour vous. D’abord, je ne suis pas d’accord avec cette position. C’est un chantage. Et cela permet aux autres de nous accuser de chantage. C’est ridicule d’accuser un pays détruit pendant cinq ans de chantage. C’est un mauvais argument. Le bon argument est que la sortie de la Grèce de l’euro, comme toutes les autres mesures que les Grecs ont subies, est illégale au regard de la loi internationale, des lois du travail, des traités européens, de la déclaration européenne des droits de l’homme, de la déclaration européenne du travail. Début 2014, le parlement européen avait commencé à attaquer la Troïka, en lui reprochant son illégalité, d’imposer des mesures qui détruisaient les droits de l’homme, les droits du travail… Mais nous avions un gouvernement qui ne voulait pas entendre parler de cela. Il préférait attaquer l’opposition plutôt que les créanciers. Il n’a pas vu que c’était l’arme la plus puissante que nous avions.
Quand vous êtes du côté des faibles, il n’y a que deux voies : l’une est celle de la loi – en appeler à la légitimité –, l’autre est celle de la vérité – qui est dans le vrai, qui est dans le faux dans ses arguments et au regard des droits de l’homme. Selon la loi, tous les hommes sont égaux. C’est le fondement de la démocratie représentative. Aussi, si vous en appelez à la Cour européenne de justice en disant « je ne suis pas traité équitablement en tant que membre de l’Union européenne, de l’Otan », ils ne peuvent ignorer votre cause.
Mais si vous empruntez la voie légale, cela peut être très long. Alors je ne pense pas à cela. Vous devez atteindre la délégitimation politique : faire savoir au monde entier que l’Eurozone est en train de commettre un crime contre l’humanité. Le prouver dans dix ans, cela m’indiffère. Mais si vous déposez votre dossier devant la Cour et que vous dites : « Jusqu’à ce vous ayez examiné le dossier, ces mesures doivent cesser »…
Aujourd’hui c’est trop tard. C’est une question d’hégémonie politique et idéologique. Au début, Varoufakis seul, avec ses arguments, a entrepris de renverser l’opinion publique en Europe et même en Allemagne. Les responsables de l’Eurogroupe ont riposté. Au début de février, Dijsselbloem a dit à Varoufakis : « Soit vous signez le mémorandum, soit votre économie va s’effondrer. Comment ? Nous allons faire tomber vos banques. » Le président de l’Eurogroupe a dit cela. Dans son dernier entretien à la télévision publique grecque, il y a deux jours, Yanis Varoufakis a expliqué : « Je n’ai pas dénoncé ces propos à l’époque parce que j’espérais que la raison prévaudrait dans les négociations. »
Alors pourquoi n'avons-nous pas été soutenus ? Tout simplement parce que l'Eurogroupe n’est pas un organe qui fonctionne de façon démocratique. Ils [le gouvernement grec] l’ont découvert à nouveau trop tard quand les Européens ont voulu exclure Varoufakis après l’annonce du référendum. Il y avait une volonté d’humiliation. Varoufakis a demandé : « Qui a décidé cela ? » Dijsselbloem lui a répondu : « J’ai décidé. » N’y aurait-il pas dû y avoir un vote ? Cette décision n’aurait-elle pas dû être prise à l’unanimité ? Dans un fonctionnement normal, bien sûr. Mais à l’Eurogroupe, ce n’est pas nécessaire, parce qu’il n’y a aucun compte-rendu écrit. Aussi, il n’y a rien de formel. Quand un responsable sort de l’Eurogroupe, il peut raconter ce qu’il veut. Personne ne peut dire : « Avez-vous vraiment dit cela ? Regardons le compte-rendu. » Il n’y a pas de minutes des débats.
Varoufakis a dit qu’il avait enregistré les réunions, parce qu’il devait rapporter au premier ministre et aux autres membres du gouvernement ce qu’il s’y disait. Les autres ont crié. Il a décrit des incidents qui prouvent que l’Eurozone est totalement non démocratique, presque néofasciste. Trop discuter avec Schäuble peut être dangereux, parce que vous risquez de ne pas obtenir les financements. Les banques allemandes veulent leur argent. C’est une organisation où vous ne pouvez pas faire entendre votre voix. Personne d’autre que Varoufakis n'a parlé ouvertement. Schäuble a dit : « Combien voulez-vous pour quitter l’euro ? » Il ne veut pas de la Grèce dans l’euro. Il a été le premier à parler de la sortie de la Grèce en 2011.
Nous sommes partis à la bataille en pensant que nous avions les mêmes armes qu’eux. Nous avons sous-estimé leur pouvoir. C’est un pouvoir qui s’inscrit dans une vraie fabrique de société, dans la façon de penser des gens. Il se fonde sur le contrôle et le chantage. Nous avons très peu de leviers face à lui. L’édifice européen est kafkaïen.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Paul de Grauwe: «Le Grexit peut se produire dans la catastrophe»
07 juillet 2015 | Par Ludovic Lamant
« Certains veulent utiliser la BCE comme un instrument pour forcer le Grexit », s'inquiète l'universitaire belge Paul de Grauwe dans un entretien à Mediapart. Une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro doit se tenir mardi soir à Bruxelles.
Bruxelles, de notre envoyé spécial.- Paul de Grauwe est un économiste belge, professeur à la London School of Economist (LSE) et à l'université catholique de Louvain. Très critique sur le rôle des créanciers, et du FMI en particulier, dans les négociations des dernières semaines avec la Grèce, De Grauwe, également chroniqueur étiqueté libéral dans plusieurs journaux belges, revient sur l'après référendum grec, dans un entretien à Mediapart. « La réponse des citoyens grecs dimanche a été tellement forte, que cela aurait pu convaincre certains créanciers de revoir leurs positions. Sauf que la dynamique de méfiance est telle, aujourd'hui, que tout cela est devenu très difficile », regrette-t-il, en amont d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, mardi soir à Bruxelles.
Y a-t-il encore une voie pour éviter le Grexit ?
Bien sûr, s'il y a de la bonne volonté. Mais aujourd'hui, la confiance mutuelle est tellement faible… Certains ne veulent pas aboutir. Ils veulent utiliser la BCE comme un instrument pour forcer le Grexit. Si la BCE ne fournit plus de liquidités aux banques grecques, la Grèce sera forcée de sortir. C'est la stratégie de certains.
C'est comme cela que vous interprétez la décision de la BCE, lundi, de durcir les conditions d'accès, pour les banques grecques, au fonds d'urgence ?
Oui, c'est une décision que je ne comprends pas. La BCE, par ses statuts, est indépendante. L'un de ses objectifs, c'est la stabilité financière. Quand un système bancaire d'un pays de la zone euro connaît une implosion, il y va de sa responsabilité de pourvoir aux liquidités. Et là, elle refuse de le faire. Il doit donc y avoir des objectifs politiques : c'est en tout cas mon interprétation. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la tâche d'une banque centrale de s'immiscer dans le jeu politique.
À qui pensez-vous, quand vous parlez de « certains » qui veulent sortir la Grèce de l'euro ?
Je n'ai pas d'information concrète. Mais il est clair que la pression vient de Berlin, et d'autres capitales.
Il y a plusieurs scénarios possibles pour un Grexit. Lequel à vos yeux serait le moins violent ?
Tous les scénarios seront compliqués. Idéalement, on devrait se retrouver autour de la table, et mettre en place un Grexit contrôlé. Mais la suspicion est telle, et les attitudes négatives sont telles, désormais, que je ne crois pas que l'on puisse aboutir à un consensus. Cela se fera dans la catastrophe.
Alexis Tsipras n'est-il pas en partie responsable de ce climat de suspicion, après avoir lancé un référendum alors que les négociations se poursuivaient encore ?
Les responsabilités sont certainement partagées. Le gouvernement grec n'a pas cherché, à pratiquement aucun moment de la négociation, à conclure de vraies alliances avec d'autres. Il a adopté un style de confrontation, qui a rendu le dialogue très difficile. Maintenant, est-ce que le référendum en soi était une erreur ? Ma première réaction, ça a été de le penser. Mais la réponse des citoyens grecs dimanche a été tellement forte, que cela aurait pu convaincre certains créanciers de revoir les positions qu'ils avaient prises auparavant. Sauf que la dynamique de méfiance est telle, aujourd'hui, que tout cela est devenu très difficile.
Parmi les scénarios du Grexit, on parle d'une monnaie parallèle, indexée d'une manière ou d'une autre à l'euro, et qui permettrait un retour de la Grèce dans l'eurozone à terme… Qu'en pensez-vous ?
C'est de la science-fiction. Quand la Grèce sortira de la zone euro, ce sera une sortie définitive. Je ne crois pas à une sortie temporaire. Les divorces temporaires, ça n'existe pas. C'est tellement traumatisant, que les deux partenaires ne veulent plus s'y risquer. On est en train de pousser la Grèce de façon très violente hors de la zone euro.
En cas de Grexit, comment mesurez-vous les risques de propagation ?
À court terme, ces risques seront relativement limités. Ils peuvent être maîtrisés. Parce que la BCE, encore elle, va pourvoir aux liquidités nécessaires aux pays qui seront attaqués par les marchés. Bien sûr, si la BCE fait la même chose que ce qu'elle a fait avec la Grèce, il y aura un problème… Mais a priori, avec le programme dit “OMT” de 2012, elle s'est engagée à pourvoir aux liquidités en temps de crise.
À plus long terme, c'est une autre histoire. L'union monétaire n'est plus une union permanente. Ce sera une union temporaire. Et quand il y aura de nouveaux chocs économiques, comme des tremblements de terre qui reviennent, des pays auront l'option de sortir, comme la Grèce avant eux. Cela renforcera fortement l'instabilité. Exactement comme à l'époque où nous avions un système de taux de change fixes : chacun avait l'option de sortir, et c'était très instable.
07 juillet 2015 | Par Ludovic Lamant
« Certains veulent utiliser la BCE comme un instrument pour forcer le Grexit », s'inquiète l'universitaire belge Paul de Grauwe dans un entretien à Mediapart. Une réunion des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro doit se tenir mardi soir à Bruxelles.
Bruxelles, de notre envoyé spécial.- Paul de Grauwe est un économiste belge, professeur à la London School of Economist (LSE) et à l'université catholique de Louvain. Très critique sur le rôle des créanciers, et du FMI en particulier, dans les négociations des dernières semaines avec la Grèce, De Grauwe, également chroniqueur étiqueté libéral dans plusieurs journaux belges, revient sur l'après référendum grec, dans un entretien à Mediapart. « La réponse des citoyens grecs dimanche a été tellement forte, que cela aurait pu convaincre certains créanciers de revoir leurs positions. Sauf que la dynamique de méfiance est telle, aujourd'hui, que tout cela est devenu très difficile », regrette-t-il, en amont d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, mardi soir à Bruxelles.
Y a-t-il encore une voie pour éviter le Grexit ?
Bien sûr, s'il y a de la bonne volonté. Mais aujourd'hui, la confiance mutuelle est tellement faible… Certains ne veulent pas aboutir. Ils veulent utiliser la BCE comme un instrument pour forcer le Grexit. Si la BCE ne fournit plus de liquidités aux banques grecques, la Grèce sera forcée de sortir. C'est la stratégie de certains.
C'est comme cela que vous interprétez la décision de la BCE, lundi, de durcir les conditions d'accès, pour les banques grecques, au fonds d'urgence ?
Oui, c'est une décision que je ne comprends pas. La BCE, par ses statuts, est indépendante. L'un de ses objectifs, c'est la stabilité financière. Quand un système bancaire d'un pays de la zone euro connaît une implosion, il y va de sa responsabilité de pourvoir aux liquidités. Et là, elle refuse de le faire. Il doit donc y avoir des objectifs politiques : c'est en tout cas mon interprétation. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la tâche d'une banque centrale de s'immiscer dans le jeu politique.
À qui pensez-vous, quand vous parlez de « certains » qui veulent sortir la Grèce de l'euro ?
Je n'ai pas d'information concrète. Mais il est clair que la pression vient de Berlin, et d'autres capitales.
Il y a plusieurs scénarios possibles pour un Grexit. Lequel à vos yeux serait le moins violent ?
Tous les scénarios seront compliqués. Idéalement, on devrait se retrouver autour de la table, et mettre en place un Grexit contrôlé. Mais la suspicion est telle, et les attitudes négatives sont telles, désormais, que je ne crois pas que l'on puisse aboutir à un consensus. Cela se fera dans la catastrophe.
Alexis Tsipras n'est-il pas en partie responsable de ce climat de suspicion, après avoir lancé un référendum alors que les négociations se poursuivaient encore ?
Les responsabilités sont certainement partagées. Le gouvernement grec n'a pas cherché, à pratiquement aucun moment de la négociation, à conclure de vraies alliances avec d'autres. Il a adopté un style de confrontation, qui a rendu le dialogue très difficile. Maintenant, est-ce que le référendum en soi était une erreur ? Ma première réaction, ça a été de le penser. Mais la réponse des citoyens grecs dimanche a été tellement forte, que cela aurait pu convaincre certains créanciers de revoir les positions qu'ils avaient prises auparavant. Sauf que la dynamique de méfiance est telle, aujourd'hui, que tout cela est devenu très difficile.
Parmi les scénarios du Grexit, on parle d'une monnaie parallèle, indexée d'une manière ou d'une autre à l'euro, et qui permettrait un retour de la Grèce dans l'eurozone à terme… Qu'en pensez-vous ?
C'est de la science-fiction. Quand la Grèce sortira de la zone euro, ce sera une sortie définitive. Je ne crois pas à une sortie temporaire. Les divorces temporaires, ça n'existe pas. C'est tellement traumatisant, que les deux partenaires ne veulent plus s'y risquer. On est en train de pousser la Grèce de façon très violente hors de la zone euro.
En cas de Grexit, comment mesurez-vous les risques de propagation ?
À court terme, ces risques seront relativement limités. Ils peuvent être maîtrisés. Parce que la BCE, encore elle, va pourvoir aux liquidités nécessaires aux pays qui seront attaqués par les marchés. Bien sûr, si la BCE fait la même chose que ce qu'elle a fait avec la Grèce, il y aura un problème… Mais a priori, avec le programme dit “OMT” de 2012, elle s'est engagée à pourvoir aux liquidités en temps de crise.
À plus long terme, c'est une autre histoire. L'union monétaire n'est plus une union permanente. Ce sera une union temporaire. Et quand il y aura de nouveaux chocs économiques, comme des tremblements de terre qui reviennent, des pays auront l'option de sortir, comme la Grèce avant eux. Cela renforcera fortement l'instabilité. Exactement comme à l'époque où nous avions un système de taux de change fixes : chacun avait l'option de sortir, et c'était très instable.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Dogue-son a écrit:bijams a écrit:Ça a réussi à l'Islande.
Donc les grecs doivent revenir au Drachme ?
l'Islande n'est pas dans l'UE et n'a donc jamais eu l'Euro.
hé.........
hé ........
hé.......
hééééééééééééééééééééééééééé
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM !
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
j'aime bien les couleurs.
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
karmelille a écrit:Dogue-son a écrit:bijams a écrit:Ça a réussi à l'Islande.
Donc les grecs doivent revenir au Drachme ?
l'Islande n'est pas dans l'UE et n'a donc jamais eu l'Euro.
hé.........
hé ........
hé.......
hééééééééééééééééééééééééééé
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM !
Bah nan justement. Je sais très bien que L'Islande n'a pas l'euro, c'est pour ça que j'écris "retour du Drachme" pour la Grèce...
Je faisais plus référence à la dévaluation en elle-même.
L'Islande avait connu une croissance importante uniquement grâce à la bulle financière.
La Grèce n'a même pas connu la croissance ou si peu, si l'on regarde les graphiques ci-dessus.
Ce qui montre aussi que la comparaison qui est souvent faite avec l'Espagne ou l'Italie n'a pas de sens
La Grèce n'a même pas connu la croissance ou si peu, si l'on regarde les graphiques ci-dessus.
Ce qui montre aussi que la comparaison qui est souvent faite avec l'Espagne ou l'Italie n'a pas de sens
I used to be a fan. Now I'm an air conditioner
bijams a écrit:Et est-ce que Dogue-son et Fernando se sont déjà fait pomper la colonne par 2 gonzesses ?
Enfin de la vraie poli-trique !
merci bij' de recentrer ce débat (qui putain était d'un chiant ....)
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup de douleurs pour peu de résultats (Desproges)
La colonne de Rhodes
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
Never give up, never surrender
Affaire Adidas : Bernard Tapie réclame un milliard d’euros à l’Etat
Le Monde.fr | 09.07.2015 à 08h57 • Mis à jour le 09.07.2015 à 09h58 | Par Fabrice Lhomme et Gérard Davet
Bernard Tapie, 72 ans, repart au combat avec son nouvel avocat, Me Emmanuel Gaillard, l’homme qui a obtenu, en juillet 2014, la condamnation de l’Etat russe à une amende de 50 milliards de dollars dans son conflit avec Ioukos.
Un attelage redoutable qui va réclamer à l’Etat, le 29 septembre, devant la cour d’appel de Paris, la somme record d’un milliard d’euros, agrémentée d’intérêts courant sur plus de vingt ans. Toujours, bien sûr, dans le cadre de la revente d’Adidas en 1993 qui a donné lieu à un interminable litige entre l’homme d’affaires et le Crédit lyonnais et le CDR, l’organisme mis en place par l’Etat en 1995 pour apurer le passif de la banque. Bernard Tapie estime avoir été floué par sa banque, accusée d’avoir encaissé de fortes plus-values dans son dos.
Pertes et profits
L’arbitrage suspect, qui vaut à l’homme d’affaires une double mise en examen, est désormais passé par pertes et profits. Bernard Tapie a été interrogé à deux reprises par le juge Serge Tournaire. Et semblé admettre ses torts, en reconnaissant ce qu’il avait d’abord démenti dans ses interrogatoires devant les policiers. Oui, il a sollicité Nicolas Sarkozy et lui a rendu visite à 17 reprises, lui parlant plusieurs fois de l’arbitrage souhaité. « Est-ce que l’arbitrage pouvait avoir lieu sans que Nicolas Sarkozy donne son accord ? La réponse est non », lâche-t-il même au juge, le 10 mars.
Oui, aussi, la désignation par son avocat Me Maurice Lantourne du juge arbitre Pierre Estoup, qui concentre toutes les suspicions, n’était pas une bonne idée : « Ils se sont rencontrés, ils se sont consultés, a indiqué M. Tapie. (…) M. Estoup a eu incontestablement des contacts avec M. Lantourne avant. Aucun avocat n’est assez sot pour désigner un arbitre qui lui soit hostile. » Or, M. Estoup – soumis à une obligation de « révélation étendue » – avait omis de signaler ces liens de proximité.
Emmanuel Gaillard s’attaque désormais au fond du conflit ; il a mis la main sur un document, signé par un banquier mandaté par le Crédit lyonnais et daté du 1er février 1993, qu’il juge essentiel, car à même de prouver que la banque a sciemment trompé son client, Bernard Tapie. Selon Me Gaillard, cette note démontrerait que « dès le départ, la banque avait imaginé de capter la plus-value résultant de la mise en bourse d’Adidas à un montant qui pouvait atteindre 11 milliards de francs (2,09 milliards d’euros) ». Or, M. Tapie avait revendu Adidas à un pool d’actionnaires pour « seulement » 318 millions d’euros, en février 1993.
Deuxième front
Une thèse vivement contestée par Me William Bourdon, qui représente les intérêts de l’Etat : « Nous restons confiants quant à l’issue positive de la procédure tant les preuves de l’énorme boniment d’origine sont accablantes, c’est-à-dire la créance inventée de M. Tapie sur le Crédit lyonnais. »
Sur un deuxième front, Bernard Tapie a demandé à l’un de ses conseils, Me Thierry Lévy, de déposer une plainte pour « faux, usage de faux, faux en écriture publique, escroquerie et tentative d’escroquerie », contre le commandant de police Yves-Marie L’Hélias, en poste à la brigade financière. La plainte devait être déposée jeudi 9 juillet, auprès du parquet de Paris.
L’homme d’affaires n’a jamais digéré le rapport de synthèse rédigé par le policier un an plus tôt, le 9 juillet 2014. La conclusion de ce rapport – révélé par Le Monde le 11 septembre 2014 – établi sur la base de centaines de documents, était sans appel : « Les faits ayant pu être établis par les investigations ne permettent pas de donner crédit à la thèse de M. Tapie et aux conclusions des arbitres. »
Affaire Adidas : Bernard Tapie réclame un milliard d’euros à l’Etat
Le Monde.fr | 09.07.2015 à 08h57 • Mis à jour le 09.07.2015 à 09h58 | Par Fabrice Lhomme et Gérard Davet
Bernard Tapie, 72 ans, repart au combat avec son nouvel avocat, Me Emmanuel Gaillard, l’homme qui a obtenu, en juillet 2014, la condamnation de l’Etat russe à une amende de 50 milliards de dollars dans son conflit avec Ioukos.
Un attelage redoutable qui va réclamer à l’Etat, le 29 septembre, devant la cour d’appel de Paris, la somme record d’un milliard d’euros, agrémentée d’intérêts courant sur plus de vingt ans. Toujours, bien sûr, dans le cadre de la revente d’Adidas en 1993 qui a donné lieu à un interminable litige entre l’homme d’affaires et le Crédit lyonnais et le CDR, l’organisme mis en place par l’Etat en 1995 pour apurer le passif de la banque. Bernard Tapie estime avoir été floué par sa banque, accusée d’avoir encaissé de fortes plus-values dans son dos.
Pertes et profits
L’arbitrage suspect, qui vaut à l’homme d’affaires une double mise en examen, est désormais passé par pertes et profits. Bernard Tapie a été interrogé à deux reprises par le juge Serge Tournaire. Et semblé admettre ses torts, en reconnaissant ce qu’il avait d’abord démenti dans ses interrogatoires devant les policiers. Oui, il a sollicité Nicolas Sarkozy et lui a rendu visite à 17 reprises, lui parlant plusieurs fois de l’arbitrage souhaité. « Est-ce que l’arbitrage pouvait avoir lieu sans que Nicolas Sarkozy donne son accord ? La réponse est non », lâche-t-il même au juge, le 10 mars.
Oui, aussi, la désignation par son avocat Me Maurice Lantourne du juge arbitre Pierre Estoup, qui concentre toutes les suspicions, n’était pas une bonne idée : « Ils se sont rencontrés, ils se sont consultés, a indiqué M. Tapie. (…) M. Estoup a eu incontestablement des contacts avec M. Lantourne avant. Aucun avocat n’est assez sot pour désigner un arbitre qui lui soit hostile. » Or, M. Estoup – soumis à une obligation de « révélation étendue » – avait omis de signaler ces liens de proximité.
Emmanuel Gaillard s’attaque désormais au fond du conflit ; il a mis la main sur un document, signé par un banquier mandaté par le Crédit lyonnais et daté du 1er février 1993, qu’il juge essentiel, car à même de prouver que la banque a sciemment trompé son client, Bernard Tapie. Selon Me Gaillard, cette note démontrerait que « dès le départ, la banque avait imaginé de capter la plus-value résultant de la mise en bourse d’Adidas à un montant qui pouvait atteindre 11 milliards de francs (2,09 milliards d’euros) ». Or, M. Tapie avait revendu Adidas à un pool d’actionnaires pour « seulement » 318 millions d’euros, en février 1993.
Deuxième front
Une thèse vivement contestée par Me William Bourdon, qui représente les intérêts de l’Etat : « Nous restons confiants quant à l’issue positive de la procédure tant les preuves de l’énorme boniment d’origine sont accablantes, c’est-à-dire la créance inventée de M. Tapie sur le Crédit lyonnais. »
Sur un deuxième front, Bernard Tapie a demandé à l’un de ses conseils, Me Thierry Lévy, de déposer une plainte pour « faux, usage de faux, faux en écriture publique, escroquerie et tentative d’escroquerie », contre le commandant de police Yves-Marie L’Hélias, en poste à la brigade financière. La plainte devait être déposée jeudi 9 juillet, auprès du parquet de Paris.
L’homme d’affaires n’a jamais digéré le rapport de synthèse rédigé par le policier un an plus tôt, le 9 juillet 2014. La conclusion de ce rapport – révélé par Le Monde le 11 septembre 2014 – établi sur la base de centaines de documents, était sans appel : « Les faits ayant pu être établis par les investigations ne permettent pas de donner crédit à la thèse de M. Tapie et aux conclusions des arbitres. »
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
A quoi sert encore cette mascarade de la démocratie dite représentative en europe? A gerber.
Le Parlement européen apporte son soutien sous condition au traité transatlantique
Les députés européens disant leur opposition au traité transatlantique au Parlement européen, à Strasbourg, le 8 juillet. Les députés européens disant leur opposition au traité transatlantique au Parlement européen, à Strasbourg, le 8 juillet. VINCENT KESSLER / REUTERS
Reporté il y a un mois, le vote au Parlement européen sur le traité transatlantique (aussi connu sous les acronymes Tafta et TTIP) – cet accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis négocié en toute confidentialité depuis deux ans – a finalement pu avoir lieu, mercredi 8 juillet. Une majorité de députés européens ont accordé leur soutien au texte, sur lequel ils auront un pouvoir d’approbation – ou de veto – une fois sa rédaction achevée.
Les élus européens ont été 436 à soutenir le principe de cet accord, 241 à s’y opposer, tandis que 31 se sont abstenus. Evénement notable : les sociaux-démocrates, membres de la coalition majoritaire, ont approuvé le texte, et ce alors même qu’ils avaient été au cœur de la controverse qui avait conduit au report du vote il y a un mois.
Divisions sur les tribunaux d’arbitrage
Au centre des débats figurait en effet la question très controversée des tribunaux d’arbitrage privé, voulus par les Américains pour régler les différends entre les investisseurs et les Etats en vue de protéger les entreprises de la législation des Etats où elles s’installent. Ces instances d’arbitrage sont redoutées par un certain nombre d’acteurs en raison de l’existence de précédents en la matière qui ont conduit à la remise en question de législations environnementales, sociales ou sanitaires.
Afin d’éviter les abus, les sociaux-démocrates réclamaient une réforme du système quand les conservateurs, également membres de la coalition majoritaire, entendaient, eux, se contenter de demander d’y apporter certains ajustements. Le différend entre les groupes majoritaires avait conduit à une situation de blocage qui avait in fine provoqué le report du vote du texte.
Revirement social-démocrate
Coup de théâtre, mercredi : les députés sociaux-démocrates sont revenus sur leur position du mois de juin et ont finalement voté avec les conservateurs un amendement de compromis qui ne fait absolument pas mention de ces fameux tribunaux d’arbitrage.
Le Parlement accepte à la place « un nouveau système de règlement des litiges (…) où les affaires éventuelles seront traitées dans la transparence par des juges professionnels indépendants, nommés par les pouvoirs publics, en audience publique, et qui comportera un mécanisme d'appel ».
Ce mécanisme de compromis reste dangereux aux yeux de certains socialistes, dont ceux de la délégation française, des écologistes, de la gauche radicale et de l’extrême droite. Pour Yannick Jadot, eurodéputé français d’Europe Ecologie-Les Verts, « aucun argument économique » ne justifie la création de telles instances arbitrales. « Ça restera un outil au service des multinationales pour contourner les législations nationales et réduire notre capacité à réguler », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.
La résolution adoptée mercredi pose par ailleurs quelques garde-fous en posant comme principe l’exclusion de la culture ainsi que des services publics et audiovisuels du futur accord et en demandant que celui-ci garantisse la reconnaissance des indications géographiques protégées et la protection des données personnelles.
Le Parlement européen apporte son soutien sous condition au traité transatlantique
Les députés européens disant leur opposition au traité transatlantique au Parlement européen, à Strasbourg, le 8 juillet. Les députés européens disant leur opposition au traité transatlantique au Parlement européen, à Strasbourg, le 8 juillet. VINCENT KESSLER / REUTERS
Reporté il y a un mois, le vote au Parlement européen sur le traité transatlantique (aussi connu sous les acronymes Tafta et TTIP) – cet accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis négocié en toute confidentialité depuis deux ans – a finalement pu avoir lieu, mercredi 8 juillet. Une majorité de députés européens ont accordé leur soutien au texte, sur lequel ils auront un pouvoir d’approbation – ou de veto – une fois sa rédaction achevée.
Les élus européens ont été 436 à soutenir le principe de cet accord, 241 à s’y opposer, tandis que 31 se sont abstenus. Evénement notable : les sociaux-démocrates, membres de la coalition majoritaire, ont approuvé le texte, et ce alors même qu’ils avaient été au cœur de la controverse qui avait conduit au report du vote il y a un mois.
Divisions sur les tribunaux d’arbitrage
Au centre des débats figurait en effet la question très controversée des tribunaux d’arbitrage privé, voulus par les Américains pour régler les différends entre les investisseurs et les Etats en vue de protéger les entreprises de la législation des Etats où elles s’installent. Ces instances d’arbitrage sont redoutées par un certain nombre d’acteurs en raison de l’existence de précédents en la matière qui ont conduit à la remise en question de législations environnementales, sociales ou sanitaires.
Afin d’éviter les abus, les sociaux-démocrates réclamaient une réforme du système quand les conservateurs, également membres de la coalition majoritaire, entendaient, eux, se contenter de demander d’y apporter certains ajustements. Le différend entre les groupes majoritaires avait conduit à une situation de blocage qui avait in fine provoqué le report du vote du texte.
Revirement social-démocrate
Coup de théâtre, mercredi : les députés sociaux-démocrates sont revenus sur leur position du mois de juin et ont finalement voté avec les conservateurs un amendement de compromis qui ne fait absolument pas mention de ces fameux tribunaux d’arbitrage.
Le Parlement accepte à la place « un nouveau système de règlement des litiges (…) où les affaires éventuelles seront traitées dans la transparence par des juges professionnels indépendants, nommés par les pouvoirs publics, en audience publique, et qui comportera un mécanisme d'appel ».
Ce mécanisme de compromis reste dangereux aux yeux de certains socialistes, dont ceux de la délégation française, des écologistes, de la gauche radicale et de l’extrême droite. Pour Yannick Jadot, eurodéputé français d’Europe Ecologie-Les Verts, « aucun argument économique » ne justifie la création de telles instances arbitrales. « Ça restera un outil au service des multinationales pour contourner les législations nationales et réduire notre capacité à réguler », a-t-il dit lors d’une conférence de presse.
La résolution adoptée mercredi pose par ailleurs quelques garde-fous en posant comme principe l’exclusion de la culture ainsi que des services publics et audiovisuels du futur accord et en demandant que celui-ci garantisse la reconnaissance des indications géographiques protégées et la protection des données personnelles.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
matcheu a écrit:A part dans Koh Lanta bien sur.
Mais lol !
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
Magnifique cette 1ère expérience gouvernementale de gauche radicale dans la zone euro. Le gars va faire voter au Parlement 90% des mesures rejetées par référundum y'a pas une semaine. On lui accordera en retour une ristourne sur la dette globale, techniquement maquillée d'une manière ou d'une autre. Tout le monde de part et d'autre pourra ainsi présenter cela comme une victoire et espérer sauver la face.
Preuve est définitivement faite que :
- quand tu es surendetté, tu n'as plus la moindre souveraineté
- quand tu élèves artificiellement ton niveau de vie par l'endettement (ce qui est arrivé à la Grèce après son entrée dans l'euro et jusqu'en 2009), le retour de bâton fait sévèrement mal au derche. L'adhésion de la Grèce à la zone euro était une grosse erreur résultant d'amitiés politiques dans les cénacles européens et ne reposant sur une aucune réalité économique. Aujourd'hui tout le monde le paie cher, les grecs en 1er lieu et les autres pays. Les laisser sortir de l'euro coûterait sans doute encore plus cher.
- dans le contexte de souveraineté limitée de la zone euro, où les politiques économiques sont quasi-verrouillées par les traités européens, la seule question de fond méritant d'être débattue est "y rester ou pas". Pour le reste la marge de manoeuvre est tellement étroite que les différences se situent dans l'épaisseur du trait. Aux prochaines élections en Grèce, s'ils sont toujours au bout du rouleau ils tenteront ptet les néo-nazis après avoir essayé tout le reste, ou pourquoi pas un coup d'état militaire, comme au bon vieux temps.
Preuve est définitivement faite que :
- quand tu es surendetté, tu n'as plus la moindre souveraineté
- quand tu élèves artificiellement ton niveau de vie par l'endettement (ce qui est arrivé à la Grèce après son entrée dans l'euro et jusqu'en 2009), le retour de bâton fait sévèrement mal au derche. L'adhésion de la Grèce à la zone euro était une grosse erreur résultant d'amitiés politiques dans les cénacles européens et ne reposant sur une aucune réalité économique. Aujourd'hui tout le monde le paie cher, les grecs en 1er lieu et les autres pays. Les laisser sortir de l'euro coûterait sans doute encore plus cher.
- dans le contexte de souveraineté limitée de la zone euro, où les politiques économiques sont quasi-verrouillées par les traités européens, la seule question de fond méritant d'être débattue est "y rester ou pas". Pour le reste la marge de manoeuvre est tellement étroite que les différences se situent dans l'épaisseur du trait. Aux prochaines élections en Grèce, s'ils sont toujours au bout du rouleau ils tenteront ptet les néo-nazis après avoir essayé tout le reste, ou pourquoi pas un coup d'état militaire, comme au bon vieux temps.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Ca blase chez Mediapart.
Grèce: Tsipras multiplie les concessions à Bruxelles
10 juillet 2015 | Par Ludovic Lamant et Amélie Poinssot
Alexis Tsipras a fait parvenir ses engagements d'économies et de réformes aux créanciers, pour obtenir d'ici dimanche un nouveau plan d'aide. Il multiplie les concessions, sous la menace d'un « Grexit », mais aussi dans l'espoir de décrocher en retour des avancées sur le front de la dette. Le parlement grec se prononce vendredi sur ce « mémorandum », à la veille d'un Eurogroupe décisif.
C'est le document sur lequel vont se jouer les 48 heures à venir à Bruxelles, et une bonne partie de l'avenir de la Grèce – dans ou hors de la zone euro. Athènes a fait parvenir jeudi soir, en temps et en heure comme Alexis Tsipras s'y était engagé en début de semaine, sa liste d'« actions prioritaires ». En échange de quoi la Grèce espère obtenir un méga-prêt sur trois ans (jusqu'à 2018) auprès des institutions, chiffré à 53,5 milliards d'euros, pour éviter la sortie de la zone euro. Mais aussi des engagements des créanciers pour alléger, d'une manière ou d'une autre, sa dette.
Les concessions réalisées par Alexis Tsipras, déjà bien accueillies par certains dirigeants, comme François Hollande, après les pressions des États-Unis en début de semaine, laissaient penser vendredi après-midi qu'un accord était encore possible d'ici dimanche. Il s'agirait alors du troisième plan d'« aide » à la Grèce depuis le début de la crise en 2010. Mais rien n'est encore fait, et l'étape des ratifications par les parlements nationaux, en cas d'accord, s'annonce très délicate. Décryptage.
Alexis Tsipras a-t-il beaucoup « lâché » dans la dernière ligne droite ?
Le document envoyé jeudi soir par Athènes contient un ensemble de mesures d'austérité encore plus dures que ce qui était discuté jusqu'à présent. Elles portent sur 13 milliards d'euros d'économies budgétaires. Pour rappel, le programme qui était discuté ces dernières semaines portait sur 8,5 milliards d'euros, tandis que les ultimes mesures demandées, à la fin 2014, au gouvernement Samaras (droite-socialistes) avant qu'il ne tombe, ne dépassaient pas un milliard d'euros.
Mais il s'accompagne, en même temps, de nouveaux prêts européens qui devraient permettre de couvrir les besoins financiers du pays pendant trois ans. Il s'accompagne également d'un budget de développement : 35 milliards d'euros. Sauf que ces sommes correspondent en réalité aux fonds structurels européens prévus pour la Grèce sur la période 2014-2020 (c'est le vrai-faux « plan de relance » pour la Grèce présenté, il y a quelques semaines, par Jean-Claude Juncker, qui consiste à débloquer plus rapidement des fonds déjà budgétés…).
Dans ce nouveau plan – qui n'a encore rien de définitif puisqu'il doit encore être validé au niveau de l'Eurogroupe et de plusieurs parlements nationaux –, la plupart des lignes rouges posées initialement par le gouvernement Syriza ont été franchies. Mais il obtient quelques menues concessions qui devraient lui permettre de vendre le programme auprès du parti et de ses électeurs.
Sur la TVA, c'est un résultat mi-figue, mi-raisin. Le taux intermédiaire de TVA qui s'appliquait dans l'hôtellerie passe de 6,5 à 13 % ; celui de la restauration de 13 à 23 %. En compensation, les médicaments, livres et théâtre qui étaient imposés à hauteur de 6,5 % passent à un taux « super-réduit » de 6 %. La réduction qui s'appliquait sur les îles – comme ailleurs en Europe, voir notre article sur les taux de TVA – sera maintenue pour les îles les plus éloignées du continent, mais elle sera supprimée pour les îles les plus touristiques à la fin 2016. Athènes obtient donc le report de l'application de cette mesure, que les institutions voulaient au départ pour le début de cet été.
Sur le dossier des retraites, c'est également la politique austéritaire qui l'emporte, avec un calendrier toutefois plus lâche que celui exigé au départ : l'allocation « EKAS » attribuée aux petites retraites inférieures au seuil de pauvreté est maintenue jusqu'en janvier 2020. Après quoi une réforme du système des retraites devra être réalisée.
Mise en application progressive
Au sujet de la fiscalité au-delà de la TVA, plusieurs changements vont plutôt dans le sens d'une meilleure justice fiscale. Athènes propose l'augmentation voulue de l'impôt sur les entreprises, de 26 à 28 %. Le système des privilèges fiscaux dont bénéficiaient les agriculteurs devrait être, aussi, progressivement supprimé. La lutte contre la fraude fiscale devrait être renforcée. Enfin, et c'est une première en Grèce : le gouvernement annonce la suppression des exemptions fiscales dont bénéficiaient jusque-là les armateurs (mais c'est une réforme qui nécessite toutefois un changement de la Constitution).
Le gouvernement grec s'engage également à réformer l'administration publique et le secteur de la justice, et à améliorer la lutte contre la corruption – des objectifs déjà présents dans le mémorandum de février 2012, et dont plusieurs aspects ont déjà été mis en place. Mais dans un contexte de baisse généralisée des salaires et des effectifs depuis cinq ans, de telles réformes structurelles restent très délicates à mettre en place (nous le racontions, déjà, dans ce reportage en 2012).
Concernant le marché du travail, Athènes a dû abandonner son objectif de retour au salaire minimum originel, à 740 euros brut par mois (contre 580 depuis 2012). Mais elle obtient la réintroduction, dès le dernier trimestre 2015 et en collaboration avec le Bureau international du travail, des conventions collectives (elles aussi supprimées avec le mémorandum de 2012).
Quant aux privatisations des entreprises publiques et des biens de l'État que Syriza, dans sa campagne électorale, s'était engagé à interrompre, elles doivent reprendre immédiatement. En particulier, les ventes en cours des chemins de fer (TRAINOSE), des derniers terminaux du ports du Pirée et de Thessalonique, des aéroports régionaux et du terrain d'Elleniko (ancien aéroport d'Athènes et anciennes installations des JO 2004) doivent se poursuivre.
Du côté du gouvernement, on fait valoir que toutes ces mesures s'appliqueront progressivement. Que l'on a évité la mise en application immédiate. Et que tout cela constitue « un meilleur paquet pour la dette ». Mais rien ne garantit, pour l'heure, que l'exécutif Tsipras a remporté la partie sur la question de la dette. La version en grec envoyée aux médias hellènes est à ce titre légèrement différente du document officiel envoyé en anglais à Bruxelles : la copie grecque fait valoir que l'accord comportera la question de la dette (mais l'on ne parle pas d'effacement : le mot invoqué en grec signifie « régulation », « reprofilage »), tandis que le document anglais ne porte que sur les « actions prioritaires », autrement dit les mesures budgétaires.
Depuis cinq mois, on observe ce double langage entre Athènes et Bruxelles. L'accord comprendra-t-il, au bout du compte, une perspective pour une restructuration de la dette grecque ? C'est bien tout l'enjeu de ces négociations : c'est pour cela que Tsipras se bat, depuis qu'il est premier ministre. S'il l'obtient, alors ce sera une petite victoire politique.
Quelles sont les étapes d'ici dimanche soir ?
Les heures qui viennent sont décisives. Le nouveau ministre des finances grec a présenté mercredi une demande de prêt auprès du mécanisme européen de stabilité (MES), ce fonds d'urgence pour les pays de la zone euro, selon les conditions de l'article 13 du traité du MES. Conformément à cet article 13 (à lire ici), la commission européenne, en lien avec la BCE, doit maintenant rédiger trois rapports, l'un concernant les risques sur la stabilité financière de la zone euro, un autre censé évaluer les besoins en financement du pays en question, et un dernier, qui s'annonce décisif, sur la « soutenabilité » de la dette grecque. Tous ces rapports doivent être prêts pour samedi, et permettre aux dirigeants européens (et du MES) de prendre une décision.
Ce vendredi, les « institutions » (ex-Troïka) vont par ailleurs analyser les engagements envoyés jeudi soir par Athènes. Elles en feront un compte-rendu par oral ou par écrit à l'Eurogroupe, la réunion des ministres des finances, qui s'ouvre samedi à 15 heures, à Bruxelles. Entretemps, les négociateurs réunis au sein de l'« Euro working group », qui préparent les positions des ministres de l'Eurogroupe, se réuniront samedi matin.
En cas d'accord samedi, le sommet de la zone euro prévu dimanche après-midi ne fera qu'entériner les conclusions de l'Eurogroupe. Et dans la foulée, les 19 pourraient ensuite discuter d'un éventuel « prêt-relais » à la Grèce, pour couvrir les besoins de financement à très court terme (pour l'été). Mais les diplomates à Bruxelles insistent bien sur la chronologie : ce prêt-relais n'est envisageable que s'il y a eu accord, auparavant, sur le principe d'un méga-prêt d'ici 2018. En clair : sans accord préalable sur la « conditionnalité » et les réformes, hors de question d'envisager un énième prêt-relais pour faire face à l'urgence.
En cas de désaccord samedi, tous les scénarios resteront encore ouverts. Dimanche, après le sommet des dirigeants de la zone euro (à 19), un conseil européen exceptionnel (à 28) est aussi annoncé à Bruxelles, en début de soirée, qui pourrait alors préparer le terrain à un « Grexit » plus ou moins désordonné.
Vers une validation dès vendredi par le parlement grec ?
« Il faut bien comprendre que tout décaissement d'argent, de la part des créanciers, a pour préalable l'adoption d'une partie de ces 'actions prioritaires' présentées par les Grecs. Certaines actions législatives seront entreprises avant même qu'un éventuel accord ne soit conclu », expliquait vendredi matin un diplomate européen proche des discussions. C'est tout l'enjeu du vote, vendredi, au parlement grec : la nouvelle ébauche de « mémorandum » doit en effet déjà être votée dès ce vendredi 10 juillet en fin de journée au parlement grec…
Et c'est sous la menace exacerbée de « Grexit » que l'exécutif Tsipras a formulé cette liste de mesures, paradoxalement plus dure que ce qu'il avait accepté jusqu'à présent, et en dépit du « non » massif au référendum de dimanche. Devant le groupe parlementaire de Syriza ce vendredi matin, le premier ministre l'a rappelé : « Nous avions pour mandat de trouver un meilleur accord, mais nous n'avions pas pour mandat de sortir la Grèce de la zone euro. » Il a fermement appelé les députés de la gauche radicale à valider les propositions. « Le point où nous sommes arrivés, nous y sommes arrivés tous ensemble, a-t-il déclaré. Soit nous continuons tous ensemble, soit nous partons tous ensemble. » En clair, il met en jeu la démission de son gouvernement.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le chef de l'exécutif va selon toutes probabilités réussir à faire voter le plan par la Vouli, le parlement grec. Car si les députés de la « plateforme de gauche » de Syriza, courant favorable à la sortie de la zone euro, n'apportaient pas leur soutien, l'accord devrait en revanche bénéficier des voix des autres partis : Potami (centriste), PASOK (socialistes), et Nouvelle Démocratie (droite). Le premier ministre s'est en effet assuré au lendemain du référendum du soutien de l'opposition : les deux partis de la coalition gouvernementale ont signé avec les trois partis de l'opposition une déclaration commune pour trouver un accord à Bruxelles.
Paradoxalement, les 61,31 % de « non » auront renforcé Alexis Tsipras, mais ils lui imposent aussi, d'une certaine manière, un recentrage : le premier ministre grec ne représente plus seulement l'électorat de Syriza (36,34 % des suffrages aux élections de janvier), mais deux tiers de l'électorat grec.
Dès mardi, un observateur de premier plan des discussions à Bruxelles croyait discerner cette stratégie, pour le moins risquée : Tsipras, renforcé politiquement à Athènes, se sentirait davantage capable d'assumer des compromis difficiles avec l'Europe auprès de ses citoyens. « Les Grecs disent : nous sommes forts du soutien manifesté lors du vote de dimanche. Nous sommes aussi forts de la déclaration des cinq partis [signée lundi – ndlr] à Athènes. Donc on ne représente pas seulement 60 % [le score du "non" au référendum – ndlr], mais bien au-delà, et nous venons discuter, modestement. Ils n'ont pas eu d'attitude revancharde. Leur message, c'est : je suis plus fort qu'avant, je suis capable de passer des compromis », expliquait ce témoin des discussions.
Toutefois, l'adoption d'un tel mémorandum d'austérité, après un « non » si limpide aux mesures des créanciers du 25 janvier, et même si elle se fait en échange du maintien de la Grèce dans la zone euro – ce que souhaitent une majorité écrasante de Grecs –, ne sera pas sans conséquences politiques à Athènes. Il n'est pas à exclure que de nouvelles élections anticipées soient convoquées après l'été, afin d'assurer à l'exécutif une nouvelle légitimité.
Angela Merkel, le 8 juillet. Elle a exclu toute «décote» de la dette grecque.Angela Merkel, le 8 juillet. Elle a exclu toute «décote» de la dette grecque. © Reuters
Angela Merkel et le vote difficile du Bundestag
L'Allemagne fait partie des six pays de la zone euro où un vote du parlement est nécessaire, pour enclencher un nouveau programme d'aide à Athènes, aux côtés de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de l'Estonie et de la Finlande. À 48 heures du dénouement, c'est le nœud du problème : jusqu'où Angela Merkel est-elle prête à s'engager, et à prendre des risques politiques sur la scène intérieure allemande, pour maintenir la Grèce dans la zone euro ? La chancelière est confrontée, à domicile, à une opinion publique qui semble de plus en plus hostile à un troisième plan d'aide à la Grèce, surtout après le « non » au référendum grec de dimanche. Elle sait qu'il faudra en passer par un vote au Bundestag (sur le principe-même d'une nouvelle aide), qui pourrait la malmener.
Dans sa famille politique, la CDU-CSU, les réticences sont légion. « En l'état actuel, je ne vois pas de majorité au sein du groupe parlementaire conservateur, pour défendre une nouvelle aide à la Grèce qui coûterait plusieurs milliards d'euros », explique Peter Ramsaeur, l'une des figures de la CSU bavaroise, dans un entretien vendredi à la presse allemande. Quant au SPD, membre de la « grande coalition » au pouvoir à Berlin, ses dirigeants sociaux-démocrates ont adopté une ligne dure, eux aussi. Au lendemain du référendum, Sigmar Gabriel avait ainsi jugé que Tsipras avait « rompu les ponts » entre la Grèce et les créanciers.
Le débat allemand se crispe, en particulier, sur la volonté des Grecs de restructurer leur dette. Merkel a répété jeudi qu'une décote « classique » de la dette grecque (c'est-à-dire une annulation partielle du fardeau, comme ce fut déjà le cas en 2012) est « hors de question ». Mais les exigences grecques des derniers jours sont moindres. Si on lit précisément la lettre du ministre des finances grec envoyée mercredi (à télécharger ici), la Grèce « se félicite de l'opportunité de pouvoir explorer d'éventuelles mesures à prendre » pour rendre sa dette « soutenable et viable ». Chacun y met ce qu'il veut.
En l'occurrence, l'engagement d'un débat à l'automne sur le rééchelonnement de la dette grecque (c'est-à-dire, non pas l'annulation, mais le rallongement de la maturité de certains prêts, de manière à alléger à court terme le fardeau) pourrait suffire.
La sortie, jeudi, du Polonais Donald Tusk, le président du conseil européen, plutôt proche de Merkel depuis le début des négociations, va dans le sens d'un adoucissement des positions des créanciers sur le front de la dette : « S'il y a des propositions réalistes et concrètes de la Grèce, il faudra des propositions des créanciers sur la soutenabilité de la dette. Autrement nous continuerons la danse mortelle. » Vendredi, François Hollande qualifiait précisément de « sérieux et crédible » le programme envoyé par Athènes. Le chef d'État français plaide depuis des semaines, comme il l'a fait mardi soir à l'issue du sommet de la zone euro, pour un « reprofilage » de la dette grecque. De quoi faire évoluer – un peu – les positions d'Angela Merkel, qui pourrait se trouver de plus en plus isolée ? L'Allemagne, jusqu'à présent, n'a pas réagi aux propositions d'Athènes envoyées jeudi soir.
Grèce: Tsipras multiplie les concessions à Bruxelles
10 juillet 2015 | Par Ludovic Lamant et Amélie Poinssot
Alexis Tsipras a fait parvenir ses engagements d'économies et de réformes aux créanciers, pour obtenir d'ici dimanche un nouveau plan d'aide. Il multiplie les concessions, sous la menace d'un « Grexit », mais aussi dans l'espoir de décrocher en retour des avancées sur le front de la dette. Le parlement grec se prononce vendredi sur ce « mémorandum », à la veille d'un Eurogroupe décisif.
C'est le document sur lequel vont se jouer les 48 heures à venir à Bruxelles, et une bonne partie de l'avenir de la Grèce – dans ou hors de la zone euro. Athènes a fait parvenir jeudi soir, en temps et en heure comme Alexis Tsipras s'y était engagé en début de semaine, sa liste d'« actions prioritaires ». En échange de quoi la Grèce espère obtenir un méga-prêt sur trois ans (jusqu'à 2018) auprès des institutions, chiffré à 53,5 milliards d'euros, pour éviter la sortie de la zone euro. Mais aussi des engagements des créanciers pour alléger, d'une manière ou d'une autre, sa dette.
Les concessions réalisées par Alexis Tsipras, déjà bien accueillies par certains dirigeants, comme François Hollande, après les pressions des États-Unis en début de semaine, laissaient penser vendredi après-midi qu'un accord était encore possible d'ici dimanche. Il s'agirait alors du troisième plan d'« aide » à la Grèce depuis le début de la crise en 2010. Mais rien n'est encore fait, et l'étape des ratifications par les parlements nationaux, en cas d'accord, s'annonce très délicate. Décryptage.
Alexis Tsipras a-t-il beaucoup « lâché » dans la dernière ligne droite ?
Le document envoyé jeudi soir par Athènes contient un ensemble de mesures d'austérité encore plus dures que ce qui était discuté jusqu'à présent. Elles portent sur 13 milliards d'euros d'économies budgétaires. Pour rappel, le programme qui était discuté ces dernières semaines portait sur 8,5 milliards d'euros, tandis que les ultimes mesures demandées, à la fin 2014, au gouvernement Samaras (droite-socialistes) avant qu'il ne tombe, ne dépassaient pas un milliard d'euros.
Mais il s'accompagne, en même temps, de nouveaux prêts européens qui devraient permettre de couvrir les besoins financiers du pays pendant trois ans. Il s'accompagne également d'un budget de développement : 35 milliards d'euros. Sauf que ces sommes correspondent en réalité aux fonds structurels européens prévus pour la Grèce sur la période 2014-2020 (c'est le vrai-faux « plan de relance » pour la Grèce présenté, il y a quelques semaines, par Jean-Claude Juncker, qui consiste à débloquer plus rapidement des fonds déjà budgétés…).
Dans ce nouveau plan – qui n'a encore rien de définitif puisqu'il doit encore être validé au niveau de l'Eurogroupe et de plusieurs parlements nationaux –, la plupart des lignes rouges posées initialement par le gouvernement Syriza ont été franchies. Mais il obtient quelques menues concessions qui devraient lui permettre de vendre le programme auprès du parti et de ses électeurs.
Sur la TVA, c'est un résultat mi-figue, mi-raisin. Le taux intermédiaire de TVA qui s'appliquait dans l'hôtellerie passe de 6,5 à 13 % ; celui de la restauration de 13 à 23 %. En compensation, les médicaments, livres et théâtre qui étaient imposés à hauteur de 6,5 % passent à un taux « super-réduit » de 6 %. La réduction qui s'appliquait sur les îles – comme ailleurs en Europe, voir notre article sur les taux de TVA – sera maintenue pour les îles les plus éloignées du continent, mais elle sera supprimée pour les îles les plus touristiques à la fin 2016. Athènes obtient donc le report de l'application de cette mesure, que les institutions voulaient au départ pour le début de cet été.
Sur le dossier des retraites, c'est également la politique austéritaire qui l'emporte, avec un calendrier toutefois plus lâche que celui exigé au départ : l'allocation « EKAS » attribuée aux petites retraites inférieures au seuil de pauvreté est maintenue jusqu'en janvier 2020. Après quoi une réforme du système des retraites devra être réalisée.
Mise en application progressive
Au sujet de la fiscalité au-delà de la TVA, plusieurs changements vont plutôt dans le sens d'une meilleure justice fiscale. Athènes propose l'augmentation voulue de l'impôt sur les entreprises, de 26 à 28 %. Le système des privilèges fiscaux dont bénéficiaient les agriculteurs devrait être, aussi, progressivement supprimé. La lutte contre la fraude fiscale devrait être renforcée. Enfin, et c'est une première en Grèce : le gouvernement annonce la suppression des exemptions fiscales dont bénéficiaient jusque-là les armateurs (mais c'est une réforme qui nécessite toutefois un changement de la Constitution).
Le gouvernement grec s'engage également à réformer l'administration publique et le secteur de la justice, et à améliorer la lutte contre la corruption – des objectifs déjà présents dans le mémorandum de février 2012, et dont plusieurs aspects ont déjà été mis en place. Mais dans un contexte de baisse généralisée des salaires et des effectifs depuis cinq ans, de telles réformes structurelles restent très délicates à mettre en place (nous le racontions, déjà, dans ce reportage en 2012).
Concernant le marché du travail, Athènes a dû abandonner son objectif de retour au salaire minimum originel, à 740 euros brut par mois (contre 580 depuis 2012). Mais elle obtient la réintroduction, dès le dernier trimestre 2015 et en collaboration avec le Bureau international du travail, des conventions collectives (elles aussi supprimées avec le mémorandum de 2012).
Quant aux privatisations des entreprises publiques et des biens de l'État que Syriza, dans sa campagne électorale, s'était engagé à interrompre, elles doivent reprendre immédiatement. En particulier, les ventes en cours des chemins de fer (TRAINOSE), des derniers terminaux du ports du Pirée et de Thessalonique, des aéroports régionaux et du terrain d'Elleniko (ancien aéroport d'Athènes et anciennes installations des JO 2004) doivent se poursuivre.
Du côté du gouvernement, on fait valoir que toutes ces mesures s'appliqueront progressivement. Que l'on a évité la mise en application immédiate. Et que tout cela constitue « un meilleur paquet pour la dette ». Mais rien ne garantit, pour l'heure, que l'exécutif Tsipras a remporté la partie sur la question de la dette. La version en grec envoyée aux médias hellènes est à ce titre légèrement différente du document officiel envoyé en anglais à Bruxelles : la copie grecque fait valoir que l'accord comportera la question de la dette (mais l'on ne parle pas d'effacement : le mot invoqué en grec signifie « régulation », « reprofilage »), tandis que le document anglais ne porte que sur les « actions prioritaires », autrement dit les mesures budgétaires.
Depuis cinq mois, on observe ce double langage entre Athènes et Bruxelles. L'accord comprendra-t-il, au bout du compte, une perspective pour une restructuration de la dette grecque ? C'est bien tout l'enjeu de ces négociations : c'est pour cela que Tsipras se bat, depuis qu'il est premier ministre. S'il l'obtient, alors ce sera une petite victoire politique.
Quelles sont les étapes d'ici dimanche soir ?
Les heures qui viennent sont décisives. Le nouveau ministre des finances grec a présenté mercredi une demande de prêt auprès du mécanisme européen de stabilité (MES), ce fonds d'urgence pour les pays de la zone euro, selon les conditions de l'article 13 du traité du MES. Conformément à cet article 13 (à lire ici), la commission européenne, en lien avec la BCE, doit maintenant rédiger trois rapports, l'un concernant les risques sur la stabilité financière de la zone euro, un autre censé évaluer les besoins en financement du pays en question, et un dernier, qui s'annonce décisif, sur la « soutenabilité » de la dette grecque. Tous ces rapports doivent être prêts pour samedi, et permettre aux dirigeants européens (et du MES) de prendre une décision.
Ce vendredi, les « institutions » (ex-Troïka) vont par ailleurs analyser les engagements envoyés jeudi soir par Athènes. Elles en feront un compte-rendu par oral ou par écrit à l'Eurogroupe, la réunion des ministres des finances, qui s'ouvre samedi à 15 heures, à Bruxelles. Entretemps, les négociateurs réunis au sein de l'« Euro working group », qui préparent les positions des ministres de l'Eurogroupe, se réuniront samedi matin.
En cas d'accord samedi, le sommet de la zone euro prévu dimanche après-midi ne fera qu'entériner les conclusions de l'Eurogroupe. Et dans la foulée, les 19 pourraient ensuite discuter d'un éventuel « prêt-relais » à la Grèce, pour couvrir les besoins de financement à très court terme (pour l'été). Mais les diplomates à Bruxelles insistent bien sur la chronologie : ce prêt-relais n'est envisageable que s'il y a eu accord, auparavant, sur le principe d'un méga-prêt d'ici 2018. En clair : sans accord préalable sur la « conditionnalité » et les réformes, hors de question d'envisager un énième prêt-relais pour faire face à l'urgence.
En cas de désaccord samedi, tous les scénarios resteront encore ouverts. Dimanche, après le sommet des dirigeants de la zone euro (à 19), un conseil européen exceptionnel (à 28) est aussi annoncé à Bruxelles, en début de soirée, qui pourrait alors préparer le terrain à un « Grexit » plus ou moins désordonné.
Vers une validation dès vendredi par le parlement grec ?
« Il faut bien comprendre que tout décaissement d'argent, de la part des créanciers, a pour préalable l'adoption d'une partie de ces 'actions prioritaires' présentées par les Grecs. Certaines actions législatives seront entreprises avant même qu'un éventuel accord ne soit conclu », expliquait vendredi matin un diplomate européen proche des discussions. C'est tout l'enjeu du vote, vendredi, au parlement grec : la nouvelle ébauche de « mémorandum » doit en effet déjà être votée dès ce vendredi 10 juillet en fin de journée au parlement grec…
Et c'est sous la menace exacerbée de « Grexit » que l'exécutif Tsipras a formulé cette liste de mesures, paradoxalement plus dure que ce qu'il avait accepté jusqu'à présent, et en dépit du « non » massif au référendum de dimanche. Devant le groupe parlementaire de Syriza ce vendredi matin, le premier ministre l'a rappelé : « Nous avions pour mandat de trouver un meilleur accord, mais nous n'avions pas pour mandat de sortir la Grèce de la zone euro. » Il a fermement appelé les députés de la gauche radicale à valider les propositions. « Le point où nous sommes arrivés, nous y sommes arrivés tous ensemble, a-t-il déclaré. Soit nous continuons tous ensemble, soit nous partons tous ensemble. » En clair, il met en jeu la démission de son gouvernement.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le chef de l'exécutif va selon toutes probabilités réussir à faire voter le plan par la Vouli, le parlement grec. Car si les députés de la « plateforme de gauche » de Syriza, courant favorable à la sortie de la zone euro, n'apportaient pas leur soutien, l'accord devrait en revanche bénéficier des voix des autres partis : Potami (centriste), PASOK (socialistes), et Nouvelle Démocratie (droite). Le premier ministre s'est en effet assuré au lendemain du référendum du soutien de l'opposition : les deux partis de la coalition gouvernementale ont signé avec les trois partis de l'opposition une déclaration commune pour trouver un accord à Bruxelles.
Paradoxalement, les 61,31 % de « non » auront renforcé Alexis Tsipras, mais ils lui imposent aussi, d'une certaine manière, un recentrage : le premier ministre grec ne représente plus seulement l'électorat de Syriza (36,34 % des suffrages aux élections de janvier), mais deux tiers de l'électorat grec.
Dès mardi, un observateur de premier plan des discussions à Bruxelles croyait discerner cette stratégie, pour le moins risquée : Tsipras, renforcé politiquement à Athènes, se sentirait davantage capable d'assumer des compromis difficiles avec l'Europe auprès de ses citoyens. « Les Grecs disent : nous sommes forts du soutien manifesté lors du vote de dimanche. Nous sommes aussi forts de la déclaration des cinq partis [signée lundi – ndlr] à Athènes. Donc on ne représente pas seulement 60 % [le score du "non" au référendum – ndlr], mais bien au-delà, et nous venons discuter, modestement. Ils n'ont pas eu d'attitude revancharde. Leur message, c'est : je suis plus fort qu'avant, je suis capable de passer des compromis », expliquait ce témoin des discussions.
Toutefois, l'adoption d'un tel mémorandum d'austérité, après un « non » si limpide aux mesures des créanciers du 25 janvier, et même si elle se fait en échange du maintien de la Grèce dans la zone euro – ce que souhaitent une majorité écrasante de Grecs –, ne sera pas sans conséquences politiques à Athènes. Il n'est pas à exclure que de nouvelles élections anticipées soient convoquées après l'été, afin d'assurer à l'exécutif une nouvelle légitimité.
Angela Merkel, le 8 juillet. Elle a exclu toute «décote» de la dette grecque.Angela Merkel, le 8 juillet. Elle a exclu toute «décote» de la dette grecque. © Reuters
Angela Merkel et le vote difficile du Bundestag
L'Allemagne fait partie des six pays de la zone euro où un vote du parlement est nécessaire, pour enclencher un nouveau programme d'aide à Athènes, aux côtés de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de l'Estonie et de la Finlande. À 48 heures du dénouement, c'est le nœud du problème : jusqu'où Angela Merkel est-elle prête à s'engager, et à prendre des risques politiques sur la scène intérieure allemande, pour maintenir la Grèce dans la zone euro ? La chancelière est confrontée, à domicile, à une opinion publique qui semble de plus en plus hostile à un troisième plan d'aide à la Grèce, surtout après le « non » au référendum grec de dimanche. Elle sait qu'il faudra en passer par un vote au Bundestag (sur le principe-même d'une nouvelle aide), qui pourrait la malmener.
Dans sa famille politique, la CDU-CSU, les réticences sont légion. « En l'état actuel, je ne vois pas de majorité au sein du groupe parlementaire conservateur, pour défendre une nouvelle aide à la Grèce qui coûterait plusieurs milliards d'euros », explique Peter Ramsaeur, l'une des figures de la CSU bavaroise, dans un entretien vendredi à la presse allemande. Quant au SPD, membre de la « grande coalition » au pouvoir à Berlin, ses dirigeants sociaux-démocrates ont adopté une ligne dure, eux aussi. Au lendemain du référendum, Sigmar Gabriel avait ainsi jugé que Tsipras avait « rompu les ponts » entre la Grèce et les créanciers.
Le débat allemand se crispe, en particulier, sur la volonté des Grecs de restructurer leur dette. Merkel a répété jeudi qu'une décote « classique » de la dette grecque (c'est-à-dire une annulation partielle du fardeau, comme ce fut déjà le cas en 2012) est « hors de question ». Mais les exigences grecques des derniers jours sont moindres. Si on lit précisément la lettre du ministre des finances grec envoyée mercredi (à télécharger ici), la Grèce « se félicite de l'opportunité de pouvoir explorer d'éventuelles mesures à prendre » pour rendre sa dette « soutenable et viable ». Chacun y met ce qu'il veut.
En l'occurrence, l'engagement d'un débat à l'automne sur le rééchelonnement de la dette grecque (c'est-à-dire, non pas l'annulation, mais le rallongement de la maturité de certains prêts, de manière à alléger à court terme le fardeau) pourrait suffire.
La sortie, jeudi, du Polonais Donald Tusk, le président du conseil européen, plutôt proche de Merkel depuis le début des négociations, va dans le sens d'un adoucissement des positions des créanciers sur le front de la dette : « S'il y a des propositions réalistes et concrètes de la Grèce, il faudra des propositions des créanciers sur la soutenabilité de la dette. Autrement nous continuerons la danse mortelle. » Vendredi, François Hollande qualifiait précisément de « sérieux et crédible » le programme envoyé par Athènes. Le chef d'État français plaide depuis des semaines, comme il l'a fait mardi soir à l'issue du sommet de la zone euro, pour un « reprofilage » de la dette grecque. De quoi faire évoluer – un peu – les positions d'Angela Merkel, qui pourrait se trouver de plus en plus isolée ? L'Allemagne, jusqu'à présent, n'a pas réagi aux propositions d'Athènes envoyées jeudi soir.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
La trahison de Tsipras?
Par Jacques Sapir · 10 juillet 2015
Alexis_Tsipras_in_Moscow_4Les propositions soumises par Alexis Tsipras et son gouvernement dans la nuit de jeudi à vendredi ont provoqué la stupeur. Elle reprennent largement, mais non totalement, les propositions formulées par l’Eurogroupe le 26 juin. Elles sont largement perçues dans l’opinion internationale comme une « capitulation » du gouvernement Tsipras. La réaction très positive des marchés financiers ce vendredi matin est, à cet égard, un signe important.
On sait par ailleurs qu’elles ont été en partie rédigées avec l’aide de hauts fonctionnaires français, même si cela est démenti par Bercy. Ces propositions résultent d’un intense travail de pressions tant sur la Grèce que sur l’Allemagne exercées par les Etats-Unis. La France a, ici, délibérément choisi le camp des Etats-Unis contre celui de l’Allemagne. Le gouvernement français n’a pas eu nécessairement tort de choisir d’affronter l’Allemagne sur ce dossier. Mais, il s’est engagé dans cette voie pour des raisons essentiellement idéologique. En fait, ce que veut par dessus tout M. François Hollande c’est « sauver l’Euro ». Il risque de voir très rapidement tout le prix qu’il a payé pour cela, et pour un résultat qui ne durera probablement que quelques mois. Car, ces propositions, si elles devaient être acceptées, ne règlent rien.
Les termes de la proposition grecque
Ces propositions sont donc proches de celles de l’Eurogroupe. On peut cependant noter certaines différences avec le texte du 26 juin, et en particulier la volonté de protéger les secteurs les plus fragiles de la société grecque : maintien du taux de TVA à 7% pour les produits de base, exemptions pour les îles les plus pauvres, maintien jusqu’en 2019 du système d’aide aux retraites les plus faibles. De ce point de vue, le gouvernement grec n’a effectivement pas cédé. De même, le gouvernement a inclus dans ce plan des mesures de luttes contre la fraude fiscale et la corruption, qui faisaient parties du programme initial de Syriza. Mais, il faut bien reconnaître qu’il s’est, pour le reste, largement aligné sur les demandes de l’Eurogroupe. Faut-il alors parler de capitulation comme le font certains ? La réponse est pourtant moins simple que ce qu’il paraît.
En effet, le gouvernement grec insiste sur trois points : un reprofilage de la dette (à partir de 2022) aboutissant à la reporter dans le temps de manière à la rendre viable, l’accès à 53 milliards sur trois ans, et le déblocage d’un plan d’investissement, dit « plan Juncker ». Mais, ce « plan » inclut largement des sommes prévues – mais non versées – par l’Union européenne au titre des fonds structurels. Surtout, le gouvernement grec insiste sur un engagement contraignant à l’ouverture de négociations sur la dette dès le mois d’octobre. Or, on rappelle que c’était justement l’une des choses qui avaient été refusées par l’Eurogroupe, conduisant à la rupture des négociations et à la décision d’Alexis Tsipras de convoquer un référendum.
De fait, les propositions transmises par le gouvernement grec, si elles font incontestablement un pas vers les créanciers, maintiennent une partie des exigences formulées précédemment. C’est pourquoi il est encore trop tôt de parler de capitulation. Une interprétation possible de ces propositions est qu’elles ont pour fonction de mettre l’Allemagne, et avec elle les autres pays partisans d’une expulsion de la Grèce de la zone Euro, au pied du mur. On sait que les Etats-Unis, inquiets des conséquences d’un « Grexit » sur l’avenir de la zone Euro, ont mis tout leur poids dans la balance pour amener Mme Merkel à des concessions importantes. Que l’Allemagne fasse preuve d’intransigeance et c’est elle qui portera la responsabilité du « Grexit ». Qu’elle se décide à céder, et elle ne pourra plus refuser au Portugal, à l’Espagne, voire à l’Italie, ce qu’elle a concédé à la Grèce. On peut alors considérer que ce plan est une nouvelle démonstration du sens tactique inné d’Alexis Tsipras. Mais, ces propositions présentent aussi un grave problème au gouvernement grec.
Le dilemme du gouvernement grec
Le problème auquel le gouvernement Tsipras est confronté aujourd’hui est double : politique et économique. Politiquement, vouloir faire comme si le référendum n’avait pas eu lieu, comme si le « non » n’avait pas été largement, et même massivement, majoritaire, ne sera pas possible sans dommages politiques importants. Le Ministre des finances démissionnaire, M. Yannis Varoufakis, a d’ailleurs critiqué des aspects de ces propositions. Plus profondément, ces propositions ne peuvent pas ne pas troubler non seulement les militants de Syriza, et en particulier la gauche de ce parti, mais aussi, et au-delà, l’ensemble des électeurs qui s’étaient mobilisés pour soutenir le gouvernement et Alexis Tsipras. Ce dernier prend donc le risque de provoquer une immense déception. Celle-ci le laisserait en réalité sans défense faces aux différentes manœuvres tant parlementaires qu’extra-parlementaires dont on peut imaginer que ses adversaires politiques ne se priveront pas. Or, la volonté des institutions européennes de provoquer un changement de gouvernement, ce qu’avait dit crûment le Président du Parlement européen, le social-démocrate Martin Schulz, n’a pas changé. Hier, jeudi, Jean-Claude Juncker recevait les dirigeants de la Nouvelle Démocratie (centre-droit) et de To Potami (centre-gauche). Privé d’un large soutien dans la société, ayant lourdement déçu l’aile gauche de son parti, aile gauche qui représente plus de 40% de Syriza, Tsipras sera désormais très vulnérable. Au minimum, il aura cassé la logique de mobilisation populaire qui s’était manifestée lors du référendum du 5 juillet et pendant la campagne. Il faut ici rappeler que les résultats de ce référendum ont montré une véritable mobilisation allant bien au-delà de l’électorat de Syriza et de l’ANEL, les deux partis du gouvernement. Cela aura, bien entendu des conséquences. Si les députés de la gauche de Syriza vont très probablement voter ces propositions au Parlement, il est néanmoins clair que les extrêmes, le KKE (les communistes néostaliniens) et le parti d’Extrême-Droite « Aube Dorée », vont pouvoir tirer profit de la déception que va susciter ces propositions.
Au-delà, la question de la viabilité de l’économie grecque reste posée, car ces propositions n’apportent aucune solution au problème de fond qui est posé. Certes, cette question de la viabilité sera posée dans des termes moins immédiatement dramatiques qu’aujourd’hui si un accord est conclu. La crise de liquidité pourra être jugulée sans recourir aux mesures radicales que l’on a évoquées dans ces carnet. Les banques, à nouveau alimentée par la BCE, pourront reprendre leurs opérations. Mais, rien ne sera réglé. Olivier Blanchard, l’ancien économiste en chef du Fond Monétaire International signale que les pronostics très négatifs réalisés par son organisation sont probablement en-deçà de la réalité. Après cinq années d’austérité qui l’ont saigné à blanc, l’économie grecque a désespérément besoin de souffler. Cela aurait pu passer par des investissements, une baisse de la pression fiscale, bref par moins d’austérité. Ce n’est pas le chemin vers lequel on se dirige. Cela aurait pu aussi passer par une sortie, et non une expulsion, hors de la zone Euro qui, en permettant à l’économie grecque de déprécier sa monnaie de -20% à -25%, lui aurait redonné sa compétitivité. On ne fera, à l’évidence, ni l’un ni l’autre. Dès lors, il faut s’interroger sur les conditions d’application des propositions soumises par la Grèce à ses créanciers. Même en admettant qu’un accord soit trouvé, la détérioration de la situation économique induite par l’action de la Banque Centrale Européenne, que M. Varoufakis a qualifiée de « terroriste », venant après cinq années d’austérité risque de rendre caduques ces propositions d’ici à quelques mois. Une chute des recettes de la TVA est aujourd’hui prévisible. Une nouvelle négociation sera donc nécessaire. En ce sens, ces propositions ne règlent rien.
L’Euro c’est l’austérité
Il faut, alors, s’interroger sur le sens profond de ces propositions. Si elles sont tactiquement défendables, elles correspondent très probablement à une erreur de stratégie. Alexis Tsipras a déclaré ce vendredi matin, devant le groupe parlementaire de Syriza, qu’il n’avait pas reçu mandat du peuple grec pour sortir de l’Euro. Le fait est aujourd’hui débattable, surtout après l’écrasante victoire du « non » au référendum. Il est clair que telle n’était pas l’intention initiale du gouvernement, et ne correspondait pas au programme sur lequel il avait été élu. Mais, on peut penser que mis devant l’alternative, refuser l’austérité ou refuser l’Euro, la population grecque est en train d’évoluer rapidement. En fait, on observe une radicalisation dans les positions de la population, ou du moins c’est ce qui était observée jusqu’à ces propositions. Les jours qui viennent indiqueront si cette radicalisation se poursuit ou si elle a été cassée par ce qu’a fait le gouvernement.
En réalité, ce que l’on perçoit de manière de plus en plus claire, et c’est d’ailleurs l’analyse qui est défendue par l’aile gauche de Syriza et un économiste comme Costas Lapavitsas[1], c’est que le cadre de l’Euro impose les politiques d’austérité. Si Tsipras a cru sincèrement qu’il pourrait changer cela, il doit reconnaître aujourd’hui qu’il a échoué. L’austérité restera la politique de la zone Euro. Il n’y aura pas « d’autre Euro », et cette leçon s’applique aussi à ceux qui, en France, défendent cette fadaise. Dès lors il faut poser clairement le problème d’une sortie de l’Euro, qu’il s’agisse d’ailleurs de la Grèce ou de nombreux autres pays.
Par Jacques Sapir · 10 juillet 2015
Alexis_Tsipras_in_Moscow_4Les propositions soumises par Alexis Tsipras et son gouvernement dans la nuit de jeudi à vendredi ont provoqué la stupeur. Elle reprennent largement, mais non totalement, les propositions formulées par l’Eurogroupe le 26 juin. Elles sont largement perçues dans l’opinion internationale comme une « capitulation » du gouvernement Tsipras. La réaction très positive des marchés financiers ce vendredi matin est, à cet égard, un signe important.
On sait par ailleurs qu’elles ont été en partie rédigées avec l’aide de hauts fonctionnaires français, même si cela est démenti par Bercy. Ces propositions résultent d’un intense travail de pressions tant sur la Grèce que sur l’Allemagne exercées par les Etats-Unis. La France a, ici, délibérément choisi le camp des Etats-Unis contre celui de l’Allemagne. Le gouvernement français n’a pas eu nécessairement tort de choisir d’affronter l’Allemagne sur ce dossier. Mais, il s’est engagé dans cette voie pour des raisons essentiellement idéologique. En fait, ce que veut par dessus tout M. François Hollande c’est « sauver l’Euro ». Il risque de voir très rapidement tout le prix qu’il a payé pour cela, et pour un résultat qui ne durera probablement que quelques mois. Car, ces propositions, si elles devaient être acceptées, ne règlent rien.
Les termes de la proposition grecque
Ces propositions sont donc proches de celles de l’Eurogroupe. On peut cependant noter certaines différences avec le texte du 26 juin, et en particulier la volonté de protéger les secteurs les plus fragiles de la société grecque : maintien du taux de TVA à 7% pour les produits de base, exemptions pour les îles les plus pauvres, maintien jusqu’en 2019 du système d’aide aux retraites les plus faibles. De ce point de vue, le gouvernement grec n’a effectivement pas cédé. De même, le gouvernement a inclus dans ce plan des mesures de luttes contre la fraude fiscale et la corruption, qui faisaient parties du programme initial de Syriza. Mais, il faut bien reconnaître qu’il s’est, pour le reste, largement aligné sur les demandes de l’Eurogroupe. Faut-il alors parler de capitulation comme le font certains ? La réponse est pourtant moins simple que ce qu’il paraît.
En effet, le gouvernement grec insiste sur trois points : un reprofilage de la dette (à partir de 2022) aboutissant à la reporter dans le temps de manière à la rendre viable, l’accès à 53 milliards sur trois ans, et le déblocage d’un plan d’investissement, dit « plan Juncker ». Mais, ce « plan » inclut largement des sommes prévues – mais non versées – par l’Union européenne au titre des fonds structurels. Surtout, le gouvernement grec insiste sur un engagement contraignant à l’ouverture de négociations sur la dette dès le mois d’octobre. Or, on rappelle que c’était justement l’une des choses qui avaient été refusées par l’Eurogroupe, conduisant à la rupture des négociations et à la décision d’Alexis Tsipras de convoquer un référendum.
De fait, les propositions transmises par le gouvernement grec, si elles font incontestablement un pas vers les créanciers, maintiennent une partie des exigences formulées précédemment. C’est pourquoi il est encore trop tôt de parler de capitulation. Une interprétation possible de ces propositions est qu’elles ont pour fonction de mettre l’Allemagne, et avec elle les autres pays partisans d’une expulsion de la Grèce de la zone Euro, au pied du mur. On sait que les Etats-Unis, inquiets des conséquences d’un « Grexit » sur l’avenir de la zone Euro, ont mis tout leur poids dans la balance pour amener Mme Merkel à des concessions importantes. Que l’Allemagne fasse preuve d’intransigeance et c’est elle qui portera la responsabilité du « Grexit ». Qu’elle se décide à céder, et elle ne pourra plus refuser au Portugal, à l’Espagne, voire à l’Italie, ce qu’elle a concédé à la Grèce. On peut alors considérer que ce plan est une nouvelle démonstration du sens tactique inné d’Alexis Tsipras. Mais, ces propositions présentent aussi un grave problème au gouvernement grec.
Le dilemme du gouvernement grec
Le problème auquel le gouvernement Tsipras est confronté aujourd’hui est double : politique et économique. Politiquement, vouloir faire comme si le référendum n’avait pas eu lieu, comme si le « non » n’avait pas été largement, et même massivement, majoritaire, ne sera pas possible sans dommages politiques importants. Le Ministre des finances démissionnaire, M. Yannis Varoufakis, a d’ailleurs critiqué des aspects de ces propositions. Plus profondément, ces propositions ne peuvent pas ne pas troubler non seulement les militants de Syriza, et en particulier la gauche de ce parti, mais aussi, et au-delà, l’ensemble des électeurs qui s’étaient mobilisés pour soutenir le gouvernement et Alexis Tsipras. Ce dernier prend donc le risque de provoquer une immense déception. Celle-ci le laisserait en réalité sans défense faces aux différentes manœuvres tant parlementaires qu’extra-parlementaires dont on peut imaginer que ses adversaires politiques ne se priveront pas. Or, la volonté des institutions européennes de provoquer un changement de gouvernement, ce qu’avait dit crûment le Président du Parlement européen, le social-démocrate Martin Schulz, n’a pas changé. Hier, jeudi, Jean-Claude Juncker recevait les dirigeants de la Nouvelle Démocratie (centre-droit) et de To Potami (centre-gauche). Privé d’un large soutien dans la société, ayant lourdement déçu l’aile gauche de son parti, aile gauche qui représente plus de 40% de Syriza, Tsipras sera désormais très vulnérable. Au minimum, il aura cassé la logique de mobilisation populaire qui s’était manifestée lors du référendum du 5 juillet et pendant la campagne. Il faut ici rappeler que les résultats de ce référendum ont montré une véritable mobilisation allant bien au-delà de l’électorat de Syriza et de l’ANEL, les deux partis du gouvernement. Cela aura, bien entendu des conséquences. Si les députés de la gauche de Syriza vont très probablement voter ces propositions au Parlement, il est néanmoins clair que les extrêmes, le KKE (les communistes néostaliniens) et le parti d’Extrême-Droite « Aube Dorée », vont pouvoir tirer profit de la déception que va susciter ces propositions.
Au-delà, la question de la viabilité de l’économie grecque reste posée, car ces propositions n’apportent aucune solution au problème de fond qui est posé. Certes, cette question de la viabilité sera posée dans des termes moins immédiatement dramatiques qu’aujourd’hui si un accord est conclu. La crise de liquidité pourra être jugulée sans recourir aux mesures radicales que l’on a évoquées dans ces carnet. Les banques, à nouveau alimentée par la BCE, pourront reprendre leurs opérations. Mais, rien ne sera réglé. Olivier Blanchard, l’ancien économiste en chef du Fond Monétaire International signale que les pronostics très négatifs réalisés par son organisation sont probablement en-deçà de la réalité. Après cinq années d’austérité qui l’ont saigné à blanc, l’économie grecque a désespérément besoin de souffler. Cela aurait pu passer par des investissements, une baisse de la pression fiscale, bref par moins d’austérité. Ce n’est pas le chemin vers lequel on se dirige. Cela aurait pu aussi passer par une sortie, et non une expulsion, hors de la zone Euro qui, en permettant à l’économie grecque de déprécier sa monnaie de -20% à -25%, lui aurait redonné sa compétitivité. On ne fera, à l’évidence, ni l’un ni l’autre. Dès lors, il faut s’interroger sur les conditions d’application des propositions soumises par la Grèce à ses créanciers. Même en admettant qu’un accord soit trouvé, la détérioration de la situation économique induite par l’action de la Banque Centrale Européenne, que M. Varoufakis a qualifiée de « terroriste », venant après cinq années d’austérité risque de rendre caduques ces propositions d’ici à quelques mois. Une chute des recettes de la TVA est aujourd’hui prévisible. Une nouvelle négociation sera donc nécessaire. En ce sens, ces propositions ne règlent rien.
L’Euro c’est l’austérité
Il faut, alors, s’interroger sur le sens profond de ces propositions. Si elles sont tactiquement défendables, elles correspondent très probablement à une erreur de stratégie. Alexis Tsipras a déclaré ce vendredi matin, devant le groupe parlementaire de Syriza, qu’il n’avait pas reçu mandat du peuple grec pour sortir de l’Euro. Le fait est aujourd’hui débattable, surtout après l’écrasante victoire du « non » au référendum. Il est clair que telle n’était pas l’intention initiale du gouvernement, et ne correspondait pas au programme sur lequel il avait été élu. Mais, on peut penser que mis devant l’alternative, refuser l’austérité ou refuser l’Euro, la population grecque est en train d’évoluer rapidement. En fait, on observe une radicalisation dans les positions de la population, ou du moins c’est ce qui était observée jusqu’à ces propositions. Les jours qui viennent indiqueront si cette radicalisation se poursuit ou si elle a été cassée par ce qu’a fait le gouvernement.
En réalité, ce que l’on perçoit de manière de plus en plus claire, et c’est d’ailleurs l’analyse qui est défendue par l’aile gauche de Syriza et un économiste comme Costas Lapavitsas[1], c’est que le cadre de l’Euro impose les politiques d’austérité. Si Tsipras a cru sincèrement qu’il pourrait changer cela, il doit reconnaître aujourd’hui qu’il a échoué. L’austérité restera la politique de la zone Euro. Il n’y aura pas « d’autre Euro », et cette leçon s’applique aussi à ceux qui, en France, défendent cette fadaise. Dès lors il faut poser clairement le problème d’une sortie de l’Euro, qu’il s’agisse d’ailleurs de la Grèce ou de nombreux autres pays.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 46 invité(s)