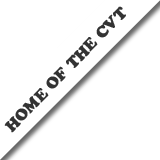[01T] Politix, fonctionnaire et Cie
L'Allemagne, le nouveau problème de l'Europe
12 juillet 2015 | Par François Bonnet
L'intransigeance dogmatique et la brutalité inédite de l'Allemagne envers le gouvernement grec marquent une rupture historique dans le projet européen.
Le grand naufrage européen lié à la crise grecque a produit une révélation. Et cette révélation est largement due au premier ministre grec Alexis Tsipras comme à son ancien ministre des finances Yanis Varoufakis. En remettant, l'un et l'autre, des enjeux clairement politiques au cœur de la technocratie bruxelloise, en jouant la transparence et en brisant les scandaleux huis clos des réunions de l'Eurogroupe, les responsables grecs ont fait surgir au grand jour un inquiétant et nouveau problème : le cas allemand.
L'intransigeance obstinée de l'Allemagne tout au long de cette crise, son entêtement dogmatique à bouter hors de l'euro la Grèce sont désormais compréhensibles par tous. Là où quelques observateurs, experts et politiques en étaient persuadés de longue date, ce sont désormais toutes les opinions publiques européennes qui ont sous les yeux cette nouvelle Allemagne. C'est une donnée politique radicalement neuve. Fort de son statut de première puissance économique de la zone euro, l'Allemagne revendique désormais d'en fixer les règles du jeu et d'imposer, comme l'écrit Varoufakis, « son modèle d'Eurozone disciplinaire » (lire ici le texte de l'ancien ministre grec).
À ce titre, la crise grecque, devenue crise européenne, constitue bel et bien un moment charnière dans l'histoire européenne, d'une puissance d'impact équivalente à la chute du Mur ou à la réunification allemande. Une Allemagne nouvelle se révèle, prête à passer par-dessus bord la sacro-sainte entente franco-allemande (d'où les tensions très fortes de ces derniers jours), prompte à mettre en scène ses soutiens en Europe centrale (Pays baltes, Slovaquie, Pologne) et en Europe du Nord (Pays-Bas, Finlande) pour s'imposer à tous.
Cette soudaine affirmation de puissance est du jamais vu depuis le début de la construction européenne. Et ce moment de rupture a bel et bien été souligné par plusieurs chefs d'État ou de gouvernement. L'Italien Mattéo Renzi l'a expliqué au journal Il Messaggero : « Nous devons parvenir à un accord, la Grèce doit rester dans la zone euro et je l'ai dit à l'Allemagne : trop c'est trop. Humilier ainsi un partenaire européen, alors que la Grèce a cédé sur presque tous les points, est impensable. »
Même avertissement, venu cette fois d'un allié traditionnel de Berlin : Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des affaires étrangères, prévient dans le journal allemand Süddeutsche Zeitung qu'un Grexit « serait fatal pour la réputation de l'Allemagne en Europe et dans le monde » et provoquerait « un conflit profond avec la France ».
Le fait qu'Angela Merkel, in fine, ne manquera sans doute pas d'arrondir les angles en se rangeant à un possible accord qui organise l'humiliation de la Grèce, et chantera les louanges de la coordination avec la France, ne change rien à l'affaire. Depuis l'annonce du référendum grec, et sa tenue le 5 juillet, un pouvoir allemand brutal, doctrinaire et faisant fi de la fameuse « culture européenne du compromis » s'est révélé.
Il ne s'agit pas seulement du ministre des finances Wolfgang Schäuble, qui a demandé dès samedi un Grexit de cinq années. C'est l'ensemble de la classe politique allemande qui a surpris par sa brutale intransigeance. Car les sociaux-démocrates du SPD ont rivalisé de fermeté avec le pouvoir conservateur et la CDU-CSU. Dès l'annonce du référendum, le 29 juin, le président du SPD Sigmar Gabriel accuse Alexis Tsipras de vouloir briser la zone euro et prévient que le vote grec sera un vote pour ou contre l'euro. Le soir même du scrutin, il assure que Tsipras « a rompu tous les ponts avec l'Europe » et qu'une nouvelle aide est « difficilement envisageable ». Dans le même temps, c'est Martin Schulz, président socialiste du Parlement, qui avait été le chef de file des socialistes européens pour les élections européennes, qui plaide pour la mise en place « d'un gouvernement d'experts à Athènes » !
Rappelés à l'ordre par les socialistes européens, et en particulier les socialistes français (« Les peuples d’Europe ne comprennent pas la surenchère allemande », a fait savoir Jean-Christophe Cambadélis au SPD), les sociaux-démocrates louvoient depuis lors. Trop tard, le mal est fait et les tensions sont des plus fortes au sein du groupe socialiste au Parlement européen. A posteriori, que reste-t-il de cette campagne européenne des socialistes qui promettaient, forts de l'axe PS-SPD, une Europe tournant le dos aux politiques néolibérales organisant l'austérité ? Un champ de ruines.
Un projet « glaçant », selon Timothy Geithner
Car, derrière un habillage économiste et technicien (le respect des règles de la zone euro), c'est bien à une bataille de projets politiques que l'on assiste. Et la monnaie, en l'occurence l'euro, est bien la première de ces armes politiques. Au moment de la réunification allemande, tant Helmut Kohl que François Mitterrand en firent la démonstration. Kohl, en décidant, contre toute rationnalité économique, de la parité 1 pour 1 entre « ouest-mark » et « est-mark ». Mitterrand, en conditionnant, malgré réserves et inquiétudes, son acceptation de la réunification à un engagement irrévocable des Allemands à s'inscrire dans le processus de création de la monnaie unique (lire ici cette étude sur les relations Mitterrand-Kohl).
L'intransigeance aujourd'hui affichée par Berlin est en droite ligne avec le projet politique porté depuis des années par la droite conservatrice allemande. En résumé : une zone euro limitée donc plus cohérente, plus fortement intégrée et conduisant une seule et même politique économique, un néolibéralisme débridé s'appuyant sur une thérapie de choc austéritaire dans les pays de cette zone. Plus question donc de politiques alternatives dans un tel ensemble où s'appliquerait pleinement cette phrase de Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne : « Il ne peut y avoir un vote démocratique dans un pays qui s'inscrive contre les traités. »
Ce projet politique allemand, notre collaborateur Philippe Riès l'exposait déjà en 2010, au tout début de la crise grecque, quand se discutait le premier plan d'aide : « En poussant Athènes éventuellement hors de la zone euro, Berlin cherche la “crise salutaire” qui permettrait de remettre une Union économique et monétaire épurée sur les rails de la vertu budgétaire. La France est prévenue » (lire l'article Grèce : pourquoi l'Allemagne a décidé de faire un exemple).
Timothy Geithner, ancien secrétaire américain au Trésor sous Obama, explique une même stratégie allemande dans son dernier livre, Stress Test. Il y raconte une rencontre et une discussion informelle avec Wolfang Schäuble, dans la maison de vacances de ce dernier, en juillet 2012. Schäuble, écrit-il, lui explique les nombreuses vertus d'un plan organisant la sortie de la Grèce de la zone euro : d'abord, satisfaire l'électorat allemand, excédé de payer ; surtout, « terrifier » les autres pays membres de la zone euro pour les contraindre à une plus grande intégration et à un renforcement de la zone euro. Geithner dit avoir trouvé l'idée « glaçante », lui qui, tout comme l'administration Obama, jugeait parfaitement contreproductive et vouée à l'échec l'austérité de choc imposée à la Grèce (lire ici le compte-rendu de cette rencontre).
La Grèce et ses 1,5 % du PIB européen ne pouvant être considérés comme un véritable enjeu économique, c'est bien une vision politique que l'Allemagne veut faire accepter à ses partenaires à travers cette crise. C'est une vision dogmatique dangereuse tant elle fait fi de l'histoire d'abord, et des logiques de la construction européenne ensuite. L'histoire a été rappelée fort utilement par Alexis Tsipras aussitôt parvenu au pouvoir : la terreur nazie en Grèce, la question des réparations de guerre et de l'emprunt forcé fait par le Reich à la Grèce et jamais remboursé demeurent des plaies ouvertes en Grèce (lire ici l'article d'Amélie Poinssot et de Ludovic Lamant).
L'affirmation d'une superpuissance allemande en Europe, assise sur son économie mais aussi sur son emprise sur bon nombre de pays d'Europe centrale, est une source de divisions majeures et de dangers difficilement mesurables. D'autant que cette vision allemande fait l'impasse sur les principaux enjeux géostratégiques actuels. Jacques Delors, Pascal Lamy et Antonio Vitorinao l'ont rappelé dans une récente tribune (à lire ici) : « Il s’agit d’appréhender l’évolution de la Grèce dans une perspective géopolitique, comme un problème européen, et qui le demeurera. Ce n’est pas seulement avec des microscopes du Fonds monétaire international (FMI) qu’il faut regarder la Grèce, mais avec des jumelles onusiennes, c’est-à-dire comme un Etat appartenant à des Balkans dont l’instabilité n’a guère besoin d’être encouragée, en ces temps de guerre en Ukraine et en Syrie et de défi terroriste – sans oublier la crise migratoire. »
C'est aussi le rappel fait par l'administration américaine qui, depuis le début de la crise, encourage à trouver au plus vite un accord. C'est enfin l'histoire même de la construction européenne qui est en jeu, histoire qui a été forgée par de grands gestes politiques. La réconciliation franco-allemande De Gaulle-Adenauer ; la réunification allemande ; l'élargissement à l'Europe centrale après l'effondrement de l'URSS. Faut-il rappeler que sur de seules bases comptables ou technocratiques, jamais le Portugal ou la Grèce n'auraient intégré ce qui s'appelait alors la CEE ? Rappeler que la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l'Union européenne sans satisfaire à tous les critères d'adhésion ?
C'est ce projet d'une Europe ouverte, multiple parce que pluraliste, solidaire mais non uniforme, laissant aux États membres de larges marges de manœuvre politiques sans lesquelles il n'y a pas de démocratie, que l'Allemagne se révèle aujourd'hui combattre farouchement avec l'exemple grec. C'est un événement aux conséquences incalculables. Il va, dans les années à venir, remodeler en profondeur le projet européen.
12 juillet 2015 | Par François Bonnet
L'intransigeance dogmatique et la brutalité inédite de l'Allemagne envers le gouvernement grec marquent une rupture historique dans le projet européen.
Le grand naufrage européen lié à la crise grecque a produit une révélation. Et cette révélation est largement due au premier ministre grec Alexis Tsipras comme à son ancien ministre des finances Yanis Varoufakis. En remettant, l'un et l'autre, des enjeux clairement politiques au cœur de la technocratie bruxelloise, en jouant la transparence et en brisant les scandaleux huis clos des réunions de l'Eurogroupe, les responsables grecs ont fait surgir au grand jour un inquiétant et nouveau problème : le cas allemand.
L'intransigeance obstinée de l'Allemagne tout au long de cette crise, son entêtement dogmatique à bouter hors de l'euro la Grèce sont désormais compréhensibles par tous. Là où quelques observateurs, experts et politiques en étaient persuadés de longue date, ce sont désormais toutes les opinions publiques européennes qui ont sous les yeux cette nouvelle Allemagne. C'est une donnée politique radicalement neuve. Fort de son statut de première puissance économique de la zone euro, l'Allemagne revendique désormais d'en fixer les règles du jeu et d'imposer, comme l'écrit Varoufakis, « son modèle d'Eurozone disciplinaire » (lire ici le texte de l'ancien ministre grec).
À ce titre, la crise grecque, devenue crise européenne, constitue bel et bien un moment charnière dans l'histoire européenne, d'une puissance d'impact équivalente à la chute du Mur ou à la réunification allemande. Une Allemagne nouvelle se révèle, prête à passer par-dessus bord la sacro-sainte entente franco-allemande (d'où les tensions très fortes de ces derniers jours), prompte à mettre en scène ses soutiens en Europe centrale (Pays baltes, Slovaquie, Pologne) et en Europe du Nord (Pays-Bas, Finlande) pour s'imposer à tous.
Cette soudaine affirmation de puissance est du jamais vu depuis le début de la construction européenne. Et ce moment de rupture a bel et bien été souligné par plusieurs chefs d'État ou de gouvernement. L'Italien Mattéo Renzi l'a expliqué au journal Il Messaggero : « Nous devons parvenir à un accord, la Grèce doit rester dans la zone euro et je l'ai dit à l'Allemagne : trop c'est trop. Humilier ainsi un partenaire européen, alors que la Grèce a cédé sur presque tous les points, est impensable. »
Même avertissement, venu cette fois d'un allié traditionnel de Berlin : Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des affaires étrangères, prévient dans le journal allemand Süddeutsche Zeitung qu'un Grexit « serait fatal pour la réputation de l'Allemagne en Europe et dans le monde » et provoquerait « un conflit profond avec la France ».
Le fait qu'Angela Merkel, in fine, ne manquera sans doute pas d'arrondir les angles en se rangeant à un possible accord qui organise l'humiliation de la Grèce, et chantera les louanges de la coordination avec la France, ne change rien à l'affaire. Depuis l'annonce du référendum grec, et sa tenue le 5 juillet, un pouvoir allemand brutal, doctrinaire et faisant fi de la fameuse « culture européenne du compromis » s'est révélé.
Il ne s'agit pas seulement du ministre des finances Wolfgang Schäuble, qui a demandé dès samedi un Grexit de cinq années. C'est l'ensemble de la classe politique allemande qui a surpris par sa brutale intransigeance. Car les sociaux-démocrates du SPD ont rivalisé de fermeté avec le pouvoir conservateur et la CDU-CSU. Dès l'annonce du référendum, le 29 juin, le président du SPD Sigmar Gabriel accuse Alexis Tsipras de vouloir briser la zone euro et prévient que le vote grec sera un vote pour ou contre l'euro. Le soir même du scrutin, il assure que Tsipras « a rompu tous les ponts avec l'Europe » et qu'une nouvelle aide est « difficilement envisageable ». Dans le même temps, c'est Martin Schulz, président socialiste du Parlement, qui avait été le chef de file des socialistes européens pour les élections européennes, qui plaide pour la mise en place « d'un gouvernement d'experts à Athènes » !
Rappelés à l'ordre par les socialistes européens, et en particulier les socialistes français (« Les peuples d’Europe ne comprennent pas la surenchère allemande », a fait savoir Jean-Christophe Cambadélis au SPD), les sociaux-démocrates louvoient depuis lors. Trop tard, le mal est fait et les tensions sont des plus fortes au sein du groupe socialiste au Parlement européen. A posteriori, que reste-t-il de cette campagne européenne des socialistes qui promettaient, forts de l'axe PS-SPD, une Europe tournant le dos aux politiques néolibérales organisant l'austérité ? Un champ de ruines.
Un projet « glaçant », selon Timothy Geithner
Car, derrière un habillage économiste et technicien (le respect des règles de la zone euro), c'est bien à une bataille de projets politiques que l'on assiste. Et la monnaie, en l'occurence l'euro, est bien la première de ces armes politiques. Au moment de la réunification allemande, tant Helmut Kohl que François Mitterrand en firent la démonstration. Kohl, en décidant, contre toute rationnalité économique, de la parité 1 pour 1 entre « ouest-mark » et « est-mark ». Mitterrand, en conditionnant, malgré réserves et inquiétudes, son acceptation de la réunification à un engagement irrévocable des Allemands à s'inscrire dans le processus de création de la monnaie unique (lire ici cette étude sur les relations Mitterrand-Kohl).
L'intransigeance aujourd'hui affichée par Berlin est en droite ligne avec le projet politique porté depuis des années par la droite conservatrice allemande. En résumé : une zone euro limitée donc plus cohérente, plus fortement intégrée et conduisant une seule et même politique économique, un néolibéralisme débridé s'appuyant sur une thérapie de choc austéritaire dans les pays de cette zone. Plus question donc de politiques alternatives dans un tel ensemble où s'appliquerait pleinement cette phrase de Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne : « Il ne peut y avoir un vote démocratique dans un pays qui s'inscrive contre les traités. »
Ce projet politique allemand, notre collaborateur Philippe Riès l'exposait déjà en 2010, au tout début de la crise grecque, quand se discutait le premier plan d'aide : « En poussant Athènes éventuellement hors de la zone euro, Berlin cherche la “crise salutaire” qui permettrait de remettre une Union économique et monétaire épurée sur les rails de la vertu budgétaire. La France est prévenue » (lire l'article Grèce : pourquoi l'Allemagne a décidé de faire un exemple).
Timothy Geithner, ancien secrétaire américain au Trésor sous Obama, explique une même stratégie allemande dans son dernier livre, Stress Test. Il y raconte une rencontre et une discussion informelle avec Wolfang Schäuble, dans la maison de vacances de ce dernier, en juillet 2012. Schäuble, écrit-il, lui explique les nombreuses vertus d'un plan organisant la sortie de la Grèce de la zone euro : d'abord, satisfaire l'électorat allemand, excédé de payer ; surtout, « terrifier » les autres pays membres de la zone euro pour les contraindre à une plus grande intégration et à un renforcement de la zone euro. Geithner dit avoir trouvé l'idée « glaçante », lui qui, tout comme l'administration Obama, jugeait parfaitement contreproductive et vouée à l'échec l'austérité de choc imposée à la Grèce (lire ici le compte-rendu de cette rencontre).
La Grèce et ses 1,5 % du PIB européen ne pouvant être considérés comme un véritable enjeu économique, c'est bien une vision politique que l'Allemagne veut faire accepter à ses partenaires à travers cette crise. C'est une vision dogmatique dangereuse tant elle fait fi de l'histoire d'abord, et des logiques de la construction européenne ensuite. L'histoire a été rappelée fort utilement par Alexis Tsipras aussitôt parvenu au pouvoir : la terreur nazie en Grèce, la question des réparations de guerre et de l'emprunt forcé fait par le Reich à la Grèce et jamais remboursé demeurent des plaies ouvertes en Grèce (lire ici l'article d'Amélie Poinssot et de Ludovic Lamant).
L'affirmation d'une superpuissance allemande en Europe, assise sur son économie mais aussi sur son emprise sur bon nombre de pays d'Europe centrale, est une source de divisions majeures et de dangers difficilement mesurables. D'autant que cette vision allemande fait l'impasse sur les principaux enjeux géostratégiques actuels. Jacques Delors, Pascal Lamy et Antonio Vitorinao l'ont rappelé dans une récente tribune (à lire ici) : « Il s’agit d’appréhender l’évolution de la Grèce dans une perspective géopolitique, comme un problème européen, et qui le demeurera. Ce n’est pas seulement avec des microscopes du Fonds monétaire international (FMI) qu’il faut regarder la Grèce, mais avec des jumelles onusiennes, c’est-à-dire comme un Etat appartenant à des Balkans dont l’instabilité n’a guère besoin d’être encouragée, en ces temps de guerre en Ukraine et en Syrie et de défi terroriste – sans oublier la crise migratoire. »
C'est aussi le rappel fait par l'administration américaine qui, depuis le début de la crise, encourage à trouver au plus vite un accord. C'est enfin l'histoire même de la construction européenne qui est en jeu, histoire qui a été forgée par de grands gestes politiques. La réconciliation franco-allemande De Gaulle-Adenauer ; la réunification allemande ; l'élargissement à l'Europe centrale après l'effondrement de l'URSS. Faut-il rappeler que sur de seules bases comptables ou technocratiques, jamais le Portugal ou la Grèce n'auraient intégré ce qui s'appelait alors la CEE ? Rappeler que la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l'Union européenne sans satisfaire à tous les critères d'adhésion ?
C'est ce projet d'une Europe ouverte, multiple parce que pluraliste, solidaire mais non uniforme, laissant aux États membres de larges marges de manœuvre politiques sans lesquelles il n'y a pas de démocratie, que l'Allemagne se révèle aujourd'hui combattre farouchement avec l'exemple grec. C'est un événement aux conséquences incalculables. Il va, dans les années à venir, remodeler en profondeur le projet européen.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
+1 surtout qu'ils déconnent sévère.
Les institutions européennes viennent, à l'instigation notamment du gouvernement allemand, de s'acharner pendant de longs mois sur le gouvernement grec d'Alexis Tsipras, accusé de ne pas vouloir respecter les règles communes et les accords passés.
Il existe pourtant en Europe, un autre délinquant qui ne respecte pas lui non plus ces règles : il s'agit de l'Allemagne. Et les conséquences pour l'Europe de l'indiscipline allemande sont en réalité beaucoup plus lourdes encore que les difficultés grecques compte tenu de la taille de son économie (le PIB allemand pèse 17 fois plus que le PIB grec...). Mais curieusement, cela n'inquiète personne, ni à Berlin ni à Bruxelles...
Eurostat a publié fin 2014 des « indicateurs pour la détection précoce des déséquilibres macro-économiques ». Il s'agit d'une procédure nouvelle mise en place dans le cadre du « 6 pack » décidé fin 2011 pour mieux suivre la situation économique des pays européens et éviter ainsi le renouvellement de la crise de la zone euro. Celle-ci a été due en effet pour une bonne part au fait qu'on ne suivait jusque-là que les déficits et les dettes publics des Etats membres de la zone, alors que ce sont en réalité, à l'exception du cas particulier grec, d'abord les déficits et les dettes privés excessifs qui ont causé la crise.
Parmi ces indicateurs supplémentaires, on a ajouté notamment un indicateur de déficits, mais aussi d'excédents extérieurs. En effet un déficit extérieur excessif implique nécessairement le recours à des financements extérieurs qui peuvent, en cas de crise, devenir très problématiques comme on l'a constaté depuis 2009. La barre des déficits extérieurs excessifs a été placée à 4 % du PIB.
Mais des excédents extérieurs excessifs ne sont pas moins problématiques : ils indiquent que le pays concerné vit en dessous de ses moyens et ne contribue pas autant qu'il le pourrait (ou devrait) à alimenter la demande intérieure – et donc l'activité et l'emploi – au sein de la zone euro. Pour ces excédents, il a été décidé cependant de placer la barre très haut – 6 % du produit intérieur brut (PIB) en moyenne sur trois ans –, avant que ceux-ci soient considérés comme excessifs et entraînent des sanctions éventuelles de la part de la Commission.
Il n'y avait aucune autre raison de placer cette barre aussi haut que la volonté de ne pas faire de peine à l'Allemagne qui connaissait déjà à ce moment-là des excédents très importants. Malgré cela, l'Allemagne a quand même dépassé cette limite en 2012, 2013 et 2014. Et est bien partie pour renouveler l'exploit en 2015.
Le gouvernement allemand est très à cheval sur le respect des règles communes en Europe, mais ce dépassement-là ne suscite guère d'émotion outre-Rhin. Nio à Bruxelles : on attend toujours que la Commission européenne engage des procédures et menace nos voisins de sanctions à ce sujet. Pourtant ces excédents excessifs sont une composante non négligeable des difficultés persistantes de l'économie européenne à rattraper le retard qu'elle a pris depuis 2008. Cette insuffisance massive et chronique de la demande intérieure allemande nuit en particulier beaucoup à l'économie française et explique une part non négligeable de nos difficultés actuelles. Que fait la police ?
http://www.alterecoplus.fr/europe/excedents-allemands-que-fait-la-police-201412121643-00000392.html
Les institutions européennes viennent, à l'instigation notamment du gouvernement allemand, de s'acharner pendant de longs mois sur le gouvernement grec d'Alexis Tsipras, accusé de ne pas vouloir respecter les règles communes et les accords passés.
Il existe pourtant en Europe, un autre délinquant qui ne respecte pas lui non plus ces règles : il s'agit de l'Allemagne. Et les conséquences pour l'Europe de l'indiscipline allemande sont en réalité beaucoup plus lourdes encore que les difficultés grecques compte tenu de la taille de son économie (le PIB allemand pèse 17 fois plus que le PIB grec...). Mais curieusement, cela n'inquiète personne, ni à Berlin ni à Bruxelles...
Eurostat a publié fin 2014 des « indicateurs pour la détection précoce des déséquilibres macro-économiques ». Il s'agit d'une procédure nouvelle mise en place dans le cadre du « 6 pack » décidé fin 2011 pour mieux suivre la situation économique des pays européens et éviter ainsi le renouvellement de la crise de la zone euro. Celle-ci a été due en effet pour une bonne part au fait qu'on ne suivait jusque-là que les déficits et les dettes publics des Etats membres de la zone, alors que ce sont en réalité, à l'exception du cas particulier grec, d'abord les déficits et les dettes privés excessifs qui ont causé la crise.
Parmi ces indicateurs supplémentaires, on a ajouté notamment un indicateur de déficits, mais aussi d'excédents extérieurs. En effet un déficit extérieur excessif implique nécessairement le recours à des financements extérieurs qui peuvent, en cas de crise, devenir très problématiques comme on l'a constaté depuis 2009. La barre des déficits extérieurs excessifs a été placée à 4 % du PIB.
Mais des excédents extérieurs excessifs ne sont pas moins problématiques : ils indiquent que le pays concerné vit en dessous de ses moyens et ne contribue pas autant qu'il le pourrait (ou devrait) à alimenter la demande intérieure – et donc l'activité et l'emploi – au sein de la zone euro. Pour ces excédents, il a été décidé cependant de placer la barre très haut – 6 % du produit intérieur brut (PIB) en moyenne sur trois ans –, avant que ceux-ci soient considérés comme excessifs et entraînent des sanctions éventuelles de la part de la Commission.
Il n'y avait aucune autre raison de placer cette barre aussi haut que la volonté de ne pas faire de peine à l'Allemagne qui connaissait déjà à ce moment-là des excédents très importants. Malgré cela, l'Allemagne a quand même dépassé cette limite en 2012, 2013 et 2014. Et est bien partie pour renouveler l'exploit en 2015.
Le gouvernement allemand est très à cheval sur le respect des règles communes en Europe, mais ce dépassement-là ne suscite guère d'émotion outre-Rhin. Nio à Bruxelles : on attend toujours que la Commission européenne engage des procédures et menace nos voisins de sanctions à ce sujet. Pourtant ces excédents excessifs sont une composante non négligeable des difficultés persistantes de l'économie européenne à rattraper le retard qu'elle a pris depuis 2008. Cette insuffisance massive et chronique de la demande intérieure allemande nuit en particulier beaucoup à l'économie française et explique une part non négligeable de nos difficultés actuelles. Que fait la police ?
http://www.alterecoplus.fr/europe/excedents-allemands-que-fait-la-police-201412121643-00000392.html
Carl Lang ou le physique de l'emploi
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage, beaucoup de douleurs pour peu de résultats (Desproges)
ya pas de nazis dans indiana jones. juste des gens qui ont une vision un peu différente du monde. respectez les différences merde. c est ca la tolérance. bande de fascistes.
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
krouw2 a écrit:si y a un pays qui doit sortir de l' Euro c'est l' Allemagne d' Angela Mékouille
J'ai du mal à comprendre. On établit des règles. L'Allemagne les respecte. Tout comme d'autres pays (Finlande, Netherlands, Portugal...). Et ça serait le mal absolu? L'Allemagne a prete beaucoup d'argent à la Grèce. C'est Nazi?
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait sanctionner les pays sérieux au motif qu'ils ont des résultats positifs.
- ancien posteur
- Retour
BOUM ! pfff qui relance...
c'est sans fin vot' truc en fait ?
c'est sans fin vot' truc en fait ?
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
La bourde de F. Hollande : «Si l’Iran a la bombe, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe…»
François Hollande a eu un entretien du 14 Juillet avec Claire Chazal et David Pujadas.
On attendait François Hollande sur la Grèce, mais c’est à propos de l’accord sur le nucléaire iranien que le Président a eu la sortie la plus inattendue. Une vraie perle en réalité. Voulant justifier l’interdiction faite à l’Iran de posséder la bombe, il a mis en garde contre les risques de « prolifération ».
« Si l’Iran a la bombe, a-t-il dit, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe… » Feignant d’ignorer qu’Israël possède déjà plusieurs centaines de têtes nucléaires.
Je ne suis pas pour la France qui se tait, la France rabougrie, la France qui voudrait se diviser. Je laisse ça à d’autres. Il ne faut pas toucher à l’âme française», a lancé François Hollande, qui veut défendre une «certaine idée de la France», comme disait de Gaulle
Comme on pouvait le prévoir, François Hollande ne s’est pas privé de faire valoir son bilan dans le dossier grec. «Je ne dis pas que c’est la France qui a gagné», a-t-il dit. Mais, visiblement, il le pense très fort… Sur le fond, il s’en est tenu à une langue de bois impeccable. Non, la Grèce n’a pas été humiliée, «l’humiliation aurait été que la Grèce soit licenciée» de la zone euro.
Pour le reste, rien de neuf. Il sera candidat en 2017 s’il inverse la courbe du chômage. Sans que l’on sache très bien s’il s’agit de la baisse réelle du chômage ou du «ralentissement de la hausse »… Finalement, les mauvaises langues diront que l’information la plus importante est venue tout près de la conclusion de cet entretien plus rituel que jamais lorsqu’en réponse à une question, il a affirmé : «Je suis un homme de gauche»…
François Hollande a eu un entretien du 14 Juillet avec Claire Chazal et David Pujadas.
On attendait François Hollande sur la Grèce, mais c’est à propos de l’accord sur le nucléaire iranien que le Président a eu la sortie la plus inattendue. Une vraie perle en réalité. Voulant justifier l’interdiction faite à l’Iran de posséder la bombe, il a mis en garde contre les risques de « prolifération ».
« Si l’Iran a la bombe, a-t-il dit, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe… » Feignant d’ignorer qu’Israël possède déjà plusieurs centaines de têtes nucléaires.
Je ne suis pas pour la France qui se tait, la France rabougrie, la France qui voudrait se diviser. Je laisse ça à d’autres. Il ne faut pas toucher à l’âme française», a lancé François Hollande, qui veut défendre une «certaine idée de la France», comme disait de Gaulle
Comme on pouvait le prévoir, François Hollande ne s’est pas privé de faire valoir son bilan dans le dossier grec. «Je ne dis pas que c’est la France qui a gagné», a-t-il dit. Mais, visiblement, il le pense très fort… Sur le fond, il s’en est tenu à une langue de bois impeccable. Non, la Grèce n’a pas été humiliée, «l’humiliation aurait été que la Grèce soit licenciée» de la zone euro.
Pour le reste, rien de neuf. Il sera candidat en 2017 s’il inverse la courbe du chômage. Sans que l’on sache très bien s’il s’agit de la baisse réelle du chômage ou du «ralentissement de la hausse »… Finalement, les mauvaises langues diront que l’information la plus importante est venue tout près de la conclusion de cet entretien plus rituel que jamais lorsqu’en réponse à une question, il a affirmé : «Je suis un homme de gauche»…
"Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail" françois rebsamen
La bourde de F. Hollande : «Si l’Iran a la bombe, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe…»
François Hollande a eu un entretien du 14 Juillet avec Claire Chazal et David Pujadas.
On attendait François Hollande sur la Grèce, mais c’est à propos de l’accord sur le nucléaire iranien que le Président a eu la sortie la plus inattendue. Une vraie perle en réalité. Voulant justifier l’interdiction faite à l’Iran de posséder la bombe, il a mis en garde contre les risques de « prolifération ».
« Si l’Iran a la bombe, a-t-il dit, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe… » Feignant d’ignorer qu’Israël possède déjà plusieurs centaines de têtes nucléaires.
Je ne suis pas pour la France qui se tait, la France rabougrie, la France qui voudrait se diviser. Je laisse ça à d’autres. Il ne faut pas toucher à l’âme française», a lancé François Hollande, qui veut défendre une «certaine idée de la France», comme disait de Gaulle
Comme on pouvait le prévoir, François Hollande ne s’est pas privé de faire valoir son bilan dans le dossier grec. «Je ne dis pas que c’est la France qui a gagné», a-t-il dit. Mais, visiblement, il le pense très fort… Sur le fond, il s’en est tenu à une langue de bois impeccable. Non, la Grèce n’a pas été humiliée, «l’humiliation aurait été que la Grèce soit licenciée» de la zone euro.
Pour le reste, rien de neuf. Il sera candidat en 2017 s’il inverse la courbe du chômage. Sans que l’on sache très bien s’il s’agit de la baisse réelle du chômage ou du «ralentissement de la hausse »… Finalement, les mauvaises langues diront que l’information la plus importante est venue tout près de la conclusion de cet entretien plus rituel que jamais lorsqu’en réponse à une question, il a affirmé : «Je suis un homme de gauche»…
François Hollande a eu un entretien du 14 Juillet avec Claire Chazal et David Pujadas.
On attendait François Hollande sur la Grèce, mais c’est à propos de l’accord sur le nucléaire iranien que le Président a eu la sortie la plus inattendue. Une vraie perle en réalité. Voulant justifier l’interdiction faite à l’Iran de posséder la bombe, il a mis en garde contre les risques de « prolifération ».
« Si l’Iran a la bombe, a-t-il dit, l’Arabie saoudite et Israël voudront la bombe… » Feignant d’ignorer qu’Israël possède déjà plusieurs centaines de têtes nucléaires.
Je ne suis pas pour la France qui se tait, la France rabougrie, la France qui voudrait se diviser. Je laisse ça à d’autres. Il ne faut pas toucher à l’âme française», a lancé François Hollande, qui veut défendre une «certaine idée de la France», comme disait de Gaulle
Comme on pouvait le prévoir, François Hollande ne s’est pas privé de faire valoir son bilan dans le dossier grec. «Je ne dis pas que c’est la France qui a gagné», a-t-il dit. Mais, visiblement, il le pense très fort… Sur le fond, il s’en est tenu à une langue de bois impeccable. Non, la Grèce n’a pas été humiliée, «l’humiliation aurait été que la Grèce soit licenciée» de la zone euro.
Pour le reste, rien de neuf. Il sera candidat en 2017 s’il inverse la courbe du chômage. Sans que l’on sache très bien s’il s’agit de la baisse réelle du chômage ou du «ralentissement de la hausse »… Finalement, les mauvaises langues diront que l’information la plus importante est venue tout près de la conclusion de cet entretien plus rituel que jamais lorsqu’en réponse à une question, il a affirmé : «Je suis un homme de gauche»…
"Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail" françois rebsamen
pfff... a écrit:krouw2 a écrit:si y a un pays qui doit sortir de l' Euro c'est l' Allemagne d' Angela Mékouille
J'ai du mal à comprendre. On établit des règles. L'Allemagne les respecte. Tout comme d'autres pays (Finlande, Netherlands, Portugal...). Et ça serait le mal absolu?
Il y a des règles que tous les pays de la zone euro ont signé en connaissance de cause. Avec 15 ans de recul, on réalise que ces règles ne fonctionnent pas. L'Europe du sud est laminée, la France sur une pente glissante. Sans partage de la souveraineté et des risques, une zone monétaire entre états ne peut pas fonctionner. Dans le cadre institutionnel actuel l'euro n'est pas viable. C'est juste une zone de compétition économique entre les états membres, chaque pays ne poursuit que ses propres intérêts, avec bcp trop peu de coopération et de mécanismes régulateurs. Les écarts ne font que se creuser entre les pays du nord les mieux armés, Allemagne en tête, et les autres. Combien de pays ont subi une cure d'austérité depuis les débuts de l'euro?
Partage de la souveraineté la France (et sans doute d'autres) n'en veut pas. On voit bien actuellement que partager la souveraineté dans la zone euro, c'est s'en remettre au plus fort, c'est à dire l'Allemagne.
Partager les risques c'est à dire les dettes, les allemands ne veulent pas en entendre parler.
Soit on réforme profondément la gouvernance de l'euro (on parle d'un parlement de la zone euro, d'un budget dédié...), soit on réfléchit à un démontage organisé de l'euro, soit on ne change rien, on laisse monter le sentiment anti-européen partout et aura l'extrême-droite non plus à 30 mais à plus de 50% tôt ou tard dans certains pays.
pfff... a écrit: L'Allemagne a prete beaucoup d'argent à la Grèce. C'est Nazi?
L'Allemagne, comme la France, a prêté bcp d'argent pour que leurs banques, très exposées, récupèrent leur billes.
Dans les centaines de miyards qui sont prêtés à la Grèce, la grande majorité sert à... rembourser l'argent qu'on leur a prêté, et pas à financer l'état grec. Ils sont dans une spirale d'endettement sans fin, comme les pays du tiers-monde. Et la mascarade de ce we ne règle rien, le FMI prévoit déjà qu'avec les mesures imposées leur dette publique va passer à 200% du PIB, et qu'un effacement partiel de l'ardoise est inévitable.
Prochain épisode du feuilleton grec dans 3 mois.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Dogue-son a écrit:Pourtant, tous ces pays sont repartis avec une croissance du PIB.
Le seul qui chute toujours c'est la Grèce.
Il y a donc un cas grec spécifique.
Euh c'est les courbes du PIB ça?
Ca me paraît bizarre la progression digne des 30 glorieuses.
Depuis les années 2000 la croissance annuelle oscille entre 0 et 2%, on a plus qu'un doublement pour la Belgique ou l'Autriche...
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Dans le cadre institutionnel actuel l'euro n'est pas viable. C'est juste une zone de compétition économique entre les états membres, chaque pays ne poursuit que ses propres intérêts, avec bcp trop peu de coopération et de mécanismes régulateurs. Les écarts ne font que se creuser entre les pays du nord les mieux armés, Allemagne en tête, et les autres. Combien de pays ont subi une cure d'austérité depuis les débuts de l'euro?
Partage de la souveraineté la France (et sans doute d'autres) n'en veut pas. On voit bien actuellement que partager la souveraineté dans la zone euro, c'est s'en remettre au plus fort, c'est à dire l'Allemagne.
Partager les risques c'est à dire les dettes, les allemands ne veulent pas en entendre parler.
Je n"ai pas l'éxpertise necessaire pour te contredire. Mais pourquoi les pays du nord seraient ils mieux armes que ceux du sud? Est ce de la faute allemande si les espagnols ont investis des milliards dans des aeroport ou des rond points bidons? Ce n est pas les allemands qui ont dit aux Grecs qu ils auraient tous une retraite doree. Ce n est pas les allemands qui encouragent la france a embaucher continuellement des fonctionnaires avec des retraites faramineuses.
Le probleme n est pas d etre riche ou pauvre. Le probleme est de depenser l argent que tu n as pas. Et cést bien un mal latin.
De mon point de vue, les pays du club Med, France inclus, devraient remercier les pays du nord pour toutes ces lecons d economie.
Partage de la souveraineté la France (et sans doute d'autres) n'en veut pas. On voit bien actuellement que partager la souveraineté dans la zone euro, c'est s'en remettre au plus fort, c'est à dire l'Allemagne.
Partager les risques c'est à dire les dettes, les allemands ne veulent pas en entendre parler.
Je n"ai pas l'éxpertise necessaire pour te contredire. Mais pourquoi les pays du nord seraient ils mieux armes que ceux du sud? Est ce de la faute allemande si les espagnols ont investis des milliards dans des aeroport ou des rond points bidons? Ce n est pas les allemands qui ont dit aux Grecs qu ils auraient tous une retraite doree. Ce n est pas les allemands qui encouragent la france a embaucher continuellement des fonctionnaires avec des retraites faramineuses.
Le probleme n est pas d etre riche ou pauvre. Le probleme est de depenser l argent que tu n as pas. Et cést bien un mal latin.
De mon point de vue, les pays du club Med, France inclus, devraient remercier les pays du nord pour toutes ces lecons d economie.
- ancien posteur
- Retour
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 47 invité(s)