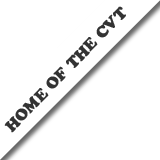[01T] Politix, fonctionnaire et Cie
Ca me parait énorme 18% pour lui... ca fait 1 français sur 5 ! Ou alors ils ont péché dans les sympathisants PS...
Je crois que le bonheur c'est d'être autiste.
Bienvenue dans un monde merde.
TAFTA > Kafka
Le traité TAFTA va-t-il délocaliser notre justice à Washington ?
Le Monde.fr | 15.04.2014 à 14h45 • Mis à jour le 15.04.2014 à 15h15 | Par Maxime Vaudano
Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en négociation entre Bruxelles et Washington.
Le principal cheval de bataille des opposants à TAFTA concerne le mécanisme de règlement des différends des entreprises (ESDS, ou investor-state dispute settlement).
De quoi s’agit-il ?
Ce type de disposition est présente dans de nombreux traités de libre-échange. Elle a pour but de donner plus de pouvoir aux entreprises face aux Etats, en permettant par exemple à une multinationale américaine d’attaquer la France ou l’Union européenne devant un tribunal arbitral international, plutôt que devant la justice française ou européenne.
L’instance privilégiée pour de tels arbitrages est le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (Cirdi), un organe dépendant de la banque mondiale basé à Washington, dont les juges sont des professeurs de droit ou des avocats d’affaire nommés au cas par cas (un arbitre nommé par l’entreprise, un par l’Etat, et le troisième par la secrétaire générale de la cour). La plupart du temps, ce type d'arbitrage exclut toute possibilité de faire appel.
Ce que les adversaires de TAFTA disent
« Grâce à TAFTA, les entreprises américaines d’exploitation pourront porter plainte contre l’Etat qui leur refuse des permis, au nom de la libre concurrence », assurent les Jeunes écologistes français. Permis d’exploitation de gaz de schiste, OGM, normes alimentaires, monopole de l’éducation nationale, standards sociaux : ce système de règlement des différends pourrait devenir, selon le porte-parole des Verts européens Yannick Jadot, un « cheval de Troie » des Américains, qui leur permettrait de faire tomber des pans entiers de la régulation européenne en créant des précédents juridiques devant la justice privée.
Pourquoi cela pourrait etre vrai
Le principe d’introduire un mécanisme de règlement des différends des entreprises (ESDS), soutenu par les Etats-Unis, a en effet été accepté par les Etats européens. Le mandat de négociation délivré en juin 2013 par les ministres du commerce européens à la Commission stipule :
« L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-État efficace et à la pointe, assurant la transparence, l’indépendance des arbitres et la prévisibilité de l’accord, y compris à travers la possibilité d’interprétation contraignante de l’accord par les Parties. »
Toutefois, cette disposition polémique a suscité une telle mobilisation que l’Europe pourrait faire marche arrière. Le 21 janvier, le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, a décidé de suspendre les négociations avec les Etats-Unis sur l’ESDS, le temps de lancer une consultation publique en ligne, qui durera jusqu’à 21 juin. Une manière de désamorcer la contestation et d’éviter que le sujet ne pèse sur les élections européennes du 25 mai.
Bruxelles est-elle pour autant disposée à retirer cette procédure du traité ? Pas vraiment, à en croire le même Karel de Gucht, qui affirme souhaiter que la consultation « améliore » l’ESDS, sans jamais évoquer une possible suppression.
Pressés par l’opinion publique, les gouvernements des Etats européens se montrent moins inflexibles, et leur avis sera déterminant dans la ratification finale du traité. En mars, la secrétaire d’Etat allemande à l’économie Brigitte Zypries déclarait que Berlin était désormais opposé à l’ESDS. En France, la ministre déléguée au commerce extérieur, Nicole Bricq, avait déjà plusieurs fois répété que la France n’était « pas favorable à l’inclusion d’un tel mécanisme », avant de passer la main à Fleur Pellerin en avril.
Pourquoi cela pourrait être grave
L'expérience montre que le mise en place de mécanismes d'arbitrage international tend à favoriser les entreprises, au détriment des Etats. En effet, les entreprises obtiennent rarement gain de cause devant les juridictions des Etats qu'elles attaquent, à l'image du pétrolier Schuepbach, débouté par le Conseil constitutionnel quand il a contesté le moratoire français sur le gaz de schiste.
Délocaliser le règlement des différends des conflits vers une cour internationale place, à l'inverse, Etats et entreprises sur un plan d'égalité, favorisant du même coup les intérêts commerciaux, comme de nombreux précédents le confirment.
En 2012, l’Equateur a été condamné à payer 1,77 milliards de dollars à Occidental Petroleum par le Cirdi. Sa faute : avoir mis fin par une décision politique à sa collaboration avec le géant pétrolier après que celui-ci eut lui-même violé leur contrat. Le tribunal arbitral a jugé que cette décision soudaine violait le traité d’investissement bilatéral Etats-Unis-Equateur.
Autre exemple : le cigarettier Philip Morris a utilisé en 2010 et 2011 le mécanisme d’arbitrage pour réclamer plusieurs milliards de dollars de réparation à l’Uruguay et l’Australie, qui mènent des campagnes anti-tabagisme, contraires selon lui à leurs accords de libre-échange respectifs avec la Suisse et Hong-Kong.
Ce cas n’ont cessé de se multiplier au cours des vingt dernières années, avec la popularité croissante des accords de libre-échange. Sans garde-fous, l’introduction d’un ESDS dans le partenariat translatlantique pourrait donc coûter cher à l’Europe et la contraindre à abandonner certains de ses principes.
TAFTA > Kafka
Le traité TAFTA va-t-il délocaliser notre justice à Washington ?
Le Monde.fr | 15.04.2014 à 14h45 • Mis à jour le 15.04.2014 à 15h15 | Par Maxime Vaudano
Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en négociation entre Bruxelles et Washington.
Le principal cheval de bataille des opposants à TAFTA concerne le mécanisme de règlement des différends des entreprises (ESDS, ou investor-state dispute settlement).
De quoi s’agit-il ?
Ce type de disposition est présente dans de nombreux traités de libre-échange. Elle a pour but de donner plus de pouvoir aux entreprises face aux Etats, en permettant par exemple à une multinationale américaine d’attaquer la France ou l’Union européenne devant un tribunal arbitral international, plutôt que devant la justice française ou européenne.
L’instance privilégiée pour de tels arbitrages est le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (Cirdi), un organe dépendant de la banque mondiale basé à Washington, dont les juges sont des professeurs de droit ou des avocats d’affaire nommés au cas par cas (un arbitre nommé par l’entreprise, un par l’Etat, et le troisième par la secrétaire générale de la cour). La plupart du temps, ce type d'arbitrage exclut toute possibilité de faire appel.
Ce que les adversaires de TAFTA disent
« Grâce à TAFTA, les entreprises américaines d’exploitation pourront porter plainte contre l’Etat qui leur refuse des permis, au nom de la libre concurrence », assurent les Jeunes écologistes français. Permis d’exploitation de gaz de schiste, OGM, normes alimentaires, monopole de l’éducation nationale, standards sociaux : ce système de règlement des différends pourrait devenir, selon le porte-parole des Verts européens Yannick Jadot, un « cheval de Troie » des Américains, qui leur permettrait de faire tomber des pans entiers de la régulation européenne en créant des précédents juridiques devant la justice privée.
Pourquoi cela pourrait etre vrai
Le principe d’introduire un mécanisme de règlement des différends des entreprises (ESDS), soutenu par les Etats-Unis, a en effet été accepté par les Etats européens. Le mandat de négociation délivré en juin 2013 par les ministres du commerce européens à la Commission stipule :
« L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-État efficace et à la pointe, assurant la transparence, l’indépendance des arbitres et la prévisibilité de l’accord, y compris à travers la possibilité d’interprétation contraignante de l’accord par les Parties. »
Toutefois, cette disposition polémique a suscité une telle mobilisation que l’Europe pourrait faire marche arrière. Le 21 janvier, le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht, a décidé de suspendre les négociations avec les Etats-Unis sur l’ESDS, le temps de lancer une consultation publique en ligne, qui durera jusqu’à 21 juin. Une manière de désamorcer la contestation et d’éviter que le sujet ne pèse sur les élections européennes du 25 mai.
Bruxelles est-elle pour autant disposée à retirer cette procédure du traité ? Pas vraiment, à en croire le même Karel de Gucht, qui affirme souhaiter que la consultation « améliore » l’ESDS, sans jamais évoquer une possible suppression.
Pressés par l’opinion publique, les gouvernements des Etats européens se montrent moins inflexibles, et leur avis sera déterminant dans la ratification finale du traité. En mars, la secrétaire d’Etat allemande à l’économie Brigitte Zypries déclarait que Berlin était désormais opposé à l’ESDS. En France, la ministre déléguée au commerce extérieur, Nicole Bricq, avait déjà plusieurs fois répété que la France n’était « pas favorable à l’inclusion d’un tel mécanisme », avant de passer la main à Fleur Pellerin en avril.
Pourquoi cela pourrait être grave
L'expérience montre que le mise en place de mécanismes d'arbitrage international tend à favoriser les entreprises, au détriment des Etats. En effet, les entreprises obtiennent rarement gain de cause devant les juridictions des Etats qu'elles attaquent, à l'image du pétrolier Schuepbach, débouté par le Conseil constitutionnel quand il a contesté le moratoire français sur le gaz de schiste.
Délocaliser le règlement des différends des conflits vers une cour internationale place, à l'inverse, Etats et entreprises sur un plan d'égalité, favorisant du même coup les intérêts commerciaux, comme de nombreux précédents le confirment.
En 2012, l’Equateur a été condamné à payer 1,77 milliards de dollars à Occidental Petroleum par le Cirdi. Sa faute : avoir mis fin par une décision politique à sa collaboration avec le géant pétrolier après que celui-ci eut lui-même violé leur contrat. Le tribunal arbitral a jugé que cette décision soudaine violait le traité d’investissement bilatéral Etats-Unis-Equateur.
Autre exemple : le cigarettier Philip Morris a utilisé en 2010 et 2011 le mécanisme d’arbitrage pour réclamer plusieurs milliards de dollars de réparation à l’Uruguay et l’Australie, qui mènent des campagnes anti-tabagisme, contraires selon lui à leurs accords de libre-échange respectifs avec la Suisse et Hong-Kong.
Ce cas n’ont cessé de se multiplier au cours des vingt dernières années, avec la popularité croissante des accords de libre-échange. Sans garde-fous, l’introduction d’un ESDS dans le partenariat translatlantique pourrait donc coûter cher à l’Europe et la contraindre à abandonner certains de ses principes.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Le traité TAFTA va-t-il créer des millions d'emplois ?
Le Monde.fr | 15.04.2014 à 14h44 • Mis à jour le 15.04.2014 à 15h15 | Par Maxime Vaudano
Selon Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce, le partenariat transatlantique pourrait créer deux millions d'emplois.
Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en négociation entre Bruxelles et Washington.
Ce que les promoteurs de TAFTA disent :
Au lancement officiel des négociations, en juin 2013, le premier ministre britannique David Cameron a promis que TAFTA permettrait de créer « deux millions d’emplois » aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. En octobre, le négociateur en chef européen, le commissaire Karel de Gucht, parlait encore de « millions d’emplois ».
Pourquoi c’est plus qu'incertain
Les études sur l’impact qu’aurait l’ouverture d’un grand marché transatlantique ont une fâcheuse tendance à diverger, comme le souligne Rue89. Le gain de PIB attendu à moyen-terme varie ainsi entre 0,01 et 0,05 points par an sur la première décennie : selon le scénario, les effets sur l’emploi pourraient donc fortement varier.
ATTAC assure même que la signature de TAFTA conduirait à des « destructions massives d’emplois » en Europe, notamment dans l’agriculture, qui serait écrasée par la concurrence américaine. A l’appui de sa thèse, l’organisation cite le précédent de l’ALENA, la zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique lancée en 1993. Alors que Bill Clinton promettait à l’époque 20 millions d’emplois, une analyse de l’Economic Policy Institute (EPI) a montré dix ans plus tard que l’Alena a eu l’effet inverse sur l’économie américaine. L’augmentation des exportations n’a pas compensé la concurrence exacerbée et l’importation de produits étrangers, provoquant la destruction nette de près de 900 000 emplois.
Il reste aujourd’hui très difficile de formuler des prévisions, en l’absence de données suffisamment qualitatives, comme l’a relevé un rapport très critique du Parlement européen. Selon son auteur, l'étude sur laquelle s'appuie la Commission européenne pour ses prévisions optimistes a complètement négligé les impacts potentiels de TAFTA sur les secteurs les plus fragiles face à la concurrence (agriculture, metallurgie, transports), se concentrant uniquement sur les bénéfices attendus de ce partenariat.
Le Monde.fr | 15.04.2014 à 14h44 • Mis à jour le 15.04.2014 à 15h15 | Par Maxime Vaudano
Selon Karel de Gucht, le commissaire européen au commerce, le partenariat transatlantique pourrait créer deux millions d'emplois.
Les Décodeurs décryptent le traité de libre-échange transatlantique TAFTA, actuellement en négociation entre Bruxelles et Washington.
Ce que les promoteurs de TAFTA disent :
Au lancement officiel des négociations, en juin 2013, le premier ministre britannique David Cameron a promis que TAFTA permettrait de créer « deux millions d’emplois » aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. En octobre, le négociateur en chef européen, le commissaire Karel de Gucht, parlait encore de « millions d’emplois ».
Pourquoi c’est plus qu'incertain
Les études sur l’impact qu’aurait l’ouverture d’un grand marché transatlantique ont une fâcheuse tendance à diverger, comme le souligne Rue89. Le gain de PIB attendu à moyen-terme varie ainsi entre 0,01 et 0,05 points par an sur la première décennie : selon le scénario, les effets sur l’emploi pourraient donc fortement varier.
ATTAC assure même que la signature de TAFTA conduirait à des « destructions massives d’emplois » en Europe, notamment dans l’agriculture, qui serait écrasée par la concurrence américaine. A l’appui de sa thèse, l’organisation cite le précédent de l’ALENA, la zone de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique lancée en 1993. Alors que Bill Clinton promettait à l’époque 20 millions d’emplois, une analyse de l’Economic Policy Institute (EPI) a montré dix ans plus tard que l’Alena a eu l’effet inverse sur l’économie américaine. L’augmentation des exportations n’a pas compensé la concurrence exacerbée et l’importation de produits étrangers, provoquant la destruction nette de près de 900 000 emplois.
Il reste aujourd’hui très difficile de formuler des prévisions, en l’absence de données suffisamment qualitatives, comme l’a relevé un rapport très critique du Parlement européen. Selon son auteur, l'étude sur laquelle s'appuie la Commission européenne pour ses prévisions optimistes a complètement négligé les impacts potentiels de TAFTA sur les secteurs les plus fragiles face à la concurrence (agriculture, metallurgie, transports), se concentrant uniquement sur les bénéfices attendus de ce partenariat.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Des miyons d'emplois, konvoudi.
Je ne comprends pas comment les dirigeants européens se laissent convaincre de s'embarquer dans un tel merdier. A noter qu'Hollande, l'ennemi de la finance, veut que les négociations aboutissent le plus vite possible, et qu'on en parle le moins possible évidemment.
Je ne comprends pas comment les dirigeants européens se laissent convaincre de s'embarquer dans un tel merdier. A noter qu'Hollande, l'ennemi de la finance, veut que les négociations aboutissent le plus vite possible, et qu'on en parle le moins possible évidemment.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Arguments pour en finir avec l'euro
11 avril 2014 | Par Ludovic Lamant
À l'approche des élections européennes, deux livres plaident pour l'éclatement de la zone euro – seule manière, aux yeux de leurs auteurs, de rompre avec les cadres actuels de l'UE, et de retrouver des marges de manœuvre économiques. Premier intérêt : ces ouvrages se réapproprient un sujet monopolisé par le Front national dans les médias, pour tenter d'en faire l'un des axes d'une politique de gauche.
Depuis le surgissement de la crise en Europe, c'est devenu un sous-genre éditorial en soi : les livres qui prédisent l'éclatement de la zone euro se multiplient. Ils sont écrits par des fédéralistes déçus (La Fin du rêve européen, de François Heisbourg chez Stock), des élus souverainistes en campagne (L'Euro, les banquiers et la mondialisation, de Nicolas Dupont-Aignan, éditions du Rocher) ou des économistes majoritairement classés à gauche (Désobéir pour sauver l'Europe, Steve Ohana, chez Max Milo, Sortons de l'euro!, Jacques Nikonoff, chez Mille et une nuits, ou encore Faut-il sortir de l'euro, Jacques Sapir, au Seuil).
À l'approche des élections européennes, les éditions des Liens qui libèrent font coup double, avec deux publications qui tentent de démontrer à peu près la même chose, s'en prenant au tabou suprême : il faut en finir avec l'euro, pour mener une politique économique de gauche en France. Faisant le constat d'une « mort clinique de l'euro », les quatre journalistes auteurs de Casser l'euro jugent qu'il serait vain de « vouloir absolument le maintenir en vie artificiellement ». Sur un registre plus musclé – et plus ambitieux –, Frédéric Lordon, directeur de recherches du CNRS et blogueur vedette 3 sur le site du Monde diplomatique, dénonce La Malfaçon à l'origine des déboires français, et propose de récupérer la « souveraineté politique ».
Ce foisonnement éditorial, avec des livres souvent très documentés, prouve-t-il que certaines digues sont en train de se fissurer ? Que les rapports de force évoluent ? Les déçus de l'euro sont en tout cas de plus en plus nombreux. « Les gens sont en train de piger », estimait le démographe Emmanuel Todd dans un récent article 3 du Monde.
De là à plaider pour la fin de l'euro ? L'état alarmant de l'Union – près de 26 millions de chômeurs dans l'UE, des pays comme la Grèce et le Portugal assommés, et l'horizon bouché – explique sans doute en partie ces glissements. « À partir d'un certain seuil (…), la détresse de millions de chômeurs et de nouveaux pauvres nous a semblé peser davantage dans la balance que la volonté farouche, inaltérable, d'aller au bout du projet engagé dix ans plus tôt », écrivent les auteurs de Casser l'euro.
L'évolution est nette, sur fond d'aggravation de la crise sociale : ce n'est plus seulement la gestion de la crise de la zone euro qui se trouve sous les feux de la critique, mais le bien-fondé de la monnaie unique en soi. « Ni crime ni faute en soi, l'euro a été prématuré dans sa conception et contrefait dans sa mise en œuvre, conduisant l'Union européenne et les peuples de ses États membres dans une impasse qu'il est facile de décrire, mais dont il est difficile de se dégager », résume François Heisbourg, qui tente d'articuler, dans son essai, défense de l'Union et sortie de l'euro, au prix de certaines acrobaties. Même la banque suisse UBS a pris le temps 3de s'intéresser à la manière dont les unions monétaires, au fil de l'Histoire, sont mortes, dans une étude récente qui n'est pas passée inaperçue 3.
C'est une chose de reconnaître les manquements et les coûts politiques de l'euro – c'en est une autre de plaider pour sa dissolution, propositions concrètes à l'appui. Ce débat, longtemps étouffé, pourrait gagner en intensité lors de la campagne des élections européennes. En 2011, Jacques Sapir regrettait cette « particularité franco-française », qui consiste à refuser tout débat sur les vertus de la monnaie unique : « L'euro c'est la religion de ce nouveau siècle, avec ses faux prophètes aux prophéties sans cesse démenties, avec ses grands prêtres toujours prêts à fulminer une excommunication faute de pouvoir en venir aux bûchers », s'emportait l'économiste rattaché à l'EHESS. Depuis, la donne semble avoir – un peu – évolué, comme le laisse entendre ce regain d'activité éditorial.
À la veille d'une élection clé pour l'Europe, ces textes, par-delà leur intérêt très variable, présentent un mérite immédiat. Ils s'emparent à bras-le-corps d'un sujet sulfureux, quasiment monopolisé, dans les médias grand public, par le Front national, pour en faire – du côté des économistes critiques en tout cas – l'un des axes d'une politique « de gauche » à réinventer. Frédéric Lordon, qui s'était déjà beaucoup battu, en 2011, pour que la gauche n'abandonne pas au parti de Marine Le Pen le concept compliqué de « démondialisation », consacre ainsi, dans son dernier livre, un chapitre entier à « ce que l'extrême droite ne nous prendra pas ».
À ce sujet, l'économiste ne retient pas ses mots – durs – contre une frange de la gauche critique française (par exemple au sein d'Attac ou des « économistes atterrés »), qui se refuse à défendre une sortie de l'euro, « terrorisée à la pensée du moindre soupçon de collusion objective avec le FN, et qui se donne un critère si bas de cet état de collusion que le moindre regard jeté sur une de ses idées par les opportunistes d'extrême droite conduit cette gauche à abandonner l'idée – son idée – dans l'instant : irrémédiablement souillée ». Et de conclure : « À ce compte-là bien sûr, la gauche critique finira rapidement dépossédée de tout, et avec pour unique solution de quitter le débat public à poil dans un tonneau à bretelles. »
Ces différents essais prouvent donc à ceux qui en doutent encore, que l'on peut parler contre l'euro, sans reprendre pour autant les thèses du Front national. Et l'éternel argument de l'apocalypse (pour le dire vite : sortir de l'euro serait un réflexe simpliste d'apprentis sorciers, qui ne manquerait pas d'ouvrir une nouvelle crise majeure sur le continent) semble désormais un peu court pour convaincre tout à fait. Il va falloir accepter, de part et d'autre, le débat de fond. Argument contre argument. Quoi qu'on pense de l'euro et de son avenir, c'est une bonne nouvelle. Car on le sait depuis qu'on a lu André Orléan : débattre de la monnaie, c'est débattre d'un des fondements de ce qui fait société.
De la monnaie unique à la monnaie commune
Quelles sont les grandes lignes du raisonnement, dans Casser l'euro ? Premier constat : la zone euro patauge dans la crise. La monnaie unique a aggravé les disparités au sein de l'eurozone, et l'Europe du Nord bloquera tout projet de transfert budgétaire massif vers l'Europe du Sud, seul mécanisme qui permettrait de gommer ces « hétérogénéités ». Vu l'esprit des traités, et le poids de l'ordo-libéralisme 3 allemand à Bruxelles, le statu quo actuel, et les rustines qui permettent à l'euro de tenir malgré tout, finiront tôt ou tard par envoyer les pays dans le mur.
Deuxième énoncé (qui mériterait en soi des heures de débats) : le fédéralisme pourrait être une solution vertueuse au marasme ambiant, mais « il apparaît aujourd'hui hors de portée », « fruit d'un travail nécessairement long et vaste (qui) ne concorde pas avec l'urgence de la crise ». D'autant que « les électeurs et les gouvernements n'y consentent pas ». « Les fédéralistes préfèrent s'enferrer dans leur idéal inatteignable, plutôt qu'affronter un réel insupportable », tranchent les auteurs. Exit les ardents fédéralistes type Daniel Cohn-Bendit ou Guy Verhofstadt.
Conclusion : il ne reste plus qu'à plaider pour le passage d'une « monnaie unique » (l'euro) à une « monnaie commune ». Voici donc le retour à des monnaies nationales – franc, drachme, mark, etc. – mais qui ne pourraient fluctuer entre elles que dans une certaine proportion, évoluant sur le marché des changes de part et d'autre d'un cours pivot de référence. Le grand come-back du système monétaire européen ? C'est tout le problème: le SME, mis en place en 1979, a multiplié les ratés, piégé par les pressions des marchés et des spéculateurs (voir les dévaluations chaotiques du franc au début des années 1990).
C'est ici qu'on appelle Frédéric Lordon à la rescousse, qui, dans La Malfaçon, affirme avoir trouvé la parade, pour ne pas retomber dans les travers du SME d'antan. Il propose que cette convertibilité des monnaies nationales se fasse à un seul guichet, celui de la Banque centrale européenne (BCE). Mécaniquement, cela supprimerait tout marché des changes intra-européen. On en reviendrait à un guichet unique, censé provoquer à lui seul une certaine stabilité, et contourner les logiques de marché. Ce serait donc le retour à un contrôle strict des capitaux. Une manière de « réajuster dans le calme les changes intra-européens », écrit Lordon, qui entrevoit, enthousiaste, « la possibilité du découplage de la politique monétaire d'avec les marchés obligataires ».
Chez Lordon, l'entreprise ne s'arrête pas là. La dissolution de l'euro serait le point de départ d'une rupture plus vaste avec une Europe qu'il juge « structurellement de droite ». Parmi les mesures fracassantes pour rompre avec « une forme douce, juridiquement correcte, de dictature financière » (comme l'inscription de la « règle d'or » dans les traités) : défaut sur la dette souveraine et dévaluation (dans le cas de la Grèce), mais aussi nationalisation du secteur bancaire, « démocratie locale du crédit », contrôle des capitaux et « renationalisation » du financement des déficits publics (via l'épargne des ménages, pour éviter une dépendance des États aux marchés). Bref, une révolution.
.
On connaît, à ce stade, les mises en garde des défenseurs de l'euro. Première d'entre elles : les dettes des États et des ménages vont exploser. Si le retour à l'euro-franc s'accompagne d'une dévaluation massive pour doper l'économie française, le poids des dettes risque, en effet, de grimper d'autant. Faux, écrivent nos auteurs. À les lire, il suffira à l'État en question de basculer le libellé de sa dette en monnaie nationale, sans que la manœuvre n'affecte la valeur nominale de la dette. Au nom de sa souveraineté monétaire, un État pourrait décider qu'une dette d'un euro équivaudrait tout simplement à une dette d'un euro-franc. Le tour est joué.
Le raisonnement tient jusqu'à un certain point : encore faut-il que ces dettes aient été contractées sous droit français. C'est ce qu'avait découvert à ses dépens, peu après la crise de 2001, le Trésor argentin, qui n'avait pu annuler une partie de sa dette, contractée sous droit new-yorkais (et qui lui vaut encore aujourd'hui des procédures en justice). Pour savoir comment une sortie de l'euro pèserait sur le poids de la dette, il faut donc regarder dans le détail des contrats, pays par pays… L'affaire est loin d'être simple.
D'après les auteurs de Casser l'euro, pour la France, 93 % des OAT (les emprunts d'État de base) sont « made in France » (d'après des chiffres de la Banque des règlements internationaux). Ce serait donc jouable côté français. Mais, à l'échelle de l'Europe, ils avancent tout de même le chiffre de 300 milliards d'euros de dettes qui seraient problématiques (contractées sous un droit étranger). Pas de quoi se réjouir. Sauf, bien sûr, à coupler la sortie de l'euro avec des défauts massifs des États en question – ce qui aurait pour avantage de régler une bonne partie du problème à court terme.
« Miracle politique européen »
Autre inconnue : sortir de l'euro doit permettre à l'État de retrouver des marges de manœuvre, à commencer par une politique de change. La priorité, c'est de dévaluer, pour stimuler les exportations. Certes. Mais sommes-nous certains des effets positifs et durables d'une dévaluation compétitive sur l'économie ? L'interrogation est vive, en Grèce par exemple, où le tissu industriel est défait, l'appareil d'État paralysé, et l'ensemble de l'économie est à réinventer. Une dévaluation seule n'y produirait sans doute pas des effets majeurs.
Et après tout, si tout le monde dévalue en même temps, et dans tous les sens (ce qui n'est pas le scénario retenu par les auteurs des livres évoqués ici, mais ce scénario ne peut être exclu), cela pourrait aussi desservir l'ensemble des économies européennes, au bout du compte. « Tout cela fleure bon les années 1930, lorsque les pays à économie de marché s’étaient avérés incapables de s’entendre, ce qui avait conduit chacun à mener une politique de dévaluation compétitive et de repli protectionniste : l’effet fut d’amplifier la dépression générale et de l’étendre quasiment au monde entier », s'inquiétait en début d'année 3 la revue Vacarme dans un texte sur l'Europe.
La facture énergétique des Européens menacerait, elle aussi, de s'envoler (puisqu'elle est libellée en dollars, pour les Européens). Les auteurs de Casser l'euro ne le nient pas. Tout au plus précisent-ils que la hausse de la facture ne serait pas aussi importante qu'on ne le pense (une dévaluation de 25 % entraînerait une hausse de 6,25 % des prix à la pompe, selon les calculs de Jacques Sapir). À chaque fois, les partisans d'une sortie de l'euro reconnaissent de véritables risques liés à la sortie de l'euro, mais s'en tiennent à l'argument suivant : ces risques seront fortement amortis si l'on se prépare à une sortie de l'euro, inévitable à leurs yeux, plutôt que l'on ne la subit. Et au bout du compte, ces risques et surcoûts ne pèsent pas lourds, si on les compare aux coûts des solutions qui permettront de préserver l'euro. On a connu arguments plus mobilisateurs, mais la logique se tient.
Autre point délicat, à la lecture du livre de Frédéric Lordon : à force de critiquer l'échelon européen, qu'il abhorre, l'économiste tend à sérieusement idéaliser le niveau national. On le cite : « La solution nationale a pour propriété que les structures institutionnelles et symboliques de la souveraineté y sont toutes armées et immédiatement disponibles, c'est-à-dire instantanément réactivables, robuste vertu pratique en situation d'urgence extrême. » Et plus loin : « Personne n'a dit, ni ne dira, qu'une lutte ouverte au niveau national serait facile. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle sera plus facile » – en particulier parce que le retour au national revient à « déconstitutionnaliser le problème », en « envoyant promener les traités ».
L'argument se tient, mais l'affaire n'est sans doute pas aussi évidente. Les rapports de force seront-ils automatiquement plus favorables à l'échelon national, pour défendre les idées de cette gauche critique ? Vu l'état de déliquescence des institutions en France, l'organisation de la Ve République, et le niveau du débat sur les questions économiques, il est toutefois permis d'en douter.
On peut même aller plus loin : il se forme parfois, au sein du parlement européen, des majorités de gauche plus radicales, sur certaines questions décisives (voir le rejet du traité ACTA, ou le travail de la commission « libertés civiles » sur l'espionnage américain) que celles que l'on observe à Paris. Même la commission européenne s'est mise à s'inquiéter 3, depuis la fin d'année dernière, de l'ampleur des déséquilibres… de l'économie allemande. De ce point de vue, la gauche critique aurait alors tout intérêt à investir, de manière pragmatique, tous les échelons – locaux, nationaux, européens – pour mener la bataille politique…
Et si l'on ne peut qu'être d'accord avec l'économiste, lorsqu'il dénonce, non sans un certain humour, « l'illusoire réalisation d'un fantasme de mouvement social de masse européen impeccablement coordonné, qui plus est couronné par une combinaison de serment du Jeu de paume et de Nuit du 4 août monétaires qui accoucheraient en un week-end historique d'une nouvelle architecture européenne toute armée », on ne voit pas très bien pourquoi ce scénario a davantage de chance de se réaliser à l'échelon français…
On en revient à ce que François Heisbourg désigne comme le « miracle politique européen » du moment : « Malgré cinq ans de chômage, de délocalisations, d'impuissance des nations et des institutions européennes, et de déresponsabilisation des politiques par rapport aux technocrates, les électorats européens ont été d'une patience d'ange. Ni victoire des extrêmes, ni coup d'État, ni campagne terroriste. Au pire, de très dures émeutes à Athènes, et plus souvent les sympathiques sit-in des "Indignados" espagnols et de grands défilés de protestation pacifique un peu partout. »
Casser l'euro pour sauver l'Europe, Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger, Béatrice Mathieu, Laura Raim, Éditions Les Liens qui libèrent, 19 euros.
La Malfaçon – Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Éditions Les Liens qui libèrent, 20,50 euros.
11 avril 2014 | Par Ludovic Lamant
À l'approche des élections européennes, deux livres plaident pour l'éclatement de la zone euro – seule manière, aux yeux de leurs auteurs, de rompre avec les cadres actuels de l'UE, et de retrouver des marges de manœuvre économiques. Premier intérêt : ces ouvrages se réapproprient un sujet monopolisé par le Front national dans les médias, pour tenter d'en faire l'un des axes d'une politique de gauche.
Depuis le surgissement de la crise en Europe, c'est devenu un sous-genre éditorial en soi : les livres qui prédisent l'éclatement de la zone euro se multiplient. Ils sont écrits par des fédéralistes déçus (La Fin du rêve européen, de François Heisbourg chez Stock), des élus souverainistes en campagne (L'Euro, les banquiers et la mondialisation, de Nicolas Dupont-Aignan, éditions du Rocher) ou des économistes majoritairement classés à gauche (Désobéir pour sauver l'Europe, Steve Ohana, chez Max Milo, Sortons de l'euro!, Jacques Nikonoff, chez Mille et une nuits, ou encore Faut-il sortir de l'euro, Jacques Sapir, au Seuil).
À l'approche des élections européennes, les éditions des Liens qui libèrent font coup double, avec deux publications qui tentent de démontrer à peu près la même chose, s'en prenant au tabou suprême : il faut en finir avec l'euro, pour mener une politique économique de gauche en France. Faisant le constat d'une « mort clinique de l'euro », les quatre journalistes auteurs de Casser l'euro jugent qu'il serait vain de « vouloir absolument le maintenir en vie artificiellement ». Sur un registre plus musclé – et plus ambitieux –, Frédéric Lordon, directeur de recherches du CNRS et blogueur vedette 3 sur le site du Monde diplomatique, dénonce La Malfaçon à l'origine des déboires français, et propose de récupérer la « souveraineté politique ».
Ce foisonnement éditorial, avec des livres souvent très documentés, prouve-t-il que certaines digues sont en train de se fissurer ? Que les rapports de force évoluent ? Les déçus de l'euro sont en tout cas de plus en plus nombreux. « Les gens sont en train de piger », estimait le démographe Emmanuel Todd dans un récent article 3 du Monde.
De là à plaider pour la fin de l'euro ? L'état alarmant de l'Union – près de 26 millions de chômeurs dans l'UE, des pays comme la Grèce et le Portugal assommés, et l'horizon bouché – explique sans doute en partie ces glissements. « À partir d'un certain seuil (…), la détresse de millions de chômeurs et de nouveaux pauvres nous a semblé peser davantage dans la balance que la volonté farouche, inaltérable, d'aller au bout du projet engagé dix ans plus tôt », écrivent les auteurs de Casser l'euro.
L'évolution est nette, sur fond d'aggravation de la crise sociale : ce n'est plus seulement la gestion de la crise de la zone euro qui se trouve sous les feux de la critique, mais le bien-fondé de la monnaie unique en soi. « Ni crime ni faute en soi, l'euro a été prématuré dans sa conception et contrefait dans sa mise en œuvre, conduisant l'Union européenne et les peuples de ses États membres dans une impasse qu'il est facile de décrire, mais dont il est difficile de se dégager », résume François Heisbourg, qui tente d'articuler, dans son essai, défense de l'Union et sortie de l'euro, au prix de certaines acrobaties. Même la banque suisse UBS a pris le temps 3de s'intéresser à la manière dont les unions monétaires, au fil de l'Histoire, sont mortes, dans une étude récente qui n'est pas passée inaperçue 3.
C'est une chose de reconnaître les manquements et les coûts politiques de l'euro – c'en est une autre de plaider pour sa dissolution, propositions concrètes à l'appui. Ce débat, longtemps étouffé, pourrait gagner en intensité lors de la campagne des élections européennes. En 2011, Jacques Sapir regrettait cette « particularité franco-française », qui consiste à refuser tout débat sur les vertus de la monnaie unique : « L'euro c'est la religion de ce nouveau siècle, avec ses faux prophètes aux prophéties sans cesse démenties, avec ses grands prêtres toujours prêts à fulminer une excommunication faute de pouvoir en venir aux bûchers », s'emportait l'économiste rattaché à l'EHESS. Depuis, la donne semble avoir – un peu – évolué, comme le laisse entendre ce regain d'activité éditorial.
À la veille d'une élection clé pour l'Europe, ces textes, par-delà leur intérêt très variable, présentent un mérite immédiat. Ils s'emparent à bras-le-corps d'un sujet sulfureux, quasiment monopolisé, dans les médias grand public, par le Front national, pour en faire – du côté des économistes critiques en tout cas – l'un des axes d'une politique « de gauche » à réinventer. Frédéric Lordon, qui s'était déjà beaucoup battu, en 2011, pour que la gauche n'abandonne pas au parti de Marine Le Pen le concept compliqué de « démondialisation », consacre ainsi, dans son dernier livre, un chapitre entier à « ce que l'extrême droite ne nous prendra pas ».
À ce sujet, l'économiste ne retient pas ses mots – durs – contre une frange de la gauche critique française (par exemple au sein d'Attac ou des « économistes atterrés »), qui se refuse à défendre une sortie de l'euro, « terrorisée à la pensée du moindre soupçon de collusion objective avec le FN, et qui se donne un critère si bas de cet état de collusion que le moindre regard jeté sur une de ses idées par les opportunistes d'extrême droite conduit cette gauche à abandonner l'idée – son idée – dans l'instant : irrémédiablement souillée ». Et de conclure : « À ce compte-là bien sûr, la gauche critique finira rapidement dépossédée de tout, et avec pour unique solution de quitter le débat public à poil dans un tonneau à bretelles. »
Ces différents essais prouvent donc à ceux qui en doutent encore, que l'on peut parler contre l'euro, sans reprendre pour autant les thèses du Front national. Et l'éternel argument de l'apocalypse (pour le dire vite : sortir de l'euro serait un réflexe simpliste d'apprentis sorciers, qui ne manquerait pas d'ouvrir une nouvelle crise majeure sur le continent) semble désormais un peu court pour convaincre tout à fait. Il va falloir accepter, de part et d'autre, le débat de fond. Argument contre argument. Quoi qu'on pense de l'euro et de son avenir, c'est une bonne nouvelle. Car on le sait depuis qu'on a lu André Orléan : débattre de la monnaie, c'est débattre d'un des fondements de ce qui fait société.
De la monnaie unique à la monnaie commune
Quelles sont les grandes lignes du raisonnement, dans Casser l'euro ? Premier constat : la zone euro patauge dans la crise. La monnaie unique a aggravé les disparités au sein de l'eurozone, et l'Europe du Nord bloquera tout projet de transfert budgétaire massif vers l'Europe du Sud, seul mécanisme qui permettrait de gommer ces « hétérogénéités ». Vu l'esprit des traités, et le poids de l'ordo-libéralisme 3 allemand à Bruxelles, le statu quo actuel, et les rustines qui permettent à l'euro de tenir malgré tout, finiront tôt ou tard par envoyer les pays dans le mur.
Deuxième énoncé (qui mériterait en soi des heures de débats) : le fédéralisme pourrait être une solution vertueuse au marasme ambiant, mais « il apparaît aujourd'hui hors de portée », « fruit d'un travail nécessairement long et vaste (qui) ne concorde pas avec l'urgence de la crise ». D'autant que « les électeurs et les gouvernements n'y consentent pas ». « Les fédéralistes préfèrent s'enferrer dans leur idéal inatteignable, plutôt qu'affronter un réel insupportable », tranchent les auteurs. Exit les ardents fédéralistes type Daniel Cohn-Bendit ou Guy Verhofstadt.
Conclusion : il ne reste plus qu'à plaider pour le passage d'une « monnaie unique » (l'euro) à une « monnaie commune ». Voici donc le retour à des monnaies nationales – franc, drachme, mark, etc. – mais qui ne pourraient fluctuer entre elles que dans une certaine proportion, évoluant sur le marché des changes de part et d'autre d'un cours pivot de référence. Le grand come-back du système monétaire européen ? C'est tout le problème: le SME, mis en place en 1979, a multiplié les ratés, piégé par les pressions des marchés et des spéculateurs (voir les dévaluations chaotiques du franc au début des années 1990).
C'est ici qu'on appelle Frédéric Lordon à la rescousse, qui, dans La Malfaçon, affirme avoir trouvé la parade, pour ne pas retomber dans les travers du SME d'antan. Il propose que cette convertibilité des monnaies nationales se fasse à un seul guichet, celui de la Banque centrale européenne (BCE). Mécaniquement, cela supprimerait tout marché des changes intra-européen. On en reviendrait à un guichet unique, censé provoquer à lui seul une certaine stabilité, et contourner les logiques de marché. Ce serait donc le retour à un contrôle strict des capitaux. Une manière de « réajuster dans le calme les changes intra-européens », écrit Lordon, qui entrevoit, enthousiaste, « la possibilité du découplage de la politique monétaire d'avec les marchés obligataires ».
Chez Lordon, l'entreprise ne s'arrête pas là. La dissolution de l'euro serait le point de départ d'une rupture plus vaste avec une Europe qu'il juge « structurellement de droite ». Parmi les mesures fracassantes pour rompre avec « une forme douce, juridiquement correcte, de dictature financière » (comme l'inscription de la « règle d'or » dans les traités) : défaut sur la dette souveraine et dévaluation (dans le cas de la Grèce), mais aussi nationalisation du secteur bancaire, « démocratie locale du crédit », contrôle des capitaux et « renationalisation » du financement des déficits publics (via l'épargne des ménages, pour éviter une dépendance des États aux marchés). Bref, une révolution.
.
On connaît, à ce stade, les mises en garde des défenseurs de l'euro. Première d'entre elles : les dettes des États et des ménages vont exploser. Si le retour à l'euro-franc s'accompagne d'une dévaluation massive pour doper l'économie française, le poids des dettes risque, en effet, de grimper d'autant. Faux, écrivent nos auteurs. À les lire, il suffira à l'État en question de basculer le libellé de sa dette en monnaie nationale, sans que la manœuvre n'affecte la valeur nominale de la dette. Au nom de sa souveraineté monétaire, un État pourrait décider qu'une dette d'un euro équivaudrait tout simplement à une dette d'un euro-franc. Le tour est joué.
Le raisonnement tient jusqu'à un certain point : encore faut-il que ces dettes aient été contractées sous droit français. C'est ce qu'avait découvert à ses dépens, peu après la crise de 2001, le Trésor argentin, qui n'avait pu annuler une partie de sa dette, contractée sous droit new-yorkais (et qui lui vaut encore aujourd'hui des procédures en justice). Pour savoir comment une sortie de l'euro pèserait sur le poids de la dette, il faut donc regarder dans le détail des contrats, pays par pays… L'affaire est loin d'être simple.
D'après les auteurs de Casser l'euro, pour la France, 93 % des OAT (les emprunts d'État de base) sont « made in France » (d'après des chiffres de la Banque des règlements internationaux). Ce serait donc jouable côté français. Mais, à l'échelle de l'Europe, ils avancent tout de même le chiffre de 300 milliards d'euros de dettes qui seraient problématiques (contractées sous un droit étranger). Pas de quoi se réjouir. Sauf, bien sûr, à coupler la sortie de l'euro avec des défauts massifs des États en question – ce qui aurait pour avantage de régler une bonne partie du problème à court terme.
« Miracle politique européen »
Autre inconnue : sortir de l'euro doit permettre à l'État de retrouver des marges de manœuvre, à commencer par une politique de change. La priorité, c'est de dévaluer, pour stimuler les exportations. Certes. Mais sommes-nous certains des effets positifs et durables d'une dévaluation compétitive sur l'économie ? L'interrogation est vive, en Grèce par exemple, où le tissu industriel est défait, l'appareil d'État paralysé, et l'ensemble de l'économie est à réinventer. Une dévaluation seule n'y produirait sans doute pas des effets majeurs.
Et après tout, si tout le monde dévalue en même temps, et dans tous les sens (ce qui n'est pas le scénario retenu par les auteurs des livres évoqués ici, mais ce scénario ne peut être exclu), cela pourrait aussi desservir l'ensemble des économies européennes, au bout du compte. « Tout cela fleure bon les années 1930, lorsque les pays à économie de marché s’étaient avérés incapables de s’entendre, ce qui avait conduit chacun à mener une politique de dévaluation compétitive et de repli protectionniste : l’effet fut d’amplifier la dépression générale et de l’étendre quasiment au monde entier », s'inquiétait en début d'année 3 la revue Vacarme dans un texte sur l'Europe.
La facture énergétique des Européens menacerait, elle aussi, de s'envoler (puisqu'elle est libellée en dollars, pour les Européens). Les auteurs de Casser l'euro ne le nient pas. Tout au plus précisent-ils que la hausse de la facture ne serait pas aussi importante qu'on ne le pense (une dévaluation de 25 % entraînerait une hausse de 6,25 % des prix à la pompe, selon les calculs de Jacques Sapir). À chaque fois, les partisans d'une sortie de l'euro reconnaissent de véritables risques liés à la sortie de l'euro, mais s'en tiennent à l'argument suivant : ces risques seront fortement amortis si l'on se prépare à une sortie de l'euro, inévitable à leurs yeux, plutôt que l'on ne la subit. Et au bout du compte, ces risques et surcoûts ne pèsent pas lourds, si on les compare aux coûts des solutions qui permettront de préserver l'euro. On a connu arguments plus mobilisateurs, mais la logique se tient.
Autre point délicat, à la lecture du livre de Frédéric Lordon : à force de critiquer l'échelon européen, qu'il abhorre, l'économiste tend à sérieusement idéaliser le niveau national. On le cite : « La solution nationale a pour propriété que les structures institutionnelles et symboliques de la souveraineté y sont toutes armées et immédiatement disponibles, c'est-à-dire instantanément réactivables, robuste vertu pratique en situation d'urgence extrême. » Et plus loin : « Personne n'a dit, ni ne dira, qu'une lutte ouverte au niveau national serait facile. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle sera plus facile » – en particulier parce que le retour au national revient à « déconstitutionnaliser le problème », en « envoyant promener les traités ».
L'argument se tient, mais l'affaire n'est sans doute pas aussi évidente. Les rapports de force seront-ils automatiquement plus favorables à l'échelon national, pour défendre les idées de cette gauche critique ? Vu l'état de déliquescence des institutions en France, l'organisation de la Ve République, et le niveau du débat sur les questions économiques, il est toutefois permis d'en douter.
On peut même aller plus loin : il se forme parfois, au sein du parlement européen, des majorités de gauche plus radicales, sur certaines questions décisives (voir le rejet du traité ACTA, ou le travail de la commission « libertés civiles » sur l'espionnage américain) que celles que l'on observe à Paris. Même la commission européenne s'est mise à s'inquiéter 3, depuis la fin d'année dernière, de l'ampleur des déséquilibres… de l'économie allemande. De ce point de vue, la gauche critique aurait alors tout intérêt à investir, de manière pragmatique, tous les échelons – locaux, nationaux, européens – pour mener la bataille politique…
Et si l'on ne peut qu'être d'accord avec l'économiste, lorsqu'il dénonce, non sans un certain humour, « l'illusoire réalisation d'un fantasme de mouvement social de masse européen impeccablement coordonné, qui plus est couronné par une combinaison de serment du Jeu de paume et de Nuit du 4 août monétaires qui accoucheraient en un week-end historique d'une nouvelle architecture européenne toute armée », on ne voit pas très bien pourquoi ce scénario a davantage de chance de se réaliser à l'échelon français…
On en revient à ce que François Heisbourg désigne comme le « miracle politique européen » du moment : « Malgré cinq ans de chômage, de délocalisations, d'impuissance des nations et des institutions européennes, et de déresponsabilisation des politiques par rapport aux technocrates, les électorats européens ont été d'une patience d'ange. Ni victoire des extrêmes, ni coup d'État, ni campagne terroriste. Au pire, de très dures émeutes à Athènes, et plus souvent les sympathiques sit-in des "Indignados" espagnols et de grands défilés de protestation pacifique un peu partout. »
Casser l'euro pour sauver l'Europe, Franck Dedieu, Benjamin Masse-Stamberger, Béatrice Mathieu, Laura Raim, Éditions Les Liens qui libèrent, 19 euros.
La Malfaçon – Monnaie européenne et souveraineté démocratique, Éditions Les Liens qui libèrent, 20,50 euros.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Vive le projet européen.
Le dumping fiscal, cette « compétition » qui ruine l'Europe
15 avril 2014 | Par Dan Israel
Le livre Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États en détaille les mécanismes, et donne les clés pour dénoncer l'absurdité d'un système qui mine la souveraineté politique et le pouvoir des citoyens. Compte-rendu, et un large extrait consacré au rôle des sociétés d'audit.
Elle constitue le fondement de bien des débats autour de la santé économique de la France et de l’Europe, mais elle reste pourtant invisible. La question, fondamentale, de la concurrence fiscale entre États n’est que trop rarement abordée de front. C’est tout le mérite du livre d’Éric Walravens, publié le 17 avril (éditions Les petits matins/Institut Veblen), de sortir ce sujet des non-dits, d’en démonter les mécanismes, et de remettre en cause une logique qui contribue inexorablement à la ruine des États européens et à la perte de leur souveraineté.
« La compétition économique domine les relations entre États. La fiscalité en est l’une des armes privilégiées », écrit dès les premières pages l’auteur, journaliste économique à l’agence de presse belge Belga, qui tient par ailleurs un très bon blog sur Mediapart. « Le propos de ce livre est d’explorer les coulisses d’un chantage qui contribue à délégitimer l’impôt », souligne-t-il. Pour son premier ouvrage, le journaliste s’est penché sur des sujets qui ont trop longtemps semblé sans intérêt à ses confrères. « Je m’occupe de la politique européenne, et j’ai toujours été frappé de voir à quel point, lors des conseils européens et des conférences de presse qui les suivent, les questions fiscales étaient reléguées au second plan, raconte Éric Walravens à Mediapart. Les seuls que cela intéresse à Bruxelles, ce sont les journalistes suisses et luxembourgeois. Mais pour eux, les questions d’impôts et de taxes représentent un intérêt national. »
À la faveur des récentes initiatives internationales, dont Mediapart se fait régulièrement l’écho, le sujet a un peu quitté le cercle restreint des paradis fiscaux. Au gré des révélations, sur la façon dont les multinationales s’exonèrent de tout impôt ou presque en Europe, ou sur l’exil fiscal de telle star ou de tel capitaine d’industrie, l’opinion publique prend lentement conscience de l’ampleur du problème. Les indignés d’un jour auront tout intérêt à lire ce livre, qui dresse un catalogue saisissant de toutes les dérives, la plupart légales, possibles en Europe. L’auteur s’est principalement concentré sur les efforts des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de l’Irlande pour attirer sur leur territoire les riches particuliers et les entreprises florissantes nés dans les pays voisins. Et les astuces, souvent racontées dans le livre par des acteurs les ayant défendues ou les ayant vues naître, sont légion.
Par exemple, qui sait que depuis qu’une ingénieuse niche fiscale a été votée en Belgique, en 2003, la production cinématographique belge a presque quadruplé ? Au détriment de la France principalement. La Belgique produit aujourd’hui près du tiers des films français, au grand dam des techniciens hexagonaux, privés d’une partie de leur travail par un système sophistiqué d’ingénierie financière. Ce système permet même à l’État belge de prendre en charge une grosse partie du salaire des stars des films tournés de l’autre côté de la frontière. Ce qui fait de Dany Boon « le fonctionnaire le mieux payé du royaume », ironise l’auteur.
La Belgique est aussi un « paradis fiscal accidentel », pointe-t-il : alors que l’impôt sur le revenu, et donc sur le travail, y est l’un des plus élevés au monde, le pays, qui connut le secret bancaire jusqu’en 2010, n’exige en revanche aucun impôt sur la fortune ou sur les plus-values aux riches détenteurs de capital qu’elle héberge. Il est donc en pointe dans la « chasse aux riches » en Europe, aux côtés notamment du Royaume-Uni, où une vieille règle datant de l’empire colonial « offre la possibilité – unique au monde – d’être résident britannique tout en déclarant un domicile à l’étranger ». Et donc de ne pas payer ses impôts en Grande-Bretagne. L’idéal pour des centaines de milliardaires issus de pays du Sud, qui ne payent pas non plus d’impôts trop importants dans leur pays d’origine. Un cran est encore franchi avec les « visas dorés », qui voient de petits pays européens comme Malte faire payer l’octroi de la nationalité à des chanceux très fortunés…
À des degrés divers, d’autres pays se sont aussi lancés dans cette chasse. Depuis 2004, une loi espagnole, surnommée « loi Beckham », permet d’offrir à certains étrangers un taux d’impôt sur le revenu de 24 %, « très inférieur au taux marginal de 45 % en vigueur à l’époque ». Et depuis 1992, c’est le Danemark qui permet aux chercheurs et à d’autres « professions hautement rémunérées » de ne payer que 25 % d’impôt pendant trois ans… Pour attirer les sportifs, les cadres, les stars, les investisseurs, on met ainsi au rebut le principe de progressivité de l’impôt. Et l'on contribue à une hausse inacceptable des inégalités. « En haut de l’échelle des revenus, l’impôt devient même régressif : les taux acquittés par les plus riches sont plus faibles que ceux des pauvres et des classes moyennes », souligne le livre.
Les entreprises françaises adorent la Belgique
Mais c’est surtout quand elle vise les entreprises que la compétition fiscale bat son plein. Le Luxembourg en a fait sa marque de fabrique, comme nous le détaillions récemment. L’Irlande est un autre cas d’école. À 12,5 %, l’impôt sur les bénéfices des sociétés y est déjà l’un des plus bas d’Europe. Mais l’industrie financière, particulièrement proche du pouvoir politique, sait y faire pour imposer ses vues : la loi de finances de 2012 contiendrait 21 propositions directement soufflées par le secteur financier, « et la loi de 2013 inclut une nouvelle série d’avantages » ! Et pour éviter d’ennuyer trop les géants du Net qui sont installés à Dublin, le pays a « oublié » de créer un cadre légal pour calculer, et donc contrôler, les prix de transfert employés par les multinationales. Or, comme Mediapart l’expliquait ici, le jeu sur les prix de transfert est justement un des domaines de prédilection des « Intaxables » comme Google ou Apple… Ajoutez à cela un montage fiscal connu sous le sobriquet de « double irlandais », qui s’allie lui-même avec le « sandwich néerlandais » aux Pays-Bas (où 6 000 sociétés en profiteraient), et vous obtenez la recette pour effacer la plupart des ardoises fiscales.
Là encore, la Belgique n’est pas en reste. Selon le PTB, parti d’extrême gauche, le brasseur AB Inbev, fleuron national propriétaire des marques Stella Artois, Corona ou Leffe, a payé en 2013… 0,002 % d’impôt (26 000 euros sur un bénéfice net de 5,98 milliards) ! Ce tour de passe-passe est notamment rendu possible par le principe des intérêts notionnels : depuis 2005, une entreprise finançant elle-même ses propres projets de développement peut déduire de ses impôts un certain pourcentage des sommes investies. La logique ? Le gouvernement fait comme si l’entreprise avait emprunté de l’argent à une banque, cas dans lequel elle aurait eu le droit de déduire de ses impôts les intérêts versés à l’établissement financier. Un raisonnement tiré par les cheveux, mais qui a permis au gouvernement de l’époque de faire plaisir aux grandes entreprises, lesquelles lui suggéraient fortement de faire passer leur facture fiscale sous le taux de 4 %.
Les intérêts notionnels attirent bien sûr nombre d’entreprises étrangères. « Une arme de destruction massive pour les fiscs étrangers », résume un chercheur cité dans l’ouvrage. Et les sociétés du CAC 40, dont des entreprises où l’État français est actionnaire, sont les premières sur les rangs. « Un gratte-ciel de l’avenue Louise, à Bruxelles, accueille désormais deux holdings de Bernard Arnault, Hannivest et LVMH Finance Belgique, qui comptabilisent ensemble 6 milliards d’euros de fonds propres – et à peine 5 salariés, écrit Éric Walravens. À la même adresse, EDF avait domicilié dès 2007 sa filiale EDF Investment group, capitalisée à hauteur de 7,6 milliards d’euros. En 2011, cette structure a réalisé un bénéfice de 306 millions d’euros, sur lequel elle a acquitté un impôt de 900 000 euros (soit 0,3 %). (…) Auchan, Total, GDF Suez, Veolia et bien d’autres profitent désormais du régime, au grand dam du fisc français. »
Pour naviguer dans les méandres des lois existantes, les entreprises peuvent s’appuyer sur une petite dizaine de cabinets d’audit et de conseil, présents partout dans le monde. La lourde responsabilité de KPMG, PriceWaterhouseCoopers et autres « catalyseurs de concurrence fiscale », est analysée de façon convaincante dans un chapitre original, que nous vous proposons en intégralité dans les pages suivantes.
Le constat du journaliste est sombre : « Le débat sur l’impôt aujourd’hui n’est plus tellement un débat sur ce qui est souhaitable, mais sur ce qui est possible. Le système est-il juste ? La question devient très secondaire. Ceux qui peuvent – souvent les plus riches – passent entre les mailles du filet. Tant pis pour les autres. » Le système s’est particulièrement développé au sein de l’Union européenne, où la libre circulation des capitaux est un dogme, défendu notamment par l’autorité juridique suprême de tous les pays de l’UE, la Cour de justice européenne.
Éric Walravens, qui confie à Mediapart avoir « une inclinaison pro-européenne naturelle, sans doute comme tous les Belges », ne peut que pointer le « vice central de la construction européenne, où les règles de majorité et d’unanimité ne permettent pas de faire progresser au même rythme des dossiers qui devraient pourtant aller de pair ». Quand la libéralisation des marchés et des services est régulièrement renforcée par des votes à la majorité au sein de l’Union, les traités prévoient que l’unanimité des États membres doivent tomber d’accord lorsqu’il s’agit de valider des mesures d’harmonisation fiscale et sociale.
Il a ainsi fallu presque vingt ans de combat pour faire céder le Luxembourg et l’Autriche sur le secret bancaire, et encore à une échelle bien modeste. « L’Europe s’est transformée – d’abord informellement puis de façon institutionnalisée – en un espace où la libre circulation du capital est un droit absolu, écrit Walravens. Le seul espace au monde où la liberté du capital prime sur les considérations démocratiques nationales. »
Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États.
Éric Walravens. Les petits matins/Institut Veblen. 205 pages. 15 euros. Parution : 17 avril 2014.
Le dumping fiscal, cette « compétition » qui ruine l'Europe
15 avril 2014 | Par Dan Israel
Le livre Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États en détaille les mécanismes, et donne les clés pour dénoncer l'absurdité d'un système qui mine la souveraineté politique et le pouvoir des citoyens. Compte-rendu, et un large extrait consacré au rôle des sociétés d'audit.
Elle constitue le fondement de bien des débats autour de la santé économique de la France et de l’Europe, mais elle reste pourtant invisible. La question, fondamentale, de la concurrence fiscale entre États n’est que trop rarement abordée de front. C’est tout le mérite du livre d’Éric Walravens, publié le 17 avril (éditions Les petits matins/Institut Veblen), de sortir ce sujet des non-dits, d’en démonter les mécanismes, et de remettre en cause une logique qui contribue inexorablement à la ruine des États européens et à la perte de leur souveraineté.
« La compétition économique domine les relations entre États. La fiscalité en est l’une des armes privilégiées », écrit dès les premières pages l’auteur, journaliste économique à l’agence de presse belge Belga, qui tient par ailleurs un très bon blog sur Mediapart. « Le propos de ce livre est d’explorer les coulisses d’un chantage qui contribue à délégitimer l’impôt », souligne-t-il. Pour son premier ouvrage, le journaliste s’est penché sur des sujets qui ont trop longtemps semblé sans intérêt à ses confrères. « Je m’occupe de la politique européenne, et j’ai toujours été frappé de voir à quel point, lors des conseils européens et des conférences de presse qui les suivent, les questions fiscales étaient reléguées au second plan, raconte Éric Walravens à Mediapart. Les seuls que cela intéresse à Bruxelles, ce sont les journalistes suisses et luxembourgeois. Mais pour eux, les questions d’impôts et de taxes représentent un intérêt national. »
À la faveur des récentes initiatives internationales, dont Mediapart se fait régulièrement l’écho, le sujet a un peu quitté le cercle restreint des paradis fiscaux. Au gré des révélations, sur la façon dont les multinationales s’exonèrent de tout impôt ou presque en Europe, ou sur l’exil fiscal de telle star ou de tel capitaine d’industrie, l’opinion publique prend lentement conscience de l’ampleur du problème. Les indignés d’un jour auront tout intérêt à lire ce livre, qui dresse un catalogue saisissant de toutes les dérives, la plupart légales, possibles en Europe. L’auteur s’est principalement concentré sur les efforts des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de l’Irlande pour attirer sur leur territoire les riches particuliers et les entreprises florissantes nés dans les pays voisins. Et les astuces, souvent racontées dans le livre par des acteurs les ayant défendues ou les ayant vues naître, sont légion.
Par exemple, qui sait que depuis qu’une ingénieuse niche fiscale a été votée en Belgique, en 2003, la production cinématographique belge a presque quadruplé ? Au détriment de la France principalement. La Belgique produit aujourd’hui près du tiers des films français, au grand dam des techniciens hexagonaux, privés d’une partie de leur travail par un système sophistiqué d’ingénierie financière. Ce système permet même à l’État belge de prendre en charge une grosse partie du salaire des stars des films tournés de l’autre côté de la frontière. Ce qui fait de Dany Boon « le fonctionnaire le mieux payé du royaume », ironise l’auteur.
La Belgique est aussi un « paradis fiscal accidentel », pointe-t-il : alors que l’impôt sur le revenu, et donc sur le travail, y est l’un des plus élevés au monde, le pays, qui connut le secret bancaire jusqu’en 2010, n’exige en revanche aucun impôt sur la fortune ou sur les plus-values aux riches détenteurs de capital qu’elle héberge. Il est donc en pointe dans la « chasse aux riches » en Europe, aux côtés notamment du Royaume-Uni, où une vieille règle datant de l’empire colonial « offre la possibilité – unique au monde – d’être résident britannique tout en déclarant un domicile à l’étranger ». Et donc de ne pas payer ses impôts en Grande-Bretagne. L’idéal pour des centaines de milliardaires issus de pays du Sud, qui ne payent pas non plus d’impôts trop importants dans leur pays d’origine. Un cran est encore franchi avec les « visas dorés », qui voient de petits pays européens comme Malte faire payer l’octroi de la nationalité à des chanceux très fortunés…
À des degrés divers, d’autres pays se sont aussi lancés dans cette chasse. Depuis 2004, une loi espagnole, surnommée « loi Beckham », permet d’offrir à certains étrangers un taux d’impôt sur le revenu de 24 %, « très inférieur au taux marginal de 45 % en vigueur à l’époque ». Et depuis 1992, c’est le Danemark qui permet aux chercheurs et à d’autres « professions hautement rémunérées » de ne payer que 25 % d’impôt pendant trois ans… Pour attirer les sportifs, les cadres, les stars, les investisseurs, on met ainsi au rebut le principe de progressivité de l’impôt. Et l'on contribue à une hausse inacceptable des inégalités. « En haut de l’échelle des revenus, l’impôt devient même régressif : les taux acquittés par les plus riches sont plus faibles que ceux des pauvres et des classes moyennes », souligne le livre.
Les entreprises françaises adorent la Belgique
Mais c’est surtout quand elle vise les entreprises que la compétition fiscale bat son plein. Le Luxembourg en a fait sa marque de fabrique, comme nous le détaillions récemment. L’Irlande est un autre cas d’école. À 12,5 %, l’impôt sur les bénéfices des sociétés y est déjà l’un des plus bas d’Europe. Mais l’industrie financière, particulièrement proche du pouvoir politique, sait y faire pour imposer ses vues : la loi de finances de 2012 contiendrait 21 propositions directement soufflées par le secteur financier, « et la loi de 2013 inclut une nouvelle série d’avantages » ! Et pour éviter d’ennuyer trop les géants du Net qui sont installés à Dublin, le pays a « oublié » de créer un cadre légal pour calculer, et donc contrôler, les prix de transfert employés par les multinationales. Or, comme Mediapart l’expliquait ici, le jeu sur les prix de transfert est justement un des domaines de prédilection des « Intaxables » comme Google ou Apple… Ajoutez à cela un montage fiscal connu sous le sobriquet de « double irlandais », qui s’allie lui-même avec le « sandwich néerlandais » aux Pays-Bas (où 6 000 sociétés en profiteraient), et vous obtenez la recette pour effacer la plupart des ardoises fiscales.
Là encore, la Belgique n’est pas en reste. Selon le PTB, parti d’extrême gauche, le brasseur AB Inbev, fleuron national propriétaire des marques Stella Artois, Corona ou Leffe, a payé en 2013… 0,002 % d’impôt (26 000 euros sur un bénéfice net de 5,98 milliards) ! Ce tour de passe-passe est notamment rendu possible par le principe des intérêts notionnels : depuis 2005, une entreprise finançant elle-même ses propres projets de développement peut déduire de ses impôts un certain pourcentage des sommes investies. La logique ? Le gouvernement fait comme si l’entreprise avait emprunté de l’argent à une banque, cas dans lequel elle aurait eu le droit de déduire de ses impôts les intérêts versés à l’établissement financier. Un raisonnement tiré par les cheveux, mais qui a permis au gouvernement de l’époque de faire plaisir aux grandes entreprises, lesquelles lui suggéraient fortement de faire passer leur facture fiscale sous le taux de 4 %.
Les intérêts notionnels attirent bien sûr nombre d’entreprises étrangères. « Une arme de destruction massive pour les fiscs étrangers », résume un chercheur cité dans l’ouvrage. Et les sociétés du CAC 40, dont des entreprises où l’État français est actionnaire, sont les premières sur les rangs. « Un gratte-ciel de l’avenue Louise, à Bruxelles, accueille désormais deux holdings de Bernard Arnault, Hannivest et LVMH Finance Belgique, qui comptabilisent ensemble 6 milliards d’euros de fonds propres – et à peine 5 salariés, écrit Éric Walravens. À la même adresse, EDF avait domicilié dès 2007 sa filiale EDF Investment group, capitalisée à hauteur de 7,6 milliards d’euros. En 2011, cette structure a réalisé un bénéfice de 306 millions d’euros, sur lequel elle a acquitté un impôt de 900 000 euros (soit 0,3 %). (…) Auchan, Total, GDF Suez, Veolia et bien d’autres profitent désormais du régime, au grand dam du fisc français. »
Pour naviguer dans les méandres des lois existantes, les entreprises peuvent s’appuyer sur une petite dizaine de cabinets d’audit et de conseil, présents partout dans le monde. La lourde responsabilité de KPMG, PriceWaterhouseCoopers et autres « catalyseurs de concurrence fiscale », est analysée de façon convaincante dans un chapitre original, que nous vous proposons en intégralité dans les pages suivantes.
Le constat du journaliste est sombre : « Le débat sur l’impôt aujourd’hui n’est plus tellement un débat sur ce qui est souhaitable, mais sur ce qui est possible. Le système est-il juste ? La question devient très secondaire. Ceux qui peuvent – souvent les plus riches – passent entre les mailles du filet. Tant pis pour les autres. » Le système s’est particulièrement développé au sein de l’Union européenne, où la libre circulation des capitaux est un dogme, défendu notamment par l’autorité juridique suprême de tous les pays de l’UE, la Cour de justice européenne.
Éric Walravens, qui confie à Mediapart avoir « une inclinaison pro-européenne naturelle, sans doute comme tous les Belges », ne peut que pointer le « vice central de la construction européenne, où les règles de majorité et d’unanimité ne permettent pas de faire progresser au même rythme des dossiers qui devraient pourtant aller de pair ». Quand la libéralisation des marchés et des services est régulièrement renforcée par des votes à la majorité au sein de l’Union, les traités prévoient que l’unanimité des États membres doivent tomber d’accord lorsqu’il s’agit de valider des mesures d’harmonisation fiscale et sociale.
Il a ainsi fallu presque vingt ans de combat pour faire céder le Luxembourg et l’Autriche sur le secret bancaire, et encore à une échelle bien modeste. « L’Europe s’est transformée – d’abord informellement puis de façon institutionnalisée – en un espace où la libre circulation du capital est un droit absolu, écrit Walravens. Le seul espace au monde où la liberté du capital prime sur les considérations démocratiques nationales. »
Dumping fiscal. Enquête sur un chantage qui ruine nos États.
Éric Walravens. Les petits matins/Institut Veblen. 205 pages. 15 euros. Parution : 17 avril 2014.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
tu lis vraiment tout ça 'nando ?
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
C'est au taf que tu passes autant de temps sur P-L et que tu lis tout ça ? Tu touches un salaire pour ça ? Tu bosses à la maison ?
I don't always listen to Pantera...but when I do, I get fucking hostile.
fernando a écrit:Du coup tu remarques que j'ai la décence de ne pas me plaindre du gel du point d'indice au moins?
lol
Je cherche pas à vous faire peur. Vous avez déjà peur...
fernando a écrit:les deux avocats, ayant enfin le droit d'accès au dossier, vont demander aux juges de vérifier toutes les allégations de son prédécesseur, en réentendant tous les témoins à charge et en faisant expertiser les débris de l'avion, ce que le juge Bruguière n'avait pas fait, puisqu'il ne s'est jamais rendu sur les lieux de l'attentat.
Le 15 juin 2010, Abdul Ruzibiza, le principal témoin sur lequel Bruguière fondait ses accusations, reconnaît devant les juges Poux et Trévidic qu'il n'était pas sur les lieux de l'attentat, pas plus qu'il n'était à Kigali les jours précédents.
Du beau travail, Bruguière.
https://www.youtube.com/watch?v=-S9Fs-55Yy0
"Je pars avec le sentiment d'avoir bien fait mon travail" françois rebsamen
Bien le teasing KK, ça a l'air cool!
"Rwanda, 20 ans après : l'histoire truquée" -- Un film de Julien Teil et Paul-Éric Blanrue. Une production Topdoc et Apocalypse France.
Vingt ans après le drame, le président du Rwanda Paul Kagame, les médias, les associations "humanitaires", une grande partie de la classe politique et les réseaux pro-israéliens continuent d'accuser la France d'avoir participé au génocide rwandais. Pour la pensée unique, les Tustis sont les victimes de crimes contre l'humanité commis par les Hutus pro-Français ; jamais leur part de culpabilité n'est mise en évidence ; jamais on n'explique les raisons sordides qui se cachent derrière ce massacre ; jamais n'est mentionné le rôle néfaste des puissances étrangères ayant eu intérêt à provoquer la catastrophe. Il est temps de reprendre l'affaire à zéro et oser dire, preuves à l'appui, que l'histoire officielle a été truquée.
Ce film pose les questions interdites :
Quelle puissance étrangère a-t-elle formé les chefs des rebelles Tutsis, à commencer par l'actuel président du Rwanda Paul Kagame ?
Qui a abattu l'avion du président Juvénal Habyarimana, un assassinat qui a déclenché le plus grand massacre que l'Afrique ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale ?
Pourquoi certaines ONG ont-elles entretenu d'étranges relations de proximité avec le FPR ? Sous la pression de qui les accords d'Arusha (1993) ont-ils ouvert la route à la victoire du FPR ?
Quel est l'objectif géostratégique poursuivi par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël dans ces dramatiques événements ?
Avec les interventions des journalistes et auteurs Pierre Péan et Patrick Mbeko, de l'ancienne député américaine Cynthia McKinney, du colonel Robardey, assistant technique de police judicaire au Rwanda, et l'ultime interview de Michael Hourigan, chargé de l'enquête du TPIR auprès de l'ONU.
Le complot judéo-maçonnique mondial, encore et toujours!
Et c'est les tutsis qui ont provoqué.
Ca a l'air d'être du mourd, mike!
"Rwanda, 20 ans après : l'histoire truquée" -- Un film de Julien Teil et Paul-Éric Blanrue. Une production Topdoc et Apocalypse France.
Vingt ans après le drame, le président du Rwanda Paul Kagame, les médias, les associations "humanitaires", une grande partie de la classe politique et les réseaux pro-israéliens continuent d'accuser la France d'avoir participé au génocide rwandais. Pour la pensée unique, les Tustis sont les victimes de crimes contre l'humanité commis par les Hutus pro-Français ; jamais leur part de culpabilité n'est mise en évidence ; jamais on n'explique les raisons sordides qui se cachent derrière ce massacre ; jamais n'est mentionné le rôle néfaste des puissances étrangères ayant eu intérêt à provoquer la catastrophe. Il est temps de reprendre l'affaire à zéro et oser dire, preuves à l'appui, que l'histoire officielle a été truquée.
Ce film pose les questions interdites :
Quelle puissance étrangère a-t-elle formé les chefs des rebelles Tutsis, à commencer par l'actuel président du Rwanda Paul Kagame ?
Qui a abattu l'avion du président Juvénal Habyarimana, un assassinat qui a déclenché le plus grand massacre que l'Afrique ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale ?
Pourquoi certaines ONG ont-elles entretenu d'étranges relations de proximité avec le FPR ? Sous la pression de qui les accords d'Arusha (1993) ont-ils ouvert la route à la victoire du FPR ?
Quel est l'objectif géostratégique poursuivi par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël dans ces dramatiques événements ?
Avec les interventions des journalistes et auteurs Pierre Péan et Patrick Mbeko, de l'ancienne député américaine Cynthia McKinney, du colonel Robardey, assistant technique de police judicaire au Rwanda, et l'ultime interview de Michael Hourigan, chargé de l'enquête du TPIR auprès de l'ONU.
Le complot judéo-maçonnique mondial, encore et toujours!
Et c'est les tutsis qui ont provoqué.
Ca a l'air d'être du mourd, mike!
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invité(s)