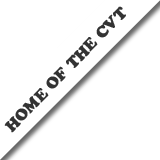par fernando » 08 Avr 2014, 11:57
par fernando » 08 Avr 2014, 11:57
C'est marrant, je suis tombé sur cet article après avoir rédigé mon précédent message.
C'est long mais très intéressant, et ça mérite bien quelques "didn't read lol"
Dès 1990, l'Elysée est informé du projet de génocide
07 avril 2014 | Par François Bonnet
Le génocide des Tutsis qui débute le 6 avril 1994 n'est pas un embrasement soudain. Il a été méthodiquement planifié par le pouvoir hutu d'Habyarimana. À tel point que, dès 1990, de nombreux acteurs français sur place (services, militaires, diplomates) font remonter à l'Élysée des alertes de plus en plus précises. C'est ce que détaille le livre Au nom de la France, guerres secrètes au Rwanda, dont nous publions des extraits.
« Déclencheur ». Un mot peut parfois brouiller l'histoire. Il est une habitude d'écrire que l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana, abattu de deux tirs de missiles le 6 avril 1994, est le « déclencheur » du génocide des Tutsis qui allait faire en cent jours de 800 000 à 1 million de morts. C'est effectivement le signal du début des tueries de masse puisque aussitôt l'attentat connu, la garde présidentielle et les milices hutues entament les massacres à Kigali.
Mais ce signal n'est qu'un moment d'un long processus de construction d'un État génocidaire entamé plusieurs années avant. Le génocide n'est pas un massacre soudainement provoqué par un peuple hutu en colère après l'assassinat de son président, une sorte de dérapage monstrueux d'habituelles tueries interethniques, comme ont voulu le faire croire les responsables politiques français en charge en 1994. Il est l'aboutissement d'une planification méthodique, pensée, voulue, organisée par le régime d'Habyarimana. Ce qui pose directement la question du rôle de la France qui, depuis 1990, n'a cessé de soutenir, d'armer, de former les futurs génocidaires, jusqu'à combattre à leurs côtés en 1992 et 1993 contre la rébellion tutsie du FPR conduite par Paul Kagamé. Jusqu'à 1 000 soldats français ont été déployés au Rwanda au début des années 1990.
C'est toute la qualité du livre que publient Benoît Collombat et David Servenay, « Au nom de la France », guerres secrètes au Rwanda (éditions La Découverte), que d'explorer ces quatre années qui ont précédé le génocide. Les deux journalistes travaillent depuis des années sur le Rwanda, le premier ayant réalisé de nombreuses enquêtes pour France Inter, le second ayant déjà publié un livre important, en 2007 avec Gabriel Périès, Une guerre noire, enquête sur les origines du génocide rwandais (1959-1994).
Ce que révèle ce livre, c'est d'abord l'ampleur de l'engagement français auprès des troupes du régime dictatorial d'Habyarimana. Formation, armement, construction d'une gendarmerie rwandaise qui sera ensuite l'instrument du quadrillage de la population et de sa mobilisation pour participer aux massacres, opérations spéciales, assistance technique dans les phases de combat : à partir de 1990, l'armée française s'engage crescendo pour sauver un régime qui, en parallèle, met en place les structures qui permettront le génocide.
Or, et c'est là le point clé, la France ne peut ignorer ce projet génocidaire. Car, dès 1990, les alertes sont faites. Elles se multiplieront ensuite, venues de militaires, des agents de la DGSE, des diplomates et des ONG. En 1993, un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) avec trois autres organisations humanitaires documente parfaitement les massacres survenus en 1992, premier acte du génocide. Que fait la diplomatie française ? Elle s'inquiète de son retentissement médiatique ; la politique française restera inchangée... Les alertes se font-elles encore plus détaillées, lorsqu'il est, par exemple, signalé l'achat de cargaisons entières de machettes à la Chine ? Il ne se passe rien de plus.
C'est ce naufrage politique français que documente le livre de Benoît Collombat et David Servenay. Le choix initial de François Mitterrand n'est jamais contesté ni même questionné durant ces quatre années qui précédent la catastrophe. À partir de 1993, le régime de cohabitation ne vient pas plus remettre en question cette politique. François Mitterrand, sa cellule Afrique, son fils Jean-Christophe Mitterrand, Hubert Védrine, Édouard Balladur, François Léotard, Alain Juppé, son directeur de cabinet Dominique de Villepin, et l'état-major de l'armée, tous persistent dans leur soutien au régime criminel. Un seul homme prend ses distances en envoyant deux notes très critiques à François Mitterrand : Pierre Joxe, lorsqu'il est ministre de la défense avant 1993. Son avis n'est pas écouté.
« Au nom de la France », guerres secrètes au Rwanda vient ainsi utilement explorer cette catastrophe politique française. Elle s'achèvera dans le pire, avec l'exfiltration d'une partie des génocidaires, avec la tolérance – pour ne pas dire plus – de trafics d'armes pour continuer à armer le pouvoir intérimaire durant les tueries, avec le rôle du mercenaire français Paul Barril aujourd'hui visé par une enquête pour « complicité de génocide » par le pôle spécialisé de la justice française. Et ce soutien se poursuivra même durant l'opération Turquoise, comme en témoigne aujourd'hui un militaire qui assure qu'avant de devenir humanitaire, l'opération Turquoise a clairement été une opération offensive visant à briser le FPR (lire ici le témoignage de Guillaume Ancel, recueilli par France Culture 3). Une vingtaine d'enquêtes judiciaires sont aujourd'hui en cours en France. Ce livre permet de comprendre combien elles sont nécessaires.
Ci-dessous, de larges extraits de « Au nom de la France », guerres secrètes au Rwanda
------------------------------------------------------------
Quand la diplomatie française évoque une « élimination totale des Tutsi »
Depuis le début des années 1990, des informations recoupées sur le « ciblage » des Tutsi remontent vers le sommet de l’État français. Dès le 12 octobre 1990, l’attaché de défense à Kigali, le colonel René Galinié, s’inquiète des conséquences que pourraient avoir des arrestations massives de Tutsi : « Il est à craindre que ce conflit finisse par dégénérer en guerre ethnique », écrit-il1. Le lendemain, l’ambassadeur Georges Martres (en poste de 1990 à 1993) fait le même constat : « Les paysans hutu organisés par le MRND [le parti de J. Habyarimana] ont intensifié la recherche des Tutsi suspects dans les collines. Des massacres sont signalés dans la région de Kibilira. » Les paysans, fidèles au régime « participent de plus en plus à l’action militaire à travers des groupes d’autodéfense armés d’arcs et de machettes », écrit le diplomate2.
Devant la Mission d’information parlementaire, le colonel Galinié précise « qu’il avait déjà fait état, en janvier 1990, dans son rapport d’attaché de défense, de ce risque d’élimination physique et des massacres3. »
Dans un télégramme diplomatique déclassifié du 15 octobre 1990, l’ambassadeur Martres évoque clairement la crainte d’un génocide de la part de la population tutsi : « Cette victoire militaire [du FPR], même partielle, lui permettrait d’échapper au génocide. […] Les Tutsi sont convaincus que si la victoire du pouvoir actuel était totale, le départ des troupes françaises et belges aurait pour résultat d’aggraver la répression et les persécutions et conduirait à l’élimination totale des Tutsi. »
Le 24 octobre, l’attaché de défense à Kigali reconnaît, lui aussi, ce risque génocidaire contre les Tutsi qu’il lie directement à une victoire militaire du FPR et à la mise en place d’un « royaume tutsi ». « Ce rétablissement avoué ou déguisé [d’un royaume tutsi] entraînant, selon toute vraisemblance, l’élimination physique à l’intérieur du pays des Tutsi, 500 000 à 700 000 personnes, par les Hutu 7 000 000 d’individus », écrit le colonel Galinié4.
La diplomatie française est également parfaitement au courant des appels au meurtre lancé par la revue des extrémistes hutu Kangura (« Réveillez-le ! »), destinés à préparer les esprits au génocide. Dans le numéro du 6 décembre 1990 de Kangura, figure en toutes lettres « les dix commandements du Hutu », ordonnant notamment de « cesser d’avoir pitié » des Tutsi. Le texte est publié en français avec une grande photo de François Mitterrand, et cette légende : « Un véritable ami du Rwanda. C’est dans le malheur que les véritables amis se découvrent. »
« L’atrocité du génocide était bien connue »
« Le génocide était prévisible dès cette période, sans toutefois qu’on puisse en imaginer l’ampleur et l’atrocité », déclare Georges Martres devant la Mission d’information sur le Rwanda. « Certains Hutu avaient d’ailleurs eu l’audace d’y faire allusion. […] Le génocide constituait une hantise quotidienne pour les Tutsi. » Un cruel constat sur lequel l’ancien ambassadeur s’appuie… pour mieux justifier le soutien de la France au régime Habyarimana, qui n’avait rien, à ses yeux, rien d’« inconditionnel ». « C’est donc dans l’unique but d’éviter les pires débordements que la présence militaire française a été maintenue5 », conclut le diplomate.
De la même manière, les signes annonciateurs du pire remontent vers son homologue belge. Dès le 27 mars 1992, l’ambassadeur belge à Kigali, Johan Swinnen, transmet à son ministre, Willy Claes, un télex révélant l’existence d’un état-major secret « chargé de l’extermination des Tutsi […] afin de résoudre définitivement, à leur manière, le problème ethnique au Rwanda et d’écraser l’opposition hutue intérieure6. » La France pouvait-elle l’ignorer ? Cela paraît difficilement imaginable.
« Il serait excessif de dire que les services de l’ambassade étaient conscients de la gravité des événements à venir et du risque de génocide », assure, de son côté, Jean-Michel Marlaud, ambassadeur de France à Kigali de mai 1993 à avril 19947. « Tout le monde savait qu’il y avait une énorme perspective de massacre », avant le début du génocide reconnaît pourtant Hubert Védrine, tout en indiquant dans la foulée que « la France, seule au monde, alors que les autres pays s’en fichaient complètement, a essayé d’enrayer cet engrenage diabolique8. » Quant à la Mission d’information parlementaire, elle conclut que « l’hypothèse d’un génocide était, au début de l’année 1994, devenue plausible mais non probable ». Une façon de minimiser la responsabilité de la France dans la connaissance de cette escalade génocidaire, pourtant bien documentée par ses diplomates. Peut-être aussi une manière d’établir une sorte de « cordon sanitaire » vis-à-vis des militaires envoyés au Rwanda pour appuyer le régime de Kigali.
Sans vouloir refaire l’Histoire, en relisant le passé avec nos lunettes d’aujourd’hui, il semble difficile de nier qu’un véritable « État génocidaire » était alors en 1992-1993 en train de se mettre en place au Rwanda. Un processus qui s’est accéléré après le retour d’une séance de négociations à Arusha, le 8 janvier 1993, du colonel Bagosora annonçant qu’il « rentre pour préparer l’Apocalypse ». Trois mois plus tard, les extrémistes Hutu créent leur propre radio, la RTLM.
Toute l’économie du pays se met alors également au service du génocide. À partir de 1993, l’aide au développement est détournée pour acheter des armes à feu ou des machettes, comme l’ont minutieusement démontré dans un rapport rendu public en 1996 le sénateur belge Pierre Galand et l’expert en finance internationale canadien Michel Chossudovsky12.
« Bien avant le mois d’avril 1994, on voyait une montée des tensions et de la violence », se souvient la journaliste Colette Braeckman. « Ce n’était pas une violence isolée. On pouvait déceler, notamment dans les massacres de Nyamata, dans le Bugesera, en 1992, qu’il y avait là une organisation étatique. Les ordres partaient du haut de la pyramide avant d’être transmis jusqu’aux différentes cellules chargées des massacres, via les bourgmestres. Il y avait une organisation parallèle, violente, qui commettait des tueries, des exécutions. Le schéma était déjà posé. L’ampleur et l’atrocité du génocide étaient bien connues. Tout le monde le voyait13. »
En 1993, la FIDH, en lien avec trois autres organisations humanitaires14, décide de se rendre au Rwanda pour prendre la mesure de la situation. Après avoir passé deux semaines sur place (du 7 au 21 janvier), les ONG n’ont plus aucun doute : un génocide a bien débuté contre les Tutsi et les Hutu soupçonnés de complicité avec le FPR. La FIDH révèle également l’existence d’« escadrons de la mort », en lien avec le président Habyarimana, son épouse et les ultras du régime.
« Des actes de génocide ont été perpétrés dans votre pays à l’encontre de l’ethnie tutsi, avec la participation d’agents de l’État et de militaires des Forces Armées rwandaises », écrit alors le président de la FIDH, Daniel Jacoby, à Juvénal Habyarimana, en l’implorant d’« arrêter immédiatement les tueries ».
Avant même la publication officielle du rapport des ONG, en mars 1993, les autorités françaises sont alertées. Le président de l’association Survie, Jean Carbonare, membre de cette mission d’enquête, prévient l’ambassadeur de France, qui en réfère immédiatement au conseiller Afrique de l’Élysée, Bruno Delaye.
« Quoiqu’elle se soit heurtée à de nombreux obstacles (notamment menaces et intimidations contre les personnes qui l’ont guidée dans le pays [la mission de la FIDH] a collecté une quantité impressionnante de renseignements sur les massacres qui se sont déroulés depuis le début de la guerre d’octobre 1990 et plus particulièrement sur ceux des Bagowe (groupe de l’ethnie tutsi) », écrit Georges Martres. L’ambassadeur explique que la mission a également « obtenu les aveux d’un membre "repenti" des "escadrons de la mort", Janvier Afrika, actuellement détenu à la prison de Kigali pour d’autres crimes. Ces aveux démentent la thèse officiellement adoptée jusqu’ici selon laquelle ces violences ethniques ont été provoquées par les réactions de la population aux attaques du FPR perçues avant tout comme venant des Tutsi. »
« Selon Janvier Afrika, les massacres auraient été déclenchés par le président Habyarimana lui-même, poursuit le diplomate. […] L’opération aurait été programmée avec l’ordre de procéder à un génocide systématique en utilisant, si nécessaire, le concours de l’armée et en impliquant la population locale dans les assassinats, sans doute pour rendre celle-ci plus solidaire dans la lutte contre l’ethnie ennemie. »
La mission « va sans doute déposer des conclusions qui mettront gravement en cause le chef de l’État [rwandais] », s’inquiète encore l’ambassadeur. « Ces conclusions seront évidemment démenties par celui-ci, au motif que la mission n’aura rencontré sur le terrain que des membres de l’ethnie tutsi ou des partisans de l’opposition. Mais il faut s’attendre à un beau tapage dans la presse belge. Par ailleurs, le rapport ne manquera pas de mettre en relief la "neutralité" de l’armée française dans ces massacres, considérée comme une preuve de sa "complicité"15. »
« Notre pays supporte militairement et financièrement ce système »
Les autorités françaises semblent donc plus préoccupées par la gestion médiatique de ce rapport que par son contenu alarmant. « Après la publication du rapport, la Belgique a rappelé son ambassadeur à Kigali pour consultation », se souvient l’un de ses co-rédacteurs, l’avocat belge Eric Gillet. « La France, elle, n’a pas bougé. On avait l’impression qu’il s’agissait pour les autorités françaises d’une information presque anecdotique. Cela n’a eu aucune incidence sur la politique de la France au Rwanda16. »
Certes, Jean Carbonare est bien reçu par la cellule Afrique de l’Élysée. Sans changer le cours des choses. Face à l’atonie du pouvoir, le président de « Survie » tente alors d’alerter l’opinion publique. Le 24 janvier 1993, Jean Carbonare fait une intervention poignante au journal d’Antenne 2, présenté par Bruno Masure. Pourtant, malgré son caractère visionnaire, cet appel ne soulève aucune indignation citoyenne dans le pays17.
Même atonie dans les rangs politiques, comme le constate notamment l’ancien ministre de la Défense, Pierre Joxe. « Pendant la période où j’étais ministre de la Défense, les opérations extérieures qui ont le plus attiré l’attention étaient celles de l’ex-Yougoslavie, du Cambodge et de la Somalie », explique-t-il devant la Mission d’information parlementaire. « À l’époque, les opérations au Rwanda attiraient moins l’attention : par erreur de diagnostic, méconnaissance de l’histoire… Je suis plusieurs fois venu devant la commission de la Défense, ça n’était pas les questions qui étaient posées à ce moment-là. La tradition d’intervention plus ou moins forte de la France dans ses anciennes colonies ou dans les anciens territoires coloniaux de pays proches était passée dans les mœurs18. »
Il faut attendre quatre ans pour que les députés commencent à enquêter, alors que dès l’opération Turquoise des articles éloquents sont publiés dans la presse. Ainsi, en juin 1994, Libération revient sur les accusations de Janvier Afrika, cet ancien membre des escadrons de la mort, interrogé quelques mois plus tôt par la FIDH. « Tout cela a été bien préparé et organisé au sommet de l’État, dit-il. Des réunions régulières ont eu lieu dans la maison du capitaine Pascal Simbikangwa19, fonctionnaire à la présidence rwandaise et beau-frère du colonel Elie Sagatwa, lui-même secrétaire particulier et beau-frère du chef de l’État. » L’homme met en cause le président Habyarimana, « chef » du « réseau zéro » chargé d’éliminer les Tutsi et les Hutu modérés, mais aussi le rôle joué par les militaires français : « Ce sont des instructeurs français qui, en 1991, m’ont appris à lancer un couteau, à assembler mon fusil », témoigne Janvier Afrika. « Dans un camp sur le mont Kigali, nous avons fait ensemble des exercices de tirs. Il y a eu des stages pour ça, aussi pour les miliciens Interahamwe20. »
Des « exactions malheureuses » pour l’Élysée
Des accusations qui font s’étrangler de rage le ministre de la Coopération, Michel Roussin : « Vous imaginez des Français dans une mission de coopération en train de former des escadrons de la mort !, dit-il. […] J’attends qu’on me donne des preuves, des noms. C’est moi, ministre de la Coopération, qui suis attaqué directement. J’aurais mis en place, moi, des types chargés de former des escadrons de la mort ! Il faut être sérieux… Tout est toujours très bon dans les périodes de crise pour montrer la France du doigt21. »
De la même façon, l’ancien du SDECE dément que d’éventuelles informations sur un risque de génocide aient pu remonter jusqu’au ministère de la Coopération : « En d’autres temps, j’ai été un homme de renseignements, dit-il. […] Il y a des gens qui sont des spécialistes de ce genre de choses, qui alertent le pouvoir politique au plus haut niveau pour l’aider à prendre ses décisions. En aucune manière, cette mission ne peut être celle des coopérants militaires traditionnels22. »
Malgré tous ces clignotants rouges, le risque génocidaire est complètement nié par l’Élysée. Dans une note du 15 février 1993, Bruno Delaye préfère parler d’« exactions malheureuses commises par les extrémistes hutu » qui alimentent un « excellent système de propagande » favorable au FPR et aux Tutsi, regrette le conseiller élyséen.
La seule obsession de l’Élysée reste la menace militaire du FPR.
« Nous sommes aux limites de la stratégie indirecte d’appui aux forces armées rwandaises », souligne encore Bruno Delaye. Nous accélérons les livraisons de munitions et matériels. […] Au cas où le front serait enfoncé, nous n’aurions d’autre choix que d’évacuer Kigali (la mission officielle23 de nos deux compagnies d’infanterie est de protéger les expatriés), à moins de devenir cobelligérants. » Une cobelligérance pourtant effective sur le terrain, même si le chef d’État-major particulier du président Mitterrand, le général Quesnot, explique aux députés qu’« il n’était pas question d’engagement direct contre le FPR ou l’armée ougandaise ». Sans craindre la contradiction, le haut gradé lâche pourtant cette phrase : « Cette guerre était une vraie guerre, dit-il, totale et très cruelle24. »
(...)
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."