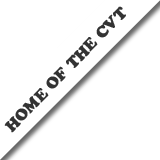coupe du monde de rugby 2015
Ouais, cheurr les anglais mais si la France tombe contre l'Australie, on va se faire fister le fion bien fort. Sacré niveau.
article intéressant sur l'évolution du rugby
Coupe du monde de rugby : la grande broyeuse
Au suivant. Un peu plus de deux semaines de compétition et déjà dix-neuf joueurs qui ont dû abandonner la Coupe du monde sur blessure. Dix-neuf malheureux, dont l’ailier du XV de France Yoann Huget – ligaments croisés du genou droit rompus dès le premier match face à l’Italie –, tous contraints de quitter l’Angleterre et cette 8e édition après trente matchs disputés sur quarante-huit, sacrifiés sur l’autel d’un sport qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort et fait de plus en plus de dégâts. A ce train-là, le martyrologe provisoire de 2015 a déjà dépassé de quatre unités celui de toute la précédente édition, en 2011.
Difficile d’éluder la question pour le Français Bernard Lapasset, président de World Rugby, la fédération internationale : « On va s’en occuper, c’est un problème important qui amène à s’interroger sur la façon dont notre sport évolue. » Pour l’ancien champion de France « corpo » avec les Douanes de Paris, cette tendance à la hausse s’explique : « Le rugby est devenu plus rapide, plus fort, l’approche professionnelle [depuis 1995] et ses enjeux ont fait que les entraîneurs prennent des options de jeu extrêmement défensives, avec plus de contacts, plus de plaquages. »
Devant sa télévision, Robins Tchale-Watchou constate la casse. Le deuxième-ligne camerounais de Montpellier, président de Provale, syndicat des joueurs du championnat de France, regrette « l’évolution de la pratique ». A savoir : un jeu de plus en plus physique, de plus en plus frontal, où s’éclipsent les notions de courses, d’évitements, d’intervalles. « Maintenant, au rugby, il faut détruire le mur, détruire la défense. Sauf qu’ici ce n’est pas un bloc de béton qui en rencontre un autre, ce sont des corps humains. Donc, indéniablement, ça casse. »
Le danger des « mêlées ouvertes »
Pour illustrer cette logique d’affrontements, un seul chiffre : le nombre exponentiel de rucks par match, ces regroupements informels et spontanés lors desquels se jettent des joueurs de part et d’autre pour se disputer un ballon resté au sol. Là où le danger résidait surtout dans des mêlées classiques (et statiques), il se déporte aujourd’hui sur ces phases dynamiques, qualifiées de « mêlées ouvertes ». En un seul et même match, il est désormais possible d’en dénombrer « jusqu’à 180 », selon Philippe Saint-André, le sélectionneur du XV de France, toujours prompt à comparer le rugby à « un sport de combat », et ses joueurs, à « des boxeurs ».
Jeudi 1er octobre, à Milton Keynes, « PSA » avait donc apprécié le bilan de la victoire prévisible des Bleus sur le Canada (41-18), lors de leur troisième match du Mondial : « Apparemment, pas de blessé », se réjouissait-il à propos de ce match. De bon augure en vue de la « finale » du groupe D contre l’Irlande, dimanche 11 octobre, décisive pour savoir qui évitera en quarts de finale les Néo-Zélandais, champions du monde en titre .
Miroir grossissant de ce rugby broyeur, la Coupe du monde donne un aperçu du très haut niveau tel qu’il se pratique aujourd’hui parmi vingt sélections nationales aux statuts pourtant hétéroclites (« certaines avec des professionnels, d’autres avec des semi-pros ou des amateurs », liste Lapasset). « Les touches et les mêlées, on n’en voit déjà presque plus, relève le docteur Bernard Dusfour, qui préside la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, responsable du secteur professionnel français. Maintenant, on cherche à garder le ballon sur le terrain, les temps de jeu effectifs sont passés d’une vingtaine de minutes à près de quarante minutes. Or, le rugby, c’est comme quand vous traversez une route : si vous la traversez deux fois plus, vous doublez le risque d’accident. »
« On n’est jamais à l’abri de quelque chose qui se casse »
Dans sa démonstration, le praticien avance aussi le concept d’« énergie cinétique ». Dit autrement : « Ce qui est certain, c’est qu’il y a de plus en plus de rucks dans les matchs et que le rapport poids-vitesse des joueurs augmente. Alors, oui, les risques de chocs violents augmentent aussi en cas de collision », reconnaissait Yannick Bru, l’entraîneur des avants du XV de France, avant même le début de la Coupe du monde.
« Le rugby commence à être vraiment costaud, pas étonnant qu’il y ait plus de blessés, estime le deuxième-ligne international du Stade français, Pascal Papé, très gaillard au demeurant (116 kg pour 1,95 m). Maintenant, la préparation physique d’une équipe de “petit standing” et celle d’une grosse équipe est la même. Tout le monde se prépare au Mondial pendant deux mois. » Il a beau assurer « ne pas y penser et y aller à fond à chaque match », le demi de mêlée des Bleus et de Toulon Sébastien Tillous-Borde complète le propos : « On n’est jamais à l’abri de quelque chose qui se casse. Car, qui dit “mieux préparé” dit aussi plus de vitesse et plus d’impact, donc, obligatoirement, c’est plus dur. »
Le pouce gauche d’Ovidiu Tonita en sait quelque chose. A 35 ans, le Roumain vient d’achever sa cinquième Coupe du monde plus tôt que prévu sur un essai… et une fracture face à l’Irlande. Son deuxième match seulement de l’édition 2015. « En 1999 ou en 2003, les chocs étaient moins violents. Mais, à chaque fois, la vitesse de jeu accélère. Aujourd’hui, ça va à 2 000 à l’heure. Maintenant, même les trois-quarts font quasiment tous 100, 105 kg, jauge le troisième-ligne. Avant, c’était plutôt 70 ou 80… »
Et dire que World Rugby avait voulu faire de cette Coupe du monde anglaise un modèle pour la sauvegarde physique des joueurs… Et dire que l’instance avait recommandé aux arbitres une vigilance particulière sur les séquences dites de déblaiement, pour protéger les joueurs à terre, ou encore sur la prévention des commotions cérébrales, fléau qui menace à terme de transformer le rugby en version européenne – et tout aussi traumatique – du football américain.
« Quand tu n’as plus de cartilage aux deux genoux, tu ne peux même pas faire un tour de vélo avec tes gamins, tout ton quotidien change. »
Ne serait-ce que sur cette première quinzaine de 2015, la typologie des blessures indique l’étendue des dégâts : genoux, mâchoire, mais aussi cuisses, pectoraux, tendons d’Achille. Plutôt que d’invoquer une décision miracle – ou d’interdire à tout joueur excédant le quintal d’entrer sur le terrain –, Bernard Lapasset préfère prendre le temps de la réflexion pour répondre au problème : « C’est une priorité qui fait l’objet actuellement d’une étude extrêmement précise, cas par cas. On n’en est même pas encore à la moitié des matchs [France-Canada était le 22e sur 48]. On attendra l’issue de la compétition avant de tirer des conclusions et de proposer des solutions pour sécuriser notre sport. »
Certains ont déjà quelques idées à lui glisser. Bernard Dusfour préconise encore davantage de « sévérité » de la part des arbitres. Robins Tchale-Watchou, lui, en appelle à une refonte des calendriers et à une limitation généralisée du nombre de matchs : « On ne peut pas soumettre les joueurs à ces rythmes effrénés. Ce n’est plus tenable. Au bout d’un moment, le corps nous rappelle ses limites », dit-il au sujet de ces joueurs qui enquillent plus de trente matchs par saison avec leurs clubs et leurs sélections nationales.
En France, il y aurait urgence à réagir : « En Top 14 et en Pro D2, les assureurs et les employeurs ont fait le constat que les pertes de licence à la suite d’un accident ou d’une contre-indication médicale étaient en hausse. Pour la saison dernière, on en comptait quatorze. Il y a dix ans, ce devait être seulement six ou huit. » Le président de Provale insiste : « Quand tu n’as plus de cartilage aux deux genoux, tu ne peux même pas faire un tour de vélo avec tes gamins, tout ton quotidien change. »
Ovidiu Tonita est très loin d’en être là. Actuellement au chômage (autre problème de plus en plus récurrent dans le rugby), le troisième-ligne roumain se requinque désormais à Perpignan, ville d’un de ses anciens clubs. Lui aussi a sa proposition, un rien utopiste : « Il faudrait agrandir le terrain ! Comme ça, il y aurait plus de place, on jouerait un peu plus dans les espaces que maintenant, au lieu de rester dans l’affrontement. »
Coupe du monde de rugby : la grande broyeuse
Au suivant. Un peu plus de deux semaines de compétition et déjà dix-neuf joueurs qui ont dû abandonner la Coupe du monde sur blessure. Dix-neuf malheureux, dont l’ailier du XV de France Yoann Huget – ligaments croisés du genou droit rompus dès le premier match face à l’Italie –, tous contraints de quitter l’Angleterre et cette 8e édition après trente matchs disputés sur quarante-huit, sacrifiés sur l’autel d’un sport qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort et fait de plus en plus de dégâts. A ce train-là, le martyrologe provisoire de 2015 a déjà dépassé de quatre unités celui de toute la précédente édition, en 2011.
Difficile d’éluder la question pour le Français Bernard Lapasset, président de World Rugby, la fédération internationale : « On va s’en occuper, c’est un problème important qui amène à s’interroger sur la façon dont notre sport évolue. » Pour l’ancien champion de France « corpo » avec les Douanes de Paris, cette tendance à la hausse s’explique : « Le rugby est devenu plus rapide, plus fort, l’approche professionnelle [depuis 1995] et ses enjeux ont fait que les entraîneurs prennent des options de jeu extrêmement défensives, avec plus de contacts, plus de plaquages. »
Devant sa télévision, Robins Tchale-Watchou constate la casse. Le deuxième-ligne camerounais de Montpellier, président de Provale, syndicat des joueurs du championnat de France, regrette « l’évolution de la pratique ». A savoir : un jeu de plus en plus physique, de plus en plus frontal, où s’éclipsent les notions de courses, d’évitements, d’intervalles. « Maintenant, au rugby, il faut détruire le mur, détruire la défense. Sauf qu’ici ce n’est pas un bloc de béton qui en rencontre un autre, ce sont des corps humains. Donc, indéniablement, ça casse. »
Le danger des « mêlées ouvertes »
Pour illustrer cette logique d’affrontements, un seul chiffre : le nombre exponentiel de rucks par match, ces regroupements informels et spontanés lors desquels se jettent des joueurs de part et d’autre pour se disputer un ballon resté au sol. Là où le danger résidait surtout dans des mêlées classiques (et statiques), il se déporte aujourd’hui sur ces phases dynamiques, qualifiées de « mêlées ouvertes ». En un seul et même match, il est désormais possible d’en dénombrer « jusqu’à 180 », selon Philippe Saint-André, le sélectionneur du XV de France, toujours prompt à comparer le rugby à « un sport de combat », et ses joueurs, à « des boxeurs ».
Jeudi 1er octobre, à Milton Keynes, « PSA » avait donc apprécié le bilan de la victoire prévisible des Bleus sur le Canada (41-18), lors de leur troisième match du Mondial : « Apparemment, pas de blessé », se réjouissait-il à propos de ce match. De bon augure en vue de la « finale » du groupe D contre l’Irlande, dimanche 11 octobre, décisive pour savoir qui évitera en quarts de finale les Néo-Zélandais, champions du monde en titre .
Miroir grossissant de ce rugby broyeur, la Coupe du monde donne un aperçu du très haut niveau tel qu’il se pratique aujourd’hui parmi vingt sélections nationales aux statuts pourtant hétéroclites (« certaines avec des professionnels, d’autres avec des semi-pros ou des amateurs », liste Lapasset). « Les touches et les mêlées, on n’en voit déjà presque plus, relève le docteur Bernard Dusfour, qui préside la commission médicale de la Ligue nationale de rugby, responsable du secteur professionnel français. Maintenant, on cherche à garder le ballon sur le terrain, les temps de jeu effectifs sont passés d’une vingtaine de minutes à près de quarante minutes. Or, le rugby, c’est comme quand vous traversez une route : si vous la traversez deux fois plus, vous doublez le risque d’accident. »
« On n’est jamais à l’abri de quelque chose qui se casse »
Dans sa démonstration, le praticien avance aussi le concept d’« énergie cinétique ». Dit autrement : « Ce qui est certain, c’est qu’il y a de plus en plus de rucks dans les matchs et que le rapport poids-vitesse des joueurs augmente. Alors, oui, les risques de chocs violents augmentent aussi en cas de collision », reconnaissait Yannick Bru, l’entraîneur des avants du XV de France, avant même le début de la Coupe du monde.
« Le rugby commence à être vraiment costaud, pas étonnant qu’il y ait plus de blessés, estime le deuxième-ligne international du Stade français, Pascal Papé, très gaillard au demeurant (116 kg pour 1,95 m). Maintenant, la préparation physique d’une équipe de “petit standing” et celle d’une grosse équipe est la même. Tout le monde se prépare au Mondial pendant deux mois. » Il a beau assurer « ne pas y penser et y aller à fond à chaque match », le demi de mêlée des Bleus et de Toulon Sébastien Tillous-Borde complète le propos : « On n’est jamais à l’abri de quelque chose qui se casse. Car, qui dit “mieux préparé” dit aussi plus de vitesse et plus d’impact, donc, obligatoirement, c’est plus dur. »
Le pouce gauche d’Ovidiu Tonita en sait quelque chose. A 35 ans, le Roumain vient d’achever sa cinquième Coupe du monde plus tôt que prévu sur un essai… et une fracture face à l’Irlande. Son deuxième match seulement de l’édition 2015. « En 1999 ou en 2003, les chocs étaient moins violents. Mais, à chaque fois, la vitesse de jeu accélère. Aujourd’hui, ça va à 2 000 à l’heure. Maintenant, même les trois-quarts font quasiment tous 100, 105 kg, jauge le troisième-ligne. Avant, c’était plutôt 70 ou 80… »
Et dire que World Rugby avait voulu faire de cette Coupe du monde anglaise un modèle pour la sauvegarde physique des joueurs… Et dire que l’instance avait recommandé aux arbitres une vigilance particulière sur les séquences dites de déblaiement, pour protéger les joueurs à terre, ou encore sur la prévention des commotions cérébrales, fléau qui menace à terme de transformer le rugby en version européenne – et tout aussi traumatique – du football américain.
« Quand tu n’as plus de cartilage aux deux genoux, tu ne peux même pas faire un tour de vélo avec tes gamins, tout ton quotidien change. »
Ne serait-ce que sur cette première quinzaine de 2015, la typologie des blessures indique l’étendue des dégâts : genoux, mâchoire, mais aussi cuisses, pectoraux, tendons d’Achille. Plutôt que d’invoquer une décision miracle – ou d’interdire à tout joueur excédant le quintal d’entrer sur le terrain –, Bernard Lapasset préfère prendre le temps de la réflexion pour répondre au problème : « C’est une priorité qui fait l’objet actuellement d’une étude extrêmement précise, cas par cas. On n’en est même pas encore à la moitié des matchs [France-Canada était le 22e sur 48]. On attendra l’issue de la compétition avant de tirer des conclusions et de proposer des solutions pour sécuriser notre sport. »
Certains ont déjà quelques idées à lui glisser. Bernard Dusfour préconise encore davantage de « sévérité » de la part des arbitres. Robins Tchale-Watchou, lui, en appelle à une refonte des calendriers et à une limitation généralisée du nombre de matchs : « On ne peut pas soumettre les joueurs à ces rythmes effrénés. Ce n’est plus tenable. Au bout d’un moment, le corps nous rappelle ses limites », dit-il au sujet de ces joueurs qui enquillent plus de trente matchs par saison avec leurs clubs et leurs sélections nationales.
En France, il y aurait urgence à réagir : « En Top 14 et en Pro D2, les assureurs et les employeurs ont fait le constat que les pertes de licence à la suite d’un accident ou d’une contre-indication médicale étaient en hausse. Pour la saison dernière, on en comptait quatorze. Il y a dix ans, ce devait être seulement six ou huit. » Le président de Provale insiste : « Quand tu n’as plus de cartilage aux deux genoux, tu ne peux même pas faire un tour de vélo avec tes gamins, tout ton quotidien change. »
Ovidiu Tonita est très loin d’en être là. Actuellement au chômage (autre problème de plus en plus récurrent dans le rugby), le troisième-ligne roumain se requinque désormais à Perpignan, ville d’un de ses anciens clubs. Lui aussi a sa proposition, un rien utopiste : « Il faudrait agrandir le terrain ! Comme ça, il y aurait plus de place, on jouerait un peu plus dans les espaces que maintenant, au lieu de rester dans l’affrontement. »
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."
fernando a écrit:C'est tout ce que ça t'inspire manu?
C'est sa manière de "did'nt read loler".
I don't always listen to Pantera...but when I do, I get fucking hostile.
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 449 invité(s)