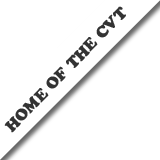Il savait parfaitement ce qu'il faisait et ce qu'il risquait, pensant sans doute éviter le bâton grâce à sa notoriété et ses amitiés.
je pense ke té den le vré, lami
En tous cas la réponse de Plenel aux nombreux commentaires dubitatifs voires hostiles sur le forum de Mediapart accrédite ton analyse.
29/12/2013, 11:48 | Par Edwy Plenel
Chers tous, vu le nombre de commentaires, je m’autorise une réponse groupée aux diverses objections qui nous sont faites (placée en tête du fil pour faciliter sa lecture). Mais, auparavant, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui expriment ici leur solidarité avec Mediapart, ayant compris ce qu’avait de pionnier cette aventure de presse dans toutes ses dimensions : l’audace éditoriale, le modèle économique, l’avancée démocratique.
C’est sur ce dernier point qu’il y a un malentendu avec certains des commentaires critiques dont la franchise est toujours utile. Oui, Mediapart est une entreprise, avec toutes les exigences économiques, financières, sociales, etc., que cela suppose. Mais Mediapart n’est pas tout à fait une entreprise comme les autres. C’est une entreprise pionnière qui invente et innove, non seulement pour elle-même mais pour tout le secteur auquel elle appartient. Lequel secteur est au centre d’enjeux démocratiques essentiels : la liberté de l’information, nous n’avons cessé de le rappeler et de l’illustrer, n’est pas un privilège des journalistes mais un droit des citoyens. Que la presse soit vivante, indépendante, dynamique, puissante, forte, etc., est un enjeu économique qui est au ressort d’un défi politique. Et nous ne voulons pas d’une presse sous perfusion, soumise ou pervertie, ne survivant que grâce aux subventions, à la publicité ou à des industriels. Notre ambition, c'est de prouver qu’une presse indépendante peut vivre du seul soutien de ses lecteurs, étant tous convaincus que la meilleur garantie de l’indépendance éditoriale, c'est l’indépendance financière. C’est le sens de tous nos combats en tant qu’entreprise, accompagnés d’une transparence totale sur les enjeux, les chiffres, les résultats.
Nous avons souvent dit que Mediapart était un laboratoire, comme l’on dit un laboratoire de recherche, dans la crise vécue par les industries, professions et métiers de l’information. Chercher, trouver, inventer des solutions utiles à tous. C’est ainsi qu’au départ, notre entreprise fut sans équivalent aucun : nous avons été le premier journal numérique payant, c’est-à-dire à n’être ni la version Internet d’un quotidien papier payant, ni un site d’information en ligne gratuit et publicitaire. Quand nous nous sommes lancés en 2008 dans un scepticisme généralisé, notre modèle économique était pionnier, et ne connaissait qu’un précédent, @rrêt sur images, lancé à l’été 2007, avant l’annonce le 2 décembre suivant de la création prochaine de Mediapart : nous étions avec @si les premiers à défendre fermement la valeur de l’information et, donc, la conviction que, si l’indépendance, la qualité, l’originalité et la différence étaient au rendez-vous, les lecteurs seraient prêts à payer.
C’est ainsi que nous avons été les premiers à demander à être reconnus juridiquement et administrativement comme de la presse, laquelle, jusqu’à notre démarche officielle auprès des pouvoirs publics, signifiait exclusivement un support imprimé. Les recours de Mediapart auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ont contraint les pouvoirs publics à innover en prenant conscience des bouleversements induits par la révolution numérique. Le statut de la presse en ligne, promulgué par décret en 2009, en est issu : il affirme la neutralité du support en considérant que la presse est un contenu avant d’être un support et que, par conséquent, celui-ci est indifférent, qu’il soit imprimé ou numérique.
Dès l’origine, cette reconnaissance de l’égalité de toutes les presses, numérique et imprimée, impliquait leur égalité de droits et de devoirs. C’était même tout l’enjeu de cette affaire : pouvoir se battre à armes égales. Cela signifiait d’une part l’égalité fiscale, d’autre part la transparence financière. Comment imaginer qu’une nouvelle presse, fragile par définition puisqu’elle invente de nouveaux modèles économiques, soit d’emblée pénalisée par une imposition indirecte presque dix fois plus élevée que celle de la presse existante ?Depuis 2009, tous les protagonistes de ce dossier, qu’il s’agisse des syndicats professionnels de toute la presse ou des pouvoirs publics à tous niveaux, sont convenus que le taux de TVA super réduit à 2,1% devait s’appliquer aussi à la presse en ligne. Lequel taux, comme je l’ai rappelé dans mon premier article sur cette affaire, est un acte politique par lequel, en démocratie, l’Etat affirme que la presse n’est pas une marchandise tout à fait comme les autres et qu’elle doit être protégée de façon à être plus accessible, plus diverse, plus abordable, plus pluraliste, etc., pour le profit de tous, et d’abord de ses lecteurs.
L’Etat, dans ses profondeurs administratives, prétextait cependant de lentes et longues négociations européennes pour officialiser cette évidence. De mémoires en auditions, nous n’avons cessé de montrer que cet obstacle n’en était pas un, et certainement pas en droit comme l’a expliqué ici même notre avocat Me Jean-Pierre Mignard qui a participé à toutes ces démarches. La preuve en fut apportée par l’absurde puisque, sur un secteur, celui du livre, dont l’enjeu démocratique n’a pourtant pas le même fondement constitutionnel que celui de la presse (pluralisme des opinions, liberté de l’information), les responsables politiques, droite et gauche unanimes, prirent leur responsabilité, en instituant début 2012 une TVA réduite à 5,5% semblable pour le livre numérique et pour le livre imprimé.
Tel est le contexte dans lequel le Syndicat professionnel de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil), et non pas Mediapart seul, a décidé en 2011 d’assumer publiquement cette bataille pour l’égalité fiscale en appelant ses adhérents à appliquer le taux légitime à 2,1%. Loin de se mettre dans l’illégalité, il l’a fait pour construire un rapport de forces politique permettant aux gouvernants d’accélérer les démarches qu’ils affirmaient mener activement pour convaincre leurs partenaires européens. En d’autres termes, il n’y avait, en France même, aucun interlocuteur qui soit défavorable à ce taux à 2,1% dont il était admis que son officialisation ne devait plus tarder. Quand a lieu une révolution industrielle et culturelle de l’ampleur que nous connaissons avec le numérique, il y a, comme dans tout domaine de la vie sociale, des acteurs plus audacieux que d’autres. Des acteurs qui font bouger les lignes, qui changent les donnes, qui renversent les obstacles. Tel a été, tel est toujours, notre rôle, avec le Spiil, dans cette affaire. Car notre insistance sur l’égalité fiscale rejoint une bataille plus ample pour un nouvel écosystème de la presse à l’âge numérique. Je ne saurais trop vous inciter à lire le Manifeste du Spiil (en accès libre ici). Nous y défendons la vertu des aides indirectes contre la perversité des aides directes. Nous disons à l’Etat de créer les conditions d’un dynamisme véritable et d’une compétition saine, sans passe-droits ni privilèges ni conflits d’intérêts, tout en remettant en cause progressivement la gabegie des aides financières directes aux médias privés, dont ont trop longtemps profité les plus puissants dans une opacité que le Spiil a enfin réussi à faire lever, en cette fin d’année 2013, avec l’appui de la Cour des comptes.
Bref, nous ne sommes pas des entrepreneurs inconscients (qui n’auraient pas été vigilants) ou malhonnêtes (qui auraient voulu jouer au plus fin). Non, nous sommes, en toute transparence, des pionniers non seulement éditoriaux mais économiques au même titre que le furent les journalistes qui, au XIXe siècle, se battaient pour ce qui fut, finalement, acté par la loi de 1881 sur la presse, fondatrice politiquement et économiquement de la liberté de la presse en France. Et, dans cette bataille, nous n’avons qu’une seule arme, outre nos convictions argumentées : votre solidarité et votre mobilisation.
Il est un brin mégalo Plenel. En gros il dit que vu la pertinence de son combat, les pouvoirs publics n'ont pas d'autre choix que d'accéder à sa revendication, et de manière rétroactive.
Il a aussi du se dire qu'un gouvernement "de gauche" ne pourrait pas dire non. Pari perdu pour le moment.
Au final ça fait con, ça ternit un peu l'image de Mediapart dont les journalistes font par ailleurs du très bon boulot.
"L'alcool tue lentement. On s'en fout, on a le temps."